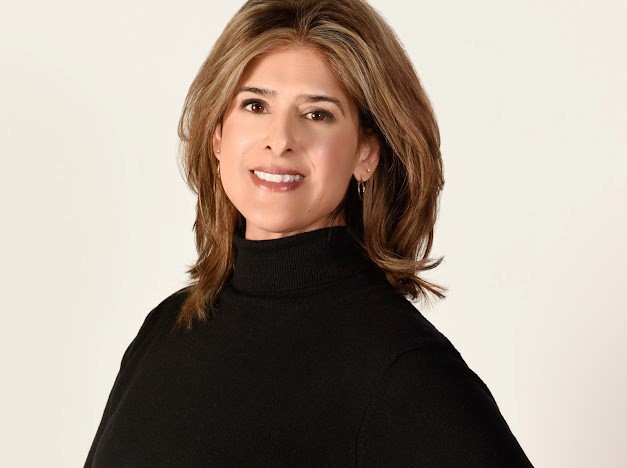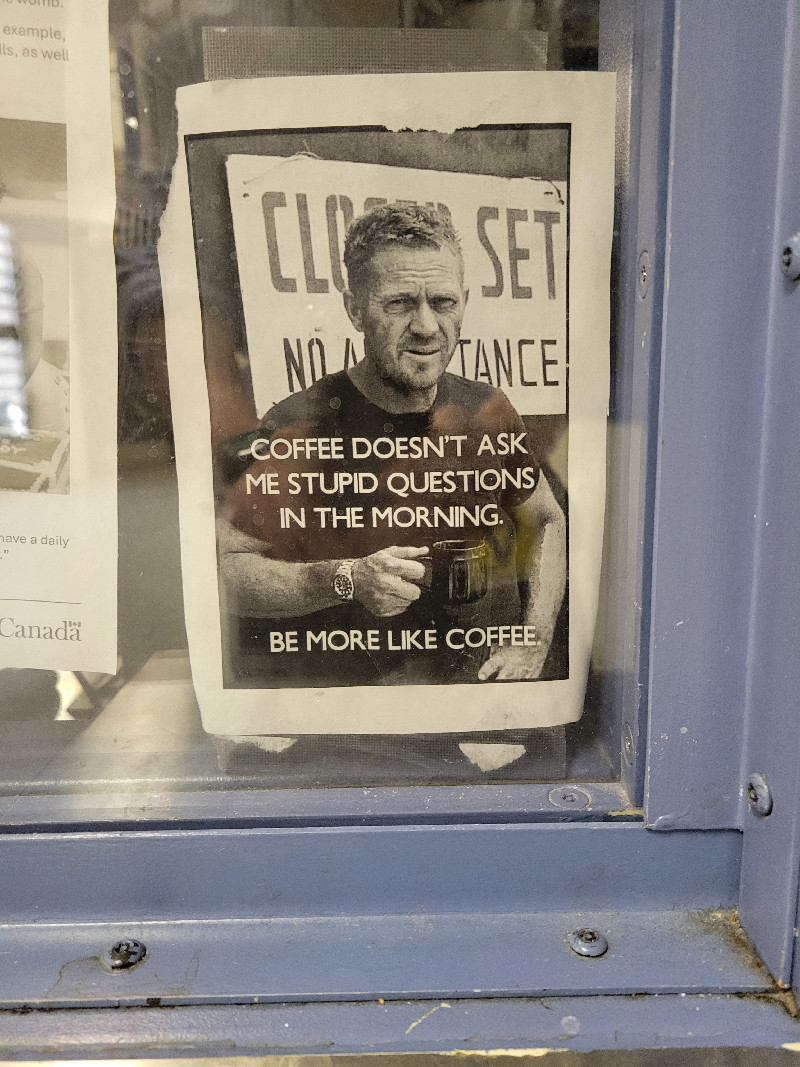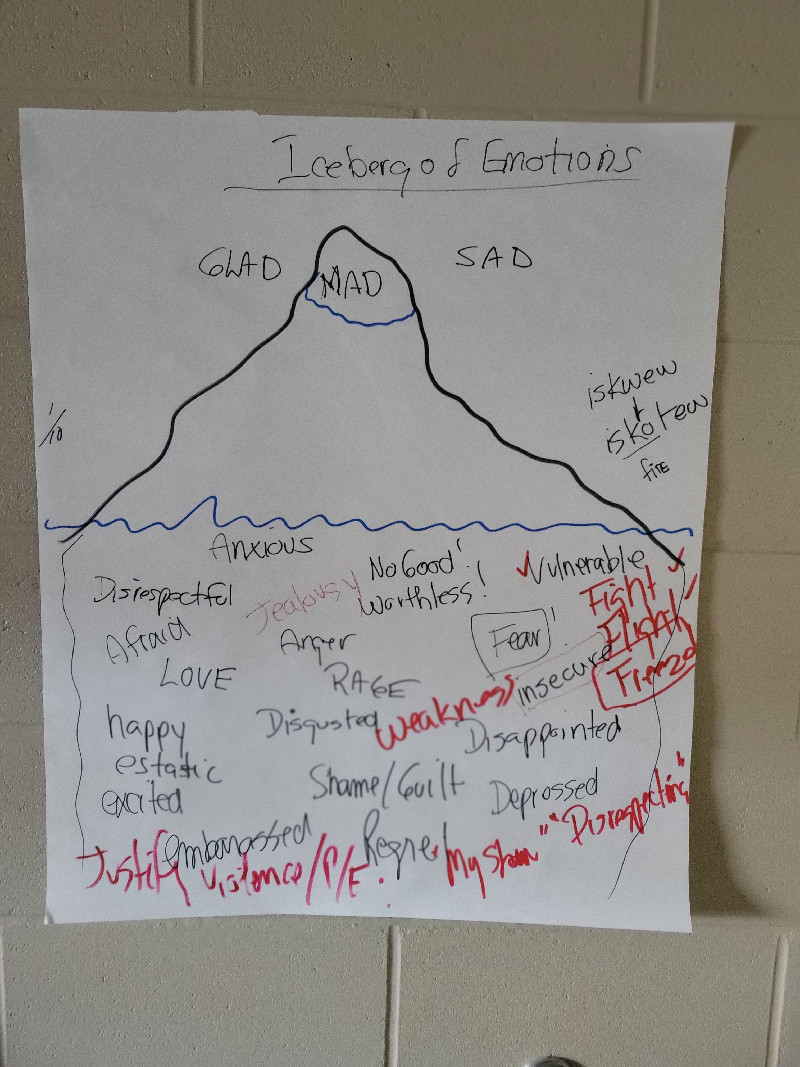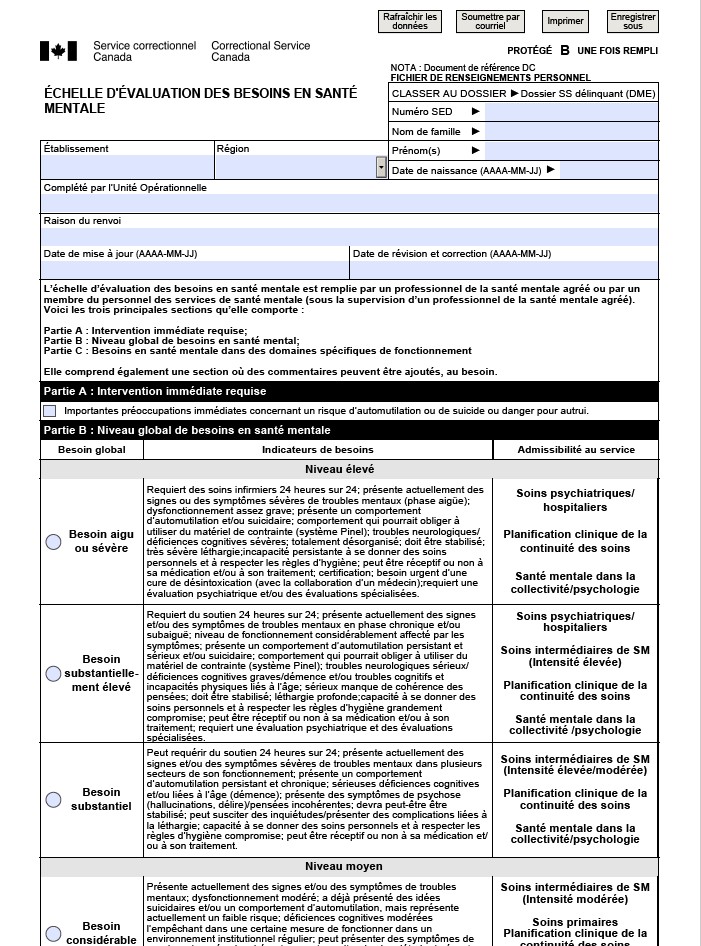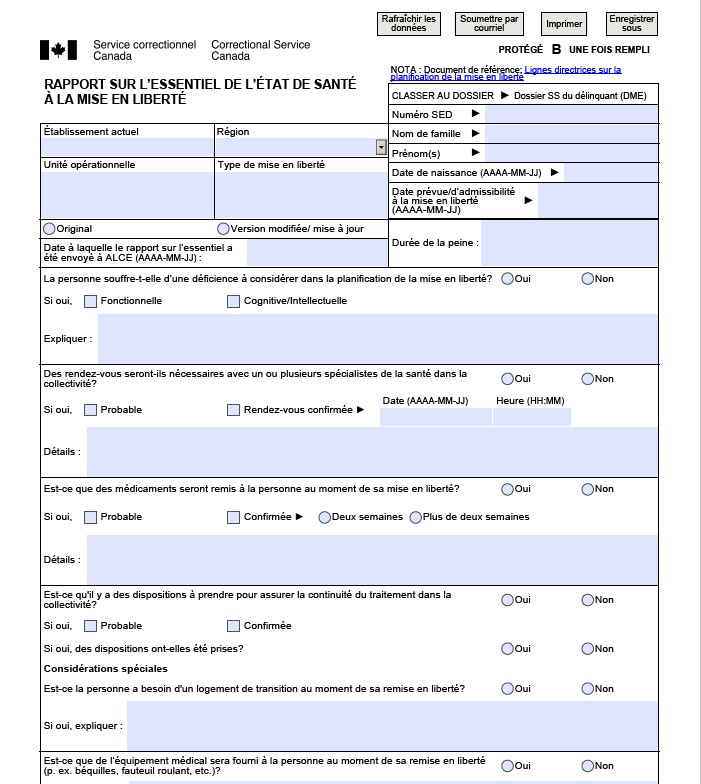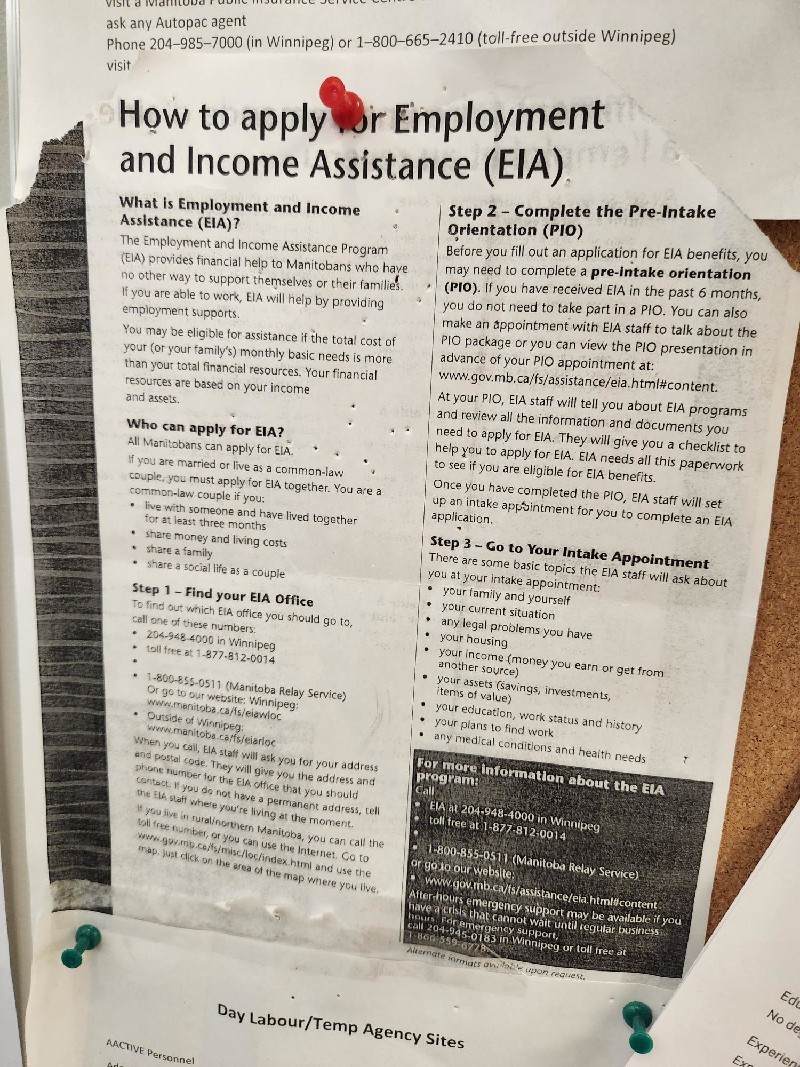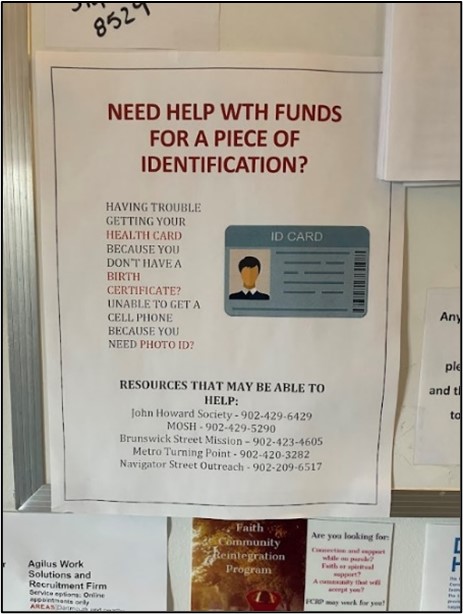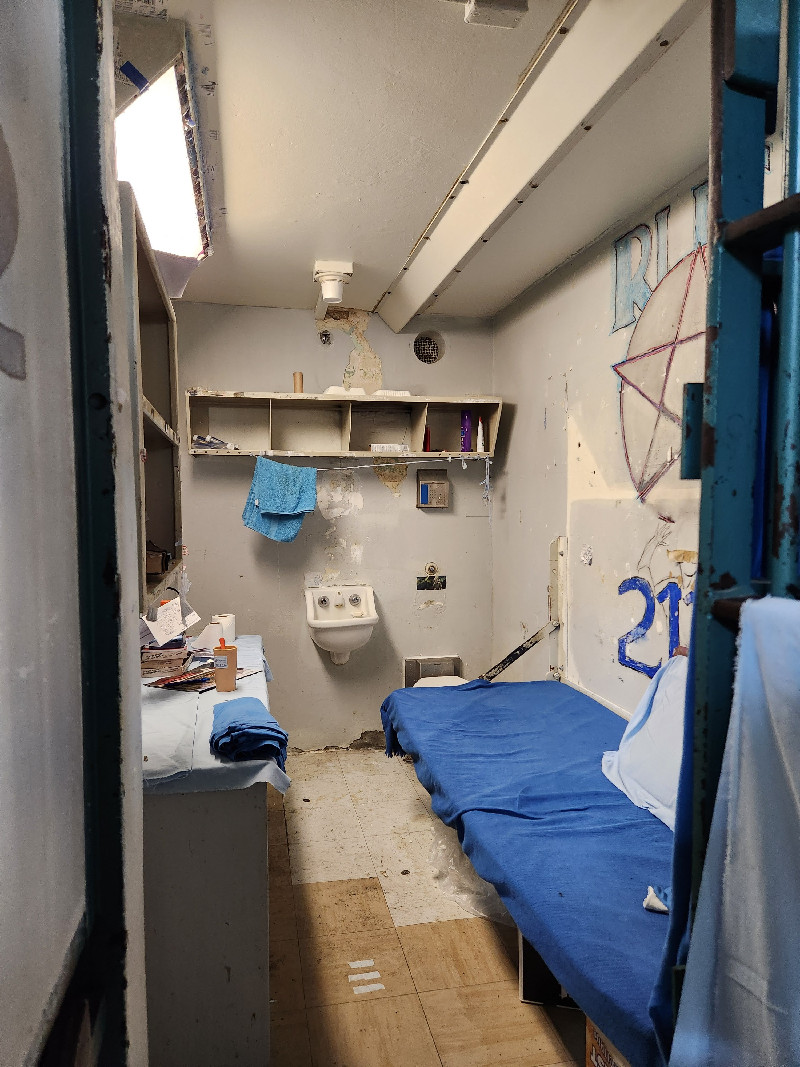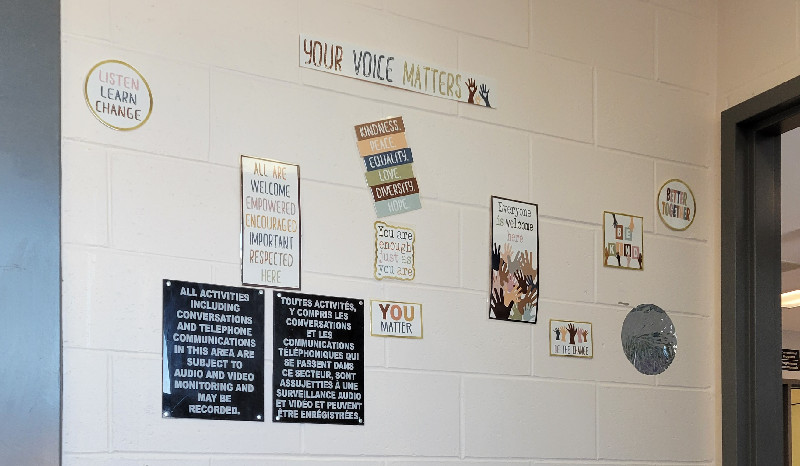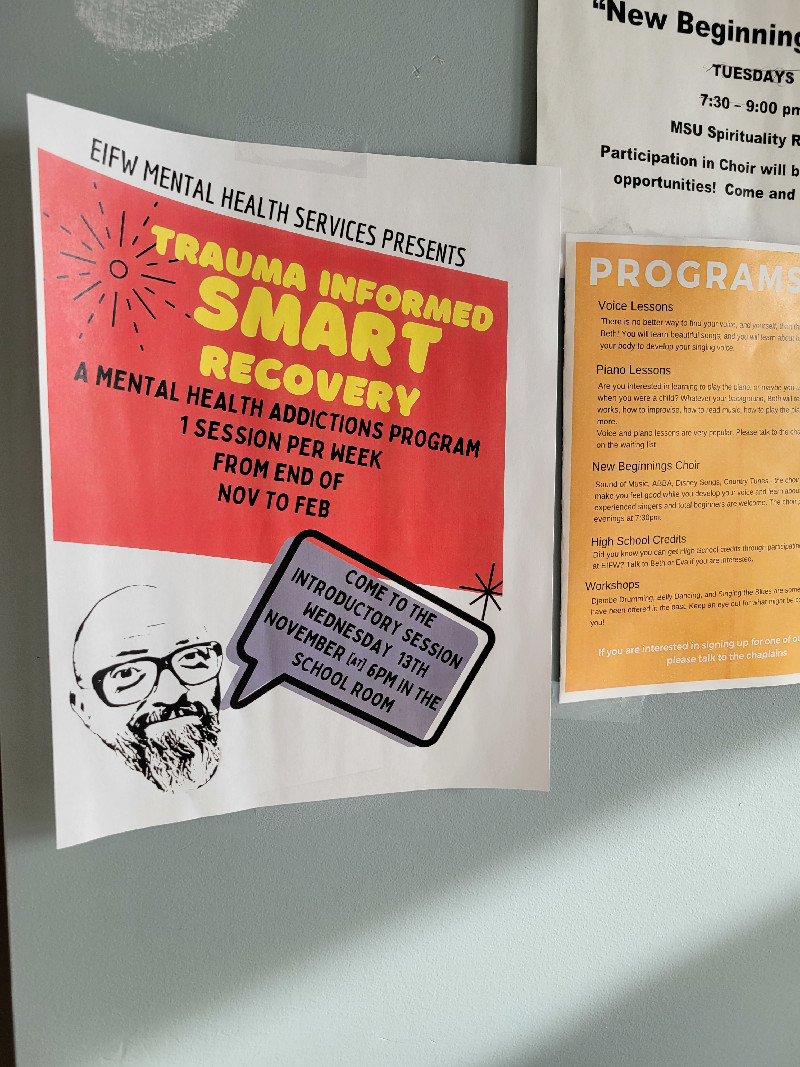Table des matières
Message de l’enquêteur correctionnel
Message de la directrice exécutive
Enquêtes systémiques nationales
Mise à jour sur les rangées de suivi thérapeutique et les valeurs intermédiaries
Évaluation et traitement des traumatismes chez les femmes purgeant une peine de ressort fédéral
Perspectives de l’enquêteur correctionnel pour 2025-2026
Le Prix Ed McIsaac pour la promotion des droits de la personne dans le système correctionnel
ANNEXE A : Résumé des recommandations
ANNEXE B : Statistiques annuelles
Message de l’enquêteur correctionnel
Après mûre réflexion, j’ai décidé qu’il s’agirait de mon tout dernier rapport annuel. J’ai en effet l’intention de prendre ma retraite à la fin de janvier 2026, ce qui mettra fin à 30 ans de fonction publique, soit deux ans avant la fin de mon mandat actuel de cinq ans. Cet échéancier permettra la publication de mon rapport final à l’automne 2025 et donnera au gouvernement du Canada suffisamment de temps pour nommer un successeur qualifié pour diriger le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC).
Ce n’était pas une décision facile à prendre. Ce fut un privilège de servir au BEC au cours des 20 dernières années, y compris les neuf dernières années à titre d’enquêteur correctionnel. Comme mon prédécesseur, Howard Sapers, me l’a souvent rappelé, c’est l’emploi de rêve pour toute personne passionnée par la réforme carcérale et les droits de la personne Diriger un bureau d’ombudsman des prisons indépendant et travailler avec des professionnels dévoués pour veiller à ce que le Service correctionnel du Canada (SCC) respecte la primauté du droit et prenne des décisions justes et responsables dans l’administration des peines de ressort fédéral a été une expérience extraordinaire et enrichissante.
J’ai toujours eu l’honneur de faire des recommandations fondées sur des données probantes visant à améliorer les conditions de détention et le traitement des personnes incarcérées sous responsabilité fédérale ainsi que de celles qui purgent le reste de leur peine de ressort fédéral en liberté sous condition. Dire la vérité aux personnes au pouvoir est une responsabilité que je n’ai jamais prise à la légère C’est un élément nécessaire d’une démocratie saine. C’est un rôle stimulant, mais profondément gratifiant. Cependant, tenir le SCC responsable de la mauvaise gestion, des décisions injustes et des violations des droits de la personne n’a pas été sans conséquence.
Je suis extrêmement fier du travail que mon équipe et moi avons accompli pour fournir des services indépendants de surveillance et d’ombudsman des prisons de calibre mondial. J’ai eu l’occasion de réfléchir à ces réalisations récemment lorsque le Bureau a célébré son 50e anniversaire, en 2023. Cela inspire un grand sentiment de fierté lorsque je pense aux années accumulées que mon équipe et moi avons passées sans relâche derrière les murs de la prison et sur les lignes téléphoniques, à écouter et à répondre aux préoccupations soulevées à notre Bureau. À l’échelle systémique, nous avons mené des enquêtes importantes et, dans bien des cas, novatrices sur des enjeux couvrant un éventail de sujets et de groupes, allant des enjeux touchant les jeunes adultes aux personnes vieillissantes et mourant derrière les barreaux. Notre Résumé de Dix ans depuis Une question de spiritualité : Les questions autochtones dans les services correctionnels fédéraux, ainsi que le rapport Étude de cas sur la diversité dans les services correctionnels : l’expérience des détenus de race noire dans les pénitenciers, en particulier, illustrent l’importance de ce Bureau pour suivre les progrès réalisés à l’égard d’importants enjeux correctionnels au fil du temps et témoignent de notre persévérance à tenir le SCC responsable de problèmes de longue date. Au cours de mon mandat, mon Bureau a audacieusement soulevé des enjeux d’équité concernant les répercussions de la prise de décisions sur la vie quotidienne des personnes incarcérées, y compris la qualité de la nourriture en prison ainsi que l’augmentation du coût de la vie. Nous avons également fait preuve de leadership en nous attaquant à des enjeux plus émergents dans les services correctionnels canadiens, notamment la coercition et la violence sexuelles, ainsi que les besoins et les droits des détenus de diverses identités de genre. Nos efforts pour enquêter et formuler des recommandations dans ces domaines, entre autres, ont consisté à donner une voix à celles et ceux dont les préoccupations ne sont souvent pas entendues ou encore non traitées, à mettre en lumière les endroits les plus sombres des services correctionnels où se trouve souvent l’iniquité et, surtout, à documenter la reddition de comptes, afin que ces problèmes, dont beaucoup sont bien connus, puissent être prévenus, réduits et résolus.
Bien que nous ayons réussi à résoudre des plaintes individuelles, bon nombre de nos recommandations en matière de réforme systémique ont trop souvent été ignorées ou encore rejetées par le SCC. Au fil des ans, le ministère de la Sécurité publique et les ministres successifs ont également montré une réticence à obliger le SCC à donner suite aux recommandations du BEC, même s’il reconnaissait le bien-fondé de nos constatations. Malgré son mandat crucial et un généreux budget annuel de quelque 3,2 milliards de dollars soutenu par 19 000 employés, les services correctionnels fédéraux demeurent apparemment une faible priorité au sein du portefeuille de la Sécurité publique, qui comprend également la sécurité frontalière, les services de police et la sécurité nationale. Compte tenu de la complexité croissante du paysage mondial, je m’attends à ce que les services correctionnels fédéraux continuent de recevoir peu d’attention dans le cadre de ce programme plus large en matière de sécurité publique. C’est profondément malheureux, car le SCC a un besoin urgent d’une réforme structurelle en profondeur.
Les Canadiens ne sont pas bien servis par un système correctionnel qui est exceptionnellement coûteux et doté de ressources suffisantes selon les normes internationales, mais qui ne parvient toujours pas à atteindre les résultats correctionnels clés, en particulier pour les personnes autochtones en détention. Bien qu’il soit rassurant de savoir que le travail de mon Bureau a souvent guidé les décisions des tribunaux, les plaintes en matière de droits de la personne, les recours collectifs et les règlements préalables à des procès, de tels litiges pourraient être évités si le SCC et le gouvernement du Canada s’attaquaient de manière plus proactive à des enjeux de longue date. Une réforme importante améliorerait non seulement les résultats correctionnels et préviendrait les violations des droits de la personne, mais réduirait également les coûts financiers, sociaux et humains associés aux litiges et à la récidive.
À l’approche de mon 60e anniversaire en janvier 2026, je reconnais qu’il est temps d’avoir un nouveau leadership au BEC, quelqu’un avec une nouvelle perspective et une énergie renouvelée qui pourrait réussir là où j’ai rencontré des obstacles. Bien que ce travail me manquera profondément, j’ai hâte de prendre ma retraite et de passer plus de temps avec ma famille, ainsi que de poursuivre mes passions pour les voyages, le motocyclisme, le ski alpin et la plongée sous-marine.
Sachant qu’il s’agirait de mon rapport final, j’ai choisi de souligner un enjeu qui a défini une grande partie de ma carrière : l’accès et la qualité des soins de santé mentale dans les services correctionnels fédéraux. Ma carrière dans la fonction publique a commencé au SCC, où j’ai terminé ma thèse de doctorat en psychologie de la conduite criminelle à la Direction de la recherche du SCC. Cette base, combinée aux premiers travaux juridiques axés sur les droits de la personne dans le cadre des services correctionnels, a façonné mon cheminement professionnel et m’a permis de me concentrer sur l’importance cruciale des services de santé mentale pour les personnes incarcérées.
Le rapport annuel de cette année comprend donc les constatations de six enquêtes nationales portant sur la question de l’accès aux soins de santé mentale et de la qualité des soins de santé mentale pour les personnes purgeant une peine de ressort fédéral, y compris dans les domaines suivants :
- L’objectif général et le fonctionnement des centres régionaux de traitement (CRT) du SCC.
- Les approches pour déterminer les besoins des personnes ayant des déficits cognitifs et y répondre.
- La planification clinique de la continuité des soins dans la collectivité et la continuité des services pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale importants.
- La mise à jour concernant les rangées de suivi thérapeutique et les soins intermédiaires de santé mentale dans les prisons fédérales.
- L’évaluation et traitement des traumatismes pour les femmes purgeant une peine de ressort fédéral.
- Les services de santé mentale et de bien-être adaptés à la culture et aux traumatismes pour les personnes autochtones dans les services correctionnels fédéraux.
Pour ces enquêtes, le BEC a mené un total de 425 entrevues avec des personnes purgeant une peine de ressort fédéral, tant en détention qu’en liberté au sein de la collectivité. Nous avons également effectué des visites sur place et rencontré du personnel de l’établissement et des membres du personnel du SCC qui travaillent dans la collectivité, divers intervenants communautaires, des organisations autochtones et des autorités correctionnelles provinciales, entre autres. De plus, les enquêtes de cette année ont été renforcées par des partenariats et des experts externes, notamment le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels et le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), afin d’appuyer les enquêtes de notre Bureau sur les services tenant compte des traumatismes pour les femmes et les services pour les personnes ayant des déficits cognitifs, respectivement.
Il ne fait aucun doute que le manque d’accès à des soins de santé mentale opportuns, adéquats et appropriés est une question de droits de la personne Après avoir visité les cinq centres régionaux de traitement, dont quatre sont des hôpitaux psychiatriques désignés, il est tout à fait clair que le SCC est fondamentalement mal outillé pour fournir des soins de santé mentale de longue durée aux personnes atteintes d’une maladie mentale grave, c’est-à-dire celles qui souffrent de détresse psychiatrique aiguë, d’idées suicidaires et d’automutilation chronique.
Les constatations présentées dans ce rapport réaffirment notre position de longue date : le SCC ne devrait pas offrir de soins psychiatriques spécialisés de longue durée pour les cas aigus. Dans les cas de maladies mentales aussi graves, des transferts vers des hôpitaux psychiatriques externes, sûrs et communautaires sont nécessaires. Considérez cette analogie : le SCC transfère périodiquement des personnes nécessitant des soins physiques complexes, comme une chimiothérapie ou une chirurgie cardiaque, à des hôpitaux externes. Il serait évidemment impensable de tenter de telles procédures à l’interne. Pourtant, en matière de santé mentale, le SCC continue de fonctionner en croyant à tort qu’il est en mesure de fournir des soins psychiatriques spécialisés à l’interne.
Nos dernières découvertes soulignent que les centres régionaux de traitement peuvent être décrits comme des établissements de soins intermédiaires et gériatriques, avec une capacité limitée en matière de santé mentale d’urgence pour les cas aigus. Il convient donc de les redéfinir et de les reconnaître comme tels. Les personnes ayant des besoins psychiatriques complexes aigus et de longue durée devraient être transférées, en vertu de l’article 29 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), dans des établissements externes spécialisés capables d’offrir le niveau et la qualité appropriés de soins. Le fait de continuer à héberger ces personnes dans des centres régionaux de traitement exploités par le SCC est non seulement inefficace et inapproprié, mais c’est une violation flagrante des droits de la personne et incompatible avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)1.
Malgré des décennies d’investissement, le SCC demeure incapable de répondre aux besoins complexes en matière de santé mentale de cette population. L’annonce d’une installation de remplacement de 1,3 milliard de dollars pour le Centre régional de traitement – Atlantique (Centre de rétablissement Shepody) est, à notre avis, une profonde mauvaise affectation des ressources. Plutôt que d’investir dans un autre établissement interne du SCC, le gouvernement du Canada aurait dû demander au SCC de s’associer aux systèmes de santé provinciaux pour élargir l’accès à des lits psychiatriques sûrs au sein de la collectivité. Le SCC aurait pu financer une capacité accrue en lits grâce à des partenariats provinciaux, une approche qui serait plus humaine, rentable et durable à long terme. Les quelques 1,3 milliard de dollars alloués pourraient couvrir les coûts d’un tel modèle pour les décennies à venir2. J’exhorte donc le gouvernement à reconsidérer ses plans. Le SCC a pour mandat de fournir des services correctionnels, ainsi que les services de soins de santé, ce qui inclut les soins de santé mentale; cependant, ils ne devraient pas fournir de soins psychiatriques aigus. De même, le gouvernement fédéral ne devrait pas assumer la responsabilité de ces services de soins de santé spécialisés. Il devrait plutôt collaborer et coordonner ses efforts avec les autorités sanitaires provinciales pour s’assurer que les personnes incarcérées sous responsabilité fédérale reçoivent des soins de santé mentale opportuns et appropriés dans des milieux équipés pour fournir de tels soins. Ironiquement, le SCC et le gouvernement du Canada n’ont pas consulté mon Bureau au sujet de leurs investissements prévus. Par conséquent, l’option la plus appropriée pour réformer la prestation des soins et des services de santé mentale aigus dans les services correctionnels fédéraux n’était pas incluse : le transfert des patients atteints de maladies mentales graves vers des hôpitaux psychiatriques provinciaux externes. Cette option ne semble même pas avoir été envisagée, bien qu’il s’agisse de l’option préconisée non seulement par mon Bureau, mais aussi par le Comité sénatorial permanent des droits de la personne dans son rapport de 2021 intitulé Droits de la personne des personnes purgeant une peine de ressort fédéral. Même le projet de loi S-230 : la Loi proposant des solutions de rechange à l’isolement et prévoyant une surveillance et des mesures de réparation dans le système correctionnel (Loi de Tona) fait la promotion de l’approche consistant à transférer les personnes ayant des problèmes de santé mentale invalidants vers un hôpital externe.
Le manque de transparence et l’absence de consultations plus générales indiquent que le SCC continue de donner la priorité à ce qui est le mieux pour lui et non ce qui est le mieux pour les personnes sous sa garde ou sa surveillance. Le plan actuel enfreint les Règles Nelson Mandela et seuls des partenariats avec les établissements de santé provinciaux assureront des soins appropriés Les personnes ayant un trouble mental grave sont d’abord des patients, et non d’abord des détenus L’approche du SCC a pourtant été la dernière.
- Je recommande que les CRT du SCC soient redéfinis et officiellement reconnus comme des établissements de soins de santé mentale intermédiaires, avec une capacité limitée de gérer les cas psychiatriques d’urgence. Les personnes atteintes d’une maladie mentale grave, c’est-à-dire celles qui vivent des crises psychiatriques aiguës, des idées suicidaires persistantes ou des comportements d’automutilation chronique nécessitant des soins psychiatriques de longue durée, devraient être transférées dans des hôpitaux psychiatriques communautaires mieux adaptés à leurs besoins.
- Je recommande que le gouvernement du Canada/ministre de la Sécurité publique reconsidère son récent investissement de 1,3 milliard de dollars dans une installation de remplacement pour le CRT – Atlantique (Centre de rétablissement Shepody). Il faudrait plutôt réaffecter les efforts et le financement pour aider le SCC à réaffecter ses ressources actuelles pour faciliter le transfert des personnes atteintes de maladies mentales graves vers les hôpitaux psychiatriques provinciaux. Cela comprend le soutien à la création ou à l’expansion de lits dans les provinces faisant face à des contraintes en matière de capacité.
L’enquête de cette année sur les déficits cognitifs est à la fine pointe des services correctionnels, non seulement au pays, mais aussi à l’étranger, car c’est un domaine qui a été négligé. Cette étude a révélé qu’en raison d’une telle négligence, la prévalence des déficits cognitifs est sans doute inconnue et probablement sous-estimée. Les conséquences de cette situation se manifestent par l’absence ou l’inefficacité des approches de dépistage, d’évaluation, de programmation et de formation du personnel en ce qui concerne le travail avec les personnes ayant des déficits cognitifs. Des politiques vagues et inadaptées qui n’orientent pas adéquatement la pratique ou encore ne correspondent pas adéquatement aux réalités ou aux besoins locaux ont entraîné la stigmatisation, des problèmes de sécurité et des défis dans la vie quotidienne pour les personnes vivant avec des déficits cognitifs en prison. Ces lacunes et défis imposent un fardeau important au personnel pour qu’il cherche des solutions créatives et des occasions de se perfectionner, dans certains cas à ses frais, afin de répondre à ces pressions et à ces demandes.
Une autre innovation pour notre Bureau, notre enquête portant sur les traumatismes a révélé que, bien que presque toutes les femmes incarcérées aient vécu une forme de traumatisme dans leur vie, peu de mesures sont faites en matière de dépistage et d’évaluation, et peu de ressources spécialisées – en particulier le soutien psychologique – pour aider à s’attaquer aux causes sous-jacentes des réactions fondées sur les traumatismes. Comme on l’a constaté dans les autres enquêtes, le personnel a indiqué qu’il n’était pas suffisamment préparé à travailler efficacement et en toute sécurité avec les femmes à l’égard des causes profondes des traumatismes. Dans le même ordre d’idées, en ce qui concerne les personnes autochtones purgeant une peine de ressort fédéral, les services de santé mentale et de bien-être tenant compte des traumatismes et de la culture font cruellement défaut, malgré les besoins importants de cette population et sa surreprésentation bien documentée dans le système. Comme le Bureau l’a demandé précédemment et à maintes reprises, une décolonisation plus large du système carcéral et un transfert des soins aux organisations communautaires et aux personnes autochtones sont nécessaires pour apporter des changements importants et durables.
Malheureusement, notre examen des progrès réalisés depuis notre dernier rapport sur les rangées de suivi thérapeutique, ainsi que de l’état des choses dans les soins intermédiaires de santé mentale en général, a révélé que bon nombre des problèmes soulevés précédemment par le Bureau et le Service lui-même demeurent et que les progrès semblent stagner. Notre enquête portant sur la continuité des soins et la planification clinique de la continuité des soins dans la collectivité pour les personnes ayant de graves problèmes de santé mentale a confirmé un problème semblable de longue date : la priorité continue d’être la dotation des services correctionnels traditionnels, ce qui a entraîné une augmentation des obstacles et une érosion globale des ressources en santé mentale pour les personnes qui travaillent dans les services correctionnels et les personnes qui sont libérées dans la collectivité.
Bien que chaque enquête ait donné lieu à des constatations particulières à un sujet, étant donné le thème unificateur de la santé mentale qui traverse les six enquêtes, certaines constatations et préoccupations transversales ont également émergé, notamment les suivantes :
- Des politiques nationales faibles, vagues, désuètes et/ou absentes ont mené à une orientation et à une mise en œuvre inefficaces, déroutantes et incohérentes des services de santé mentale sur le terrain.
- La formation insuffisante proposée au personnel sur la façon de travailler efficacement et humainement avec les personnes ayant des problèmes de santé mentale (y compris celles qui ont des déficits cognitifs, des problèmes de santé mentale relatifs à l’âge et/ou des traumatismes) a contribué à une mauvaise réceptivité et à une mauvaise qualité des soins dans les services correctionnels.
- L’absence de dépistage et d’évaluation efficaces des problèmes de santé mentale a créé un effet domino de piètre identification et accès aux services, excluant ainsi de nombreuses personnes qui ont besoin de ces formes de soins améliorées.
- Les options adaptées et/ou spécialisées pour les programmes, les traitements ou les possibilités d’acquisition de compétences qui appuieraient les préparatifs en vue d’une mise en liberté couronnée de succès sont incohérentes ou ne sont pas disponibles.
- La priorité accordée aux mesures de sécurité, aux interventions (y compris le recours à la force) et aux structures physiques l’emporte sur des formes d’interaction et de prestation de soins plus dynamiques, centrées sur l’humain et thérapeutiques avec les personnes ayant des problèmes de santé mentale, créant un conflit fondamental entre le personnel de soins de santé et de sécurité, ainsi qu’entre les patients et le personnel.
Dans l’ensemble, ce rapport offre un aperçu complet des défis auxquels le SCC se heurte dans la prestation de soins de santé mentale. Malgré les critiques contenues dans le présent document, je tiens à souligner l’engagement et le professionnalisme des professionnels de la santé et du personnel de première ligne du SCC, qui font de leur mieux dans des conditions extrêmement difficiles. Au cours de nos enquêtes, ces personnes ont fourni des commentaires inestimables et francs.
Enfin, j’ai hâte de recevoir les réponses du SCC à mes recommandations dans un format approprié et transparent, conformément aux engagements pris par deux anciens ministres de la Sécurité publique. Comme le BEC le préconise depuis deux décennies, les réponses du SCC doivent indiquer clairement s’il est d’accord, en partie ou non avec chaque recommandation. Les réponses doivent être concises et décrire les mesures concrètes à prendre, ainsi que des échéanciers précis. Cela permettrait d’intégrer les réponses du SCC directement sous chaque recommandation dans le corps du rapport, comme c’est la pratique courante dans toutes les administrations pour les rapports de l’ombudsman. Cela permettra également au Bureau de mieux suivre les progrès sur une base annuelle et de rendre compte officiellement des réponses à nos recommandations en tant qu’indicateur de résultats ministériels.
Je reconnais que le SCC n’a pas toujours eu le pouvoir de répondre directement à certaines recommandations, par exemple celles qui nécessitent une nouvelle loi ou encore un financement supplémentaire. Cependant, de tels cas sont rares et le présent rapport ne contient aucune recommandation de cette nature. À mon avis, le SCC a les ressources et le pouvoir législatif, en vertu de la LSCMLC, de mettre en œuvre toutes les recommandations contenues dans le rapport de cette année Bien qu’une certaine réaffectation des ressources existantes puisse nécessiter le soutien ou l’approbation des organismes centraux, je crois que ces conditions préalables peuvent être énoncées dans les réponses du SCC.
Ivan Zinger, J.D., Ph.D.
Enquêteur correctionnel
Juin 2025
Les réponses aux recommandations
Afin d’assurer la clarté, la transparence et le responsabilité, les réponses aux recommandations du Bureau de l’enquêteur correctionnel sont intégrées tout au long du présent rapport. Chaque recommendation est suivie de l’option de réponse choisie par l’organisme ou le ministère concerné, accompagnée d’une réponse narrative décrivant les mesures prévues et les échéanciers. Les options de réponse sont définies comme suit.
Acceptée : La recommandation est entièrement acceptée et sera mise en œuvre comme indiqué.
Acceptée en partie : La recommandation est partiellement acceptée; certains aspects seront mis en œuvre, tandis que d’autres ne seront pas.
Acceptée en principe : La recommandation et les conclusions sous-jacentes sont d’accord en général; cependant, d’autres mesures sont nécessaires avant que l’agence puisse s’engager à la mise en œuvre (p. ex. mener des consultations, obtenir le financement). Ceci est donc une acceptation conditionelle, reconnaissant qu’une discussion et un suivi plus approfondis avec le BEC sont nécessaires.
Rejeté : La recommandation n’est pas acceptée et ne sera pas mise en œuvre.
- Je recommande que les CRT du SCC soient redéfinis et officiellement reconnus comme des établissements de soins de santé mentale intermédiaires, avec une capacité limitée de gérer les cas psychiatriques d’urgence. Les personnes atteintes d’une maladie mentale grave, c’est-à-dire celles qui vivent des crises psychiatriques aiguës, des idées suicidaires persistantes ou des comportements d’automutilation chronique nécessitant des soins psychiatriques de longue durée, devraient être transférées dans des hôpitaux psychiatriques communautaires mieux adaptés à leurs besoins.
Réponse du SCC : REJETÉ
Reconnaissant la nécessite de veiller à ce que les détenus aient accès aux services de soins de santé requis, le Service correctionnel du Canada (SCC) s’est doté d’un système de santé et d’un modèle de prestation de services qui lui permet d’offrir des services en fonction du niveau des besoins.
Pour répondre aux besoins en santé des détenus, les centres régionaux de traitement du SCC offrent un éventail de services en matière de soins psychiatriques en milieu hospitalier et de soins intermédiaires en santé mentale. Des soins psychiatriques en milieu hospitalier sont offerts aux détenus ayant d’importants besoins en santé mentale qui doivent être loges dans un milieu hospitalier offrant des soins de santé 24 heures sur 24. Des soins intermédiaires en santé mentale sont offerts aux détenus qui ont des besoins plus importants que ceux pouvant être satisfaits au moyen de soins primaires dans les établissements réguliers du SCC selon une évaluation de leur niveau de fonctionnement. Des soins intermédiaires en santé mentale sont offerts dans certains établissements du SCC et dans les centres régionaux de traitement, selon les besoins établis et le niveau de traitement requis. À l’heure actuelle, un grand nombre de centres régionaux de traitement offrent des services axés sur la prestation de soins intermédiaires en santé mentale Les services de santé du SCC, dont les centres régionaux de traitement, sont agréés par Agrément Canada, le même organisme qui agrée les hôpitaux et les autres fournisseurs de services dans toutes les collectivités du pays.
En complément de ses services internes de soins psychiatriques en milieu hospitalier, le SCC a conclu un partenariat avec l’Institut Philippe-Pinel de Montréal pour la prestation de soins psychiatriques en milieu hospitalier aux hommes et aux femmes incarcères qui répondent aux critères d’admission de l’établissement. Le SCC poursuivra ses efforts de mobilisation dans le but de conclure des partenariats avec d’autres hôpitaux psychiatriques provinciaux en vue d’accroitre sa capacité de prestation de soins psychiatriques en milieu hospitalier. Ces efforts seront consentis en reconnaissance du fait que les établissements de soins de santé provinciaux disposent d’une capacité limitée pour fournir des soins aux détenus sous responsabilité fédérale, et surtout pour admettre ceux qui ont des besoins complexes en matière de santé et de sécurité.
Malgré la poursuite de ses efforts de mobilisation et pour veiller à ce qu’il soit toujours en mesure de s’acquitter de son mandat législatif de fournir des soins de santé essentiels aux détenus, le SCC doit maintenir une capacité cruciale pour assurer la prestation de soins psychiatriques en milieu hospitalier dans ses centres régionaux de traitement. Le SCC a entrepris un examen exhaustif de ses centres régionaux de traitement pour établir une référence normalisée en matière de prestation de services. L’examen permettra entre autres de s’assurer que les services fournis répondent aux besoins en santé des délinquants sous la responsabilité du SCC et qu’une combinaison adéquate de soins psychiatriques en milieu hospitalier, de soins intermédiaires en santé mentale et de soins médicaux de courte durée est offerte.
Prochaine étape : Le SCC a entrepris un examen des centres régionaux de traitement pour établir une référence normalisée en matière de prestation de services.
Échéancier : Exercice 2026 à 2027
- Je recommande que le gouvernement du Canada/ministre de la Sécurité publique reconsidère son récent investissement de 1,3 milliard de dollars dans une installation de remplacement pour le CRT – Atlantique (Centre de rétablissement Shepody). Il faudrait plutôt réaffecter les efforts et le financement pour aider le SCC à réaffecter ses ressources actuelles pour faciliter le transfert des personnes atteintes de maladies mentales graves vers les hôpitaux psychiatriques provinciaux. Cela comprend le soutien à la création ou à l’expansion de lits dans les provinces faisant face à des contraintes en matière de capacité.
Réponse de la Sécurité publique : REJETÉ
Le Centre d’excellence en santé situé à Dorchester, au Nouveau-Brunswick sera un établissement de soins de santé moderne, bilingue et construit à cet effet, qui aidera le SCC à faire progresser son modèle de soins de santé centré sur le patient et qui établira la norme en matière de soins de santé dans des services correctionnels fédéraux. Il permettra à le SCC d'augmenter le nombre de lits disponibles afin de mieux répondre aux besoins de santé d'une population carcérale de plus en plus diverse et complexe, tant au niveau des soins hospitaliers qu'au niveau des soins intermédiaires de santé mentale. Il permettra également de fournir des soins à des segments uniques de la population carcérale, notamment ceux qui ont des problèmes de mobilité, ceux qui ont besoin de soins 24 heures sur 24, les femmes et les personnes âgées. Cet établissement est nécessaire pour répondre aux besoins des détenus affectés par des problèmes de santé mentale à court et à long terme.
Le SCC s'engage avec des hôpitaux externes à négocier des partenariats afin d'améliorer sa capacité à traiter les personnes ayant des besoins plus complexes en matière de santé mentale. Les admissions dans les établissements de soins de santé externes sont basées sur un processus d'orientation standardisé, initié par le SCC, pour répondre à des besoins cliniques spécifiques. Ils sont volontaires et nécessitent un consentement informé. Il est important de noter que le SCC ne peut pas obliger les hôpitaux externes à établir des partenariats avec le SCC.
En 2024, le SCC s'est engagé à collaborer avec les hôpitaux psychiatriques médico-légaux afin d'explorer les possibilités d'établir des mémorandums d'entente pour l'évaluation de la santé mentale, le traitement et les soins hospitaliers pour les patients détenus du SCC. Les services de santé ont contacté 11 hôpitaux externes et tous, à l'exception d'un seul, ont refusé d'établir un partenariat pour la fourniture de lits psychiatriques externes à ce temps-là. Un hôpital externe a indiqué qu'il serait ouvert à des discussions futures sur l'établissement d'un tel partenariat.
Cela dit, le développement du Centre d'excellence en santé n'est pas poursuivi à l'exclusion de l'engagement continu du SCC en matière de partenariat. Les services de santé du SCC continuent de se concentrer sur les partenariats dans plusieurs domaines clés : l'accès aux lits d'hôpitaux communautaires, y compris les lits de psychiatrie légale ; les services de soins de santé externes pour répondre aux besoins spécifiques en matière de soins de santé, et les soins spécialisés pour les sous-groupes vulnérables (par exemple, les soins aux détenus plus âgés, les soins aux détenus de genre divers).
Le SCC continuera de s'assurer que les personnes dont il s'occupe bénéficient de soins de la plus haute qualité, et conformes aux normes communautaires.
Message de la directrice exécutive
C’est avec une profonde gratitude et un profond optimisme que j’assume le rôle de directrice exécutive du Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada. Je suis honorée de me joindre à une équipe de professionnels dévoués qui travaillent sans relâche pour maintenir l’équité et le traitement humain au milieu du système correctionnel fédéral.
Je remercie chaleureusement notre directrice exécutive sortante, Monette Maillet, pour son leadership exceptionnel Ses contributions ont laissé un héritage durable, qu’il s’agisse de stabiliser l’effectif, de moderniser les systèmes et de réduire l’arriéré, d’orienter le Bureau vers la conformité aux normes internationales et de renforcer notre capacité à répondre aux besoins des personnes que nous servons. Son leadership a eu des répercussions durables et importantes sur le Bureau.
En tant qu’avocate spécialisée dans les droits de la personne, j’ai passé ma carrière à faire progresser la réconciliation, la justice, l’équité et la responsabilité. Mon expérience m’a enseigné que la sécurité publique et les droits de la personne ne sont pas incompatibles, mais qu’ils sont en réalité profondément relatifs. Je suis ravie de travailler aux côtés de cette équipe incroyable, en mettant en commun nos connaissances et nos expériences diverses pour renforcer nos efforts et veiller à ce que les personnes purgeant des peines de ressort fédéral soient traitées avec dignité, équité et humanité. Je suis fière de souligner certaines des réalisations de l’équipe.
Au cours de la dernière année, le Bureau a reçu 4 352 plaintes de personnes purgeant une peine de ressort fédéral, chacune représentant une voix qui mérite d’être entendue et une préoccupation importante. Nous avons passé plus de 96 000 minutes au téléphone et 433 jours à l’intérieur des établissements correctionnels, des efforts qui reflètent la compassion et le dévouement de notre équipe, ainsi que l’importance d’être présent, d’écouter et de réagir de manière significative.
En réponse aux besoins changeants de celles et de ceux que nous servons, le Bureau a fait d’importants progrès cette année. Grâce à la méthode allégée, nous avons amélioré l’efficacité de nos processus opérationnels et de règlement préventif, ce qui nous a permis d’intervenir plus rapidement et plus efficacement. Le Bureau a mis sur pied des équipes d’enquête spécialisées qui accordent la priorité aux visites en tandem dans les établissements afin d’assurer la cohérence et une surveillance accrue, dans le but d’acquérir des connaissances spécialisées, une collaboration solide et des résultats opérationnels de meilleure qualité. Enfin, nous avons mis en place un processus de triage pour les cas de recours à la force afin de simplifier le flux de travail et de donner la priorité aux examens les plus urgents et les plus critiques avec une affectation efficace des ressources.
Le Bureau a élargi son engagement au pays et à l’étranger en échangeant les pratiques exemplaires, en apprenant des autres et en établissant des relations qui contribuent à améliorer la surveillance correctionnelle dans le monde entier. Notre travail avec les titulaires de droits et les organisations autochtones a été particulièrement important, guidant l’élaboration continue d’une stratégie autochtone dédiée qui reflète notre profond engagement envers la réconciliation et la lutte contre les inégalités systémiques auxquelles font face les personnes autochtones sous responsabilité fédérale. Nous avons participé à des conversations clés lors de comités parlementaires et de conférences, contribuant à des discussions critiques qui façonnent les politiques de justice pénale du Canada et influencent la façon dont les droits des personnes incarcérées sont protégés.
Lorsque je me suis joint au BEC, j’ai rencontré chaque membre du personnel pour connaître son point de vue sur ce qui allait bien au bureau et sur ce que nous devions améliorer. J’étais reconnaissante de recevoir des commentaires ouverts, honnêtes et réfléchis.
À un niveau élevé, j’ai entendu que nos employés appréciaient la confiance que le bureau leur accorde pour effectuer leur travail de façon efficace. Ils apprécient également la souplesse et la compréhension accordées aux employés par leurs gestionnaires Le mandat de l’organisation est essentiel et leur donne un sens d’un but à atteindre Beaucoup estiment qu’il y a une bonne collégialité au sein de l’équipe et qu’ils peuvent avoir des conversations ouvertes et honnêtes entre eux et avec la direction. Les membres du personnel apprécient également que la direction ait une politique de porte ouverte.
Parmi les défis que j’ai entendus, mentionnons le volume et le contenu difficile du travail qui ont accru un risque d’épuisement professionnel de certaines positions. En outre, puisqu’il s’agit d’une micro-agence, les possibilités d’avancement sont limitées et les employés estiment que trop peu d’attention est accordée à leur croissance professionnelle et à leur progression de carrière. J’ai également entendu qu’il existe un besoin d’une communication interne améliorée, des pratiques d’accueil cohérentes, une formation spécifique à l’emploi et une concurrence plus transparente pour les emplois. Il est devenu évident qu’il s’agissait d’une période de transition importante pour l’organisation, qui a vu un roulement de 50 % de l’équipe de direction, que ce soit à la suite de départs à la retraite ou de départs. De plus, l’enquêteur correctionnel a partagé son intention de prendre sa retraite au cours du prochain exercice. Notre personnel, comme d’autres employés de la fonction publique, ont augmenté leur présence au bureau tout en prenant en considération leurs déplacements, le temps passé dans les établissements et leurs besoins en matière de logement.
Le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de 2024 est conforme à ces commentaires et nous prenons ceux-ci au sérieux. Après avoir avisé l’enquêteur correctionnel, nous avons convenu que nous chercherions une ressource externe pour aider l’organisation à répondre de manière exhaustive aux préoccupations partagées au cours mes entrevues et suite au SAFF. Cela nous permettra d’avoir un plan d’action solide avec des échéanciers raisonnables pour effectuer des changements organisationnels avant le départ de l’enquêteur correctionnel actuel.
Depuis que j’ai assumé ma nouvelle fonction en tant que directrice exécutive en mi-janvier 2025, l’enquêteur correctionnel, l’équipe de gestion et moi-même avons amorcé plusieurs changements en réponse à ce que nous avons entendu. Des ententes de rendement ont été complétées pour l’équipe et quatre processus de sélection annoncés ont été lancés. Au moins deux de ces processus comprenaient des membres externes du conseil d’administration ainsi que des conseils externes en ressources humaines. Nous avons commencé à créer un manuel de procédures consolidé pour nous assurer que tous les membres du personnel opérationnel ont accès à des renseignements complets et à jour qui les aideront dans leur travail. L’équipe des services corporatifs est maintenant entièrement dotée en personnel et nous avons lancé un exercice pour renouveler nos politiques en matière de ressources humaines. Les nouveaux employés travaillent en équipe ou sont jumelés à un « copain » pour s’assurer qu’ils ont une ressource dédiée pour les soutenir en plus de leur gestionnaire et d’autres collègues. Nous continuons d’autoriser deux enquêteurs à se rendre ensemble dans les établissements autant que possible conformément aux normes internationales, mais aussi pour soutenir leur bien- être compte tenu du travail difficile qu’ils accomplissent. En outre, nous lancerons un comité sur l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité (IDÉA) au cours des prochains mois ainsi qu’une campagne d’auto-déclaration. Nous travaillerons avec un consultant pour aider à élaborer une architecture de gestion de l’information, ce qui ouvrira la voie à un nouveau système de gestion des documents pour but d’éliminer un certain nombre d’irritants dans la façon dont nous organisons, entreposons et accédons à nos documents. Nous avons également doté un poste dédié aux communications pour améliorer nos communications internes et externes avec le personnel et les parties prenantes, ainsi que pour soutenir une sensibilisation et un engagement plus proactifs et cohérents.
Le BEC demeure déterminé à en faire un excellent milieu de travail avec des mesures concrètes dans un délai raisonnable.
Alors que nous nous préparons à une transition à la direction au cours de l’année à venir, je tiens à féliciter sincèrement Dr. Ivan Zinger pour sa carrière exceptionnelle au BEC et dans la fonction publique fédérale. J’ai hâte de continuer à travailler avec lui et d’apprendre de lui pendant cette période de changement et de croissance. Ce moment est une occasion précieuse de réfléchir, de se renouveler et de bâtir sur les bases solides qui ont été posées, alors que nous peaufinons nos travaux d’enquête, de politiques et de recherche et continuons à faire avancer notre mandat.
Je suis reconnaissante d’avoir l’occasion de miser sur nos forces collectives et de contribuer à façonner un système correctionnel plus humain et responsable.
Aucun de ces progrès ne serait possible sans le travail incroyable de notre équipe. Que ce soit dans les services corporatifs, le règlement préventif, les opérations, les politiques et la recherche, nos portefeuilles spécialisés ou notre équipe d’examen du recours à la force, chaque personne ici joue un rôle essentiel. Vos connaissances, votre intégrité et votre engagement sont ce qui fait la force du Bureau.
Valerie Phillips
Directrice exécutive
Enquêtes systémiques nationales
Les centres régionaux de traitment en crise : l’érosion des soins de santé mentale dans les services correctionnels fédéraux
Dans le rapport annuel de 2023-2024 du Bureau, nous avons examiné les circonstances qui ont mené au décès tragique de M. Stéphane Bissonnette, un homme de 39 ans qui, en décembre 2021, est décédé dans une cellule d’observation alors qu’il faisait l’objet d’une surveillance modifiée au Centre régional de traitement (CRT) rattaché à l’Établissement de Millhaven. En plus d’avoir passé une grande partie de sa peine en isolement préventif dans des établissements à sécurité maximale, M. Bissonnette a également été placé dans divers centres régionaux de traitement partout au pays.
L’enquête portant sur le décès de M. Bissonnette a révélé un degré important de dysfonctionnement à l’Établissement de Millhaven, y compris des lacunes structurelles, opérationnelles et politiques. Le Bureau a relevé une multitude de problèmes systémiques relatifs à son passage à plusieurs CRT, aux événements qui ont mené à sa mort, au Comité national d’enquête du SCC (CNE) qui a été convoqué par la suite et aux constatations découlant du CNE lui-même. La nécessité d’examiner en profondeur le fonctionnement de ces installations à un niveau plus large et plus systémique était évidente.
Contexte
En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), le SCC est tenu de fournir aux personnes purgeant une peine de ressort fédéral des soins de santé essentiels et un accès raisonnable à des soins de santé et de santé mentale non essentiels qui contribueront à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale réussie. Lorsque des soins sont fournis, la LSCMLC stipule que le Service doit promouvoir la prise de décisions fondées sur les critères de soins médicaux, dentaires et de santé mentale appropriés. Pour s’acquitter de cette obligation, le SCC exploite cinq centres régionaux de traitement (CRT) au Canada qui offrent une évaluation clinique et un traitement en milieu hospitalier aux personnes purgeant une peine de ressort fédéral souffrant de problèmes de santé mentale graves en phase aiguë et/ou chronique. Le rôle principal des CRT est de fournir des services spécialisés de « nature limitée dans le temps » afin de stabiliser les personnes avec l’attente que les patients, le cas échéant, retournent à leur établissement « parent » avec un plan de continuité des soins.
Les centres de traitement présentent une dynamique unique en ce sens qu’ils sont des établissements « hybrides », c’est-à-dire des hôpitaux psychiatriques guidés en partie par la législation provinciale sur la santé, fonctionnant dans un milieu carcéral de ressort fédéral assujetti à la LSCMLC. Tous les centres régionaux de traitement, à l’exception du Centre psychiatrique régional (CPR) de la région des Prairies, sont des établissements co-implantés, situés dans des établissements pénitentiaires plus grands. Certains de ces établissements sont intégrés à des pénitenciers existants, tandis que d’autres centres régionaux de traitement se trouvent dans des bâtiments réaménagés ou convertis.
Tableau 1. Liste des centres régionaux de traitement (CRT) avec une capacité nominale de lits et un aperçu du nombre réel (2024)
| CRT ET EMPLACEMENT | ÉTABLISSEMENT CO-IMPLANTÉ | CAPACITÉ NOMINALE | DÉNOMBREMENT RÉEL |
|---|---|---|---|
|
CRT Ontario, qui comprend :
CRT de Bath CRT de Millhaven |
Établissement de Bath Établissement de Millhaven |
36 90 |
36 89 |
| CRT Pacifique (Abbotsford, Colombie-Britannique) | Établissement du Pacifique | 168 | 129 |
| Centre psychiatrique régional (Saskatoon, Saskatchewan) | S.O. – Installation autonome |
184 hommes /
20 femmes |
145 hommes /
9 femmes |
| Centre régional de santé mentale (Sainte-Anne-desPlaines, Québec) | Établissement Archambault | 119 | 83 |
| Centre de rétablissement Shepody (Dorchester, Nouveau-Brunswick) | Pénitencier de Dorchester | 38 | 42 |
| Total |
635 hommes /
20 femmes |
524 hommes /
9 femmes |
Source. Extrait du Système intégré de rapports – Modernisé (SIR-M) le 11 juillet 20243.
En plus de ces installations, l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel (INPLPP) de Montréal, au Québec, compte cinq lits financés par le SCC pour les hommes et 15 lits pour les femmes, ce qui porte la capacité totale à 640 lits et 35 lits, respectivement pour les hommes et les femmes. Comme nous le verrons plus loin dans cette section, bon nombre de ces lits sont occupés par des patients gériatriques ou des personnes en situation de handicap et des personnes nécessitant des soins intermédiaires, qui peuvent ne pas répondre aux critères du SCC pour un lit psychiatrique.
Nominalement, les CRT relèvent du Secteur des services de santé du SCC et sont dirigés par un directeur exécutif. En pratique, les directeurs exécutifs travaillent en étroite collaboration et ont une responsabilité aux directeurs de l’établissement (dans un établissement co-implanté) et aux Services de santé (aux niveaux régional et national), ce qui donne lieu à une structure hiérarchique déroutante. Dans la politique, les CRT sont classés comme des établissements à sécurité à multiples niveaux, ce qui signifie que les patients assignés à un niveau de sécurité du délinquant (NSD) compatible avec la sécurité minimale, moyenne ou maximale peuvent tous être hébergés dans le même établissement. Selon la Directive du commissaire (DC) 706 – Classification des établissements, les mesures de sécurité du CRT devraient dépendre de la classification de la personne, tandis que le temps passé par le patient au CRT devrait refléter son niveau de sécurité et être conforme à ses plans correctionnels et de traitement.
Désignation en tant qu’établissement psychiatrique
Toutes les unités du CRT, sauf une, sont des établissements psychiatriques « désignés ». Bien que les définitions particulières puissent varier, la désignation fait référence à la reconnaissance officielle d’un établissement comme centre psychiatrique ou de santé mentale par le gouvernement provincial où se trouve le CRT. Dans certaines provinces, le ministre de la Santé détient le pouvoir législatif de désigner des établissements psychiatriques ou de santé mentale, tandis que les services requis pour la désignation peuvent également varier d’une province à l’autre (par exemple, un ou plusieurs des services suivants peuvent être nécessaires pour être admissibles : soins infirmiers psychiatriques autorisés, stabilisation d’urgence, observation, services de réadaptation, soins aux patients hospitalisés ou externes, etc.). Cet écart des besoins soulève des préoccupations quant à l’uniformité de la qualité des soins de santé mentale entre les provinces, car certaines administrations peuvent avoir des attentes plus élevées en matière de services. Une aberration, le Centre régional de santé mentale (CRSM) de l’Établissement Archambault n’est pas désigné comme un « hôpital » en vertu de la législation provinciale en raison de son cadre législatif, une différence notable qui met en évidence les lacunes juridiques et administratives potentielles qui ont une incidence sur la relation entre les établissements fédéraux dans les systèmes provinciaux de soins de santé mentale.
Bien que le SCC n’ait pas été en mesure de fournir une date exacte à laquelle les CRT individuels ont été désignés conformément à leur législation provinciale respective, il a été suggéré que cela s’est produit en réponse à l’adoption de la Loi canadienne sur la santé (1984), qui a permis à tous les résidents admissibles du Canada d’avoir accès à des services de santé assurés sans obstacle financier ou autres, et en vertu de laquelle les personnes purgeant une peine de ressort fédéral ont été estimées inadmissibles. La Loi sur les pénitenciers, qui couvrait auparavant la prestation de services de santé aux détenus, a été remplacée par l’adoption de la LSCMLC en 1992, ce qui a entraîné un effort du Service pour maintenir la parité avec les normes communautaires et mettre l’accent sur les services de santé et de santé mentale centralisés.
Lorsqu’il demande la désignation d’un établissement particulier, le SCC doit généralement présenter une demande au ministère de la Santé provincial respectif. Chaque ministère peut examiner des éléments comme l’infrastructure, les modèles de dotation, l’emplacement et la façon dont les soins sont fournis. Le processus de demande est habituellement dirigé par le directeur régional des Services de santé (DRSS) de chaque région et signé par le commissaire.
Notamment, une fois qu’une province a désigné un établissement particulier, il n’y a pas d’autres évaluations ou mécanismes continus pour s’assurer que les services adéquats sont fournis pour maintenir la désignation. Les centres régionaux de traitement n’ont pas à présenter une nouvelle demande pour conserver leur désignation et, dans presque tous les cas, la maintiendront jusqu’à ce qu’un établissement doive déménager physiquement. Par exemple, à la suite de la fermeture du centre régional de traitement situé dans le pénitencier de Kingston, un établissement4 désigné à l’annexe 1, et du déplacement subséquent des patients jusqu’à leur transfert possible aux établissements de Bath et Millhaven (CRT Ontario), une nouvelle demande était requise auprès du ministère de la Santé de l’Ontario. Le personnel du SCC a indiqué que, par conséquent, l’agrément est le mécanisme le plus souvent utilisé pour mesurer le respect des normes de santé dans ces établissements. Même dans le cas de tribunaux comme la Commission du consentement et de la capacité de l’Ontario, par exemple, se prononçant sur la certification de patients afin de recevoir des soins contre leur gré, la désignation d’établissements individuels n’est pas remise en question.
Outre la désignation, les services de santé fournis par le SCC, y compris les soins de santé mentale, sont assujettis à l’agrément d’Agrément Canada, un organisme indépendant à but non lucratif chargé de veiller à ce que ces services respectent certaines normes de qualité et de sécurité. Ces normes, créées en consultation avec un large éventail de représentants, sont élaborées par l’Organisation de normes en santé (HSO), également une entité à but non lucratif, et constituent la fondation du processus d’agrément. Le SCC a demandé à l’agent de HSO d’élaborer une Norme nationale du Canada pour les établissements correctionnels, qui a ensuite été intégrée à son programme d’agrément. Selon HSO, la nouvelle norme, HSO 34008:2018 (E) Services de santé du Service correctionnel du Canada, est précisément conçue pour répondre aux besoins des établissements correctionnels fédéraux, en reconnaissant le lien entre le bien-être des personnes incarcérées et leurs droits de la personne (HSO, 2024)5.
En général, le respect des normes d’agrément est un point de référence clé pour les hôpitaux et les établissements psychiatriques afin de s’assurer que les lacunes sont relevées et que les services fournis aux patients sont conformes aux normes professionnelles, dans un but d’amélioration continue.
Pour rejeter les critiques légitimes des prisonniers concernant l’accès limité et la qualité des soins de santé mentale, le SCC a utilisé à maintes reprises l’agrément comme bouclier pour répondre à ces préoccupations. L’agrément est important, mais ne devrait jamais servir de bouclier – l’agrément n’établit pas, par exemple, de normes sur la pratique appropriée du patient ou du professionnel de la santé mentale et sur le niveau minimal de soins de santé mentale. Le Service des communications du SCC ne devrait jamais utiliser l’accréditation pour écarter des préoccupations légitimes.
Profil de la population des CRT
Dans un profil de 2024 des patients en santé mentale6, le SCC a fourni les renseignements démographiques suivants pour les 498 patients en détention dans tous les CRT (voir le tableau 2). Selon leurs données, la grande majorité des patients des CRT sont des hommes (98 %), plus du tiers s’identifient comme autochtones (34 %) et la majorité est classée comme étant à sécurité moyenne ou maximale (62 % et 24 %, respectivement). En ce qui concerne les diagnostics, 86 % des personnes des CRT avaient au moins un diagnostic de santé mentale, le plus courant étant la schizophrénie (46 %), suivie de la dépression (15 %), du trouble anxieux et des troubles relatifs à la consommation d’opioïdes (12 % respectivement).
Tableau 2. Profil démographique et diagnostique des patients des CRT (n = 498)
| Nbre | % | |
|---|---|---|
| Genre | ||
| Homme | 487 | 98 |
| Femme | 11 | 2 |
| Race | ||
| Blanche | 248 | 50 |
| Autochtone | 167 | 34 |
| Noire | 32 | 6 |
| Autres | 51 | 10 |
| Cote de sécurité | ||
| Sécurité maximale | 118 | 24 |
| Sécurité moyenne | 310 | 62 |
| Sécurité minimale | 45 | 9 |
| Aucune cote | 25 | 5 |
| Diagnostics de santé mentale | ||
| Schizophrénie | 227 | 46 |
| Dépression | 77 | 15 |
| Trouble anxieux | 59 | 12 |
| Trouble lié à l’utilisation d’opioïdes | 58 | 12 |
| Trouble de la personnalité limite | 40 | 8 |
| Trouble de stress post-traumatique | 40 | 8 |
| Démence | 26 | 5 |
| Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale | 21 | 4 |
Remarque. Le nombre de diagnostics dépasse le total, car les personnes peuvent avoir plus d’un diagnostic.
Rapports précédents sur les CRT
Bien que le Bureau n’ait pas examiné les CRT en profondeur avant les enjeux soulevés par l’enquête Bissonnette, nous avions déjà soulevé plusieurs préoccupations concernant leur objectif général et leurs critères d’admission il y a plus de dix ans7. Au cours des dernières années, le Bureau a signalé des problèmes relatifs à l’usage excessif de la force dans les CRT, recommandant un examen des pratiques et des protocoles de sécurité afin d’assurer un environnement clinique plus favorable. Plus particulièrement, le rapport annuel de 2017-2018 du Bureau a fourni un résumé des constatations d’un examen d’expert indépendant mené par le psychiatre légal, le Dr John Bradford8 Parmi les constatations du Dr Bradford, mentionnons le manque de formation adéquate du personnel travaillant avec les patients nécessitant des services de psychiatrie légale, le mépris total de la sélection du personnel correctionnel approprié pour travailler dans ce type d’environnement, l’infrastructure problématique, les mauvais outils d’évaluation et critères d’admission, et le problème croissant de répondre aux besoins des patients vieillissants. Dans l’ensemble, le Dr Bradford a conclu que l’infrastructure, la dotation en personnel et les modèles opérationnels en place dans les CRT à l’époque ne répondaient pas adéquatement aux besoins complexes des patients des CRT.
Compte tenu de ces constatations, des problèmes importants soulevés dans le rapport annuel de l’an dernier et de l’accent thématique mis sur la santé mentale pour cette année, un examen complet de ces CRT à un niveau plus large et plus systémique était nécessaire.
Enquête en cours
Pour l’enquête actuelle, j’ai demandé à mon personnel d’effectuer un examen approfondi des centres régionaux de traitement du SCC. De nombreux domaines d’intérêt ont été explorés, y compris, mais sans s’y limiter, la structure de gouvernance, la sélection et la formation du personnel, la dynamique entre la sécurité et les soins de santé, la qualité des soins de santé mentale, l’infrastructure, les défis du modèle « hybride », les décès en établissement et les CNE connexes, ainsi que des exemples de pratiques prometteuses. Nous avons utilisé diverses méthodes d’enquête et nous nous sommes appuyés sur de multiples sources, notamment:
- des inspections sur place de chacun des cinq CRT, y compris mes propres visites;
- des visites dans d’autres hôpitaux médico-légaux et établissements de traitement provinciaux9;
-
des entrevues avec 150 employés actuels et anciens du SCC, des intervenants
externes et des patients;
- Les entrevues avec le personnel du SCC ont porté principalement sur des cadres supérieurs et intermédiaires du CRT, des professionnels de la santé mentale et des services de santé, ainsi que du personnel de première ligne de la santé et des opérations. Dans le cas des pénitenciers qui sont des établissements co-implantés, les cadres supérieurs ont également été interviewés;
- des examens de la littérature, des données et des instruments de politique du SCC relatifs aux CRT et à la santé mentale.
Au total, 12 membres du BEC ont appuyé les efforts de l’enquête actuelle, qui a été renforcée par la participation d’un expert externe en la matière, ancien psychologue et enquêteur national du SCC. À la suite de ces efforts, les constatations suivantes ont été relevées :
- Une infrastructure désuète et inappropriée pour un milieu hospitalier psychiatrique et thérapeutique.
- Les CRT sont devenus des centres de détention pour le nombre croissant de personnes âgées et en situation de handicap derrière les barreaux.
- Les mesures de sécurité ont préséance sur la prestation de soins de santé physique et mentale.
- La dépendance excessive à l’usage de la force à l’endroit des patients, y compris l’utilisation inquiétante d’un agent organique inflammatoire comme moyen d’interrompre l’automutilation.
- La faiblesse de la structure de gouvernance et l’absence de politique nationale entraînent une confusion des rôles et l’affaiblissement de la prise de décisions cliniques par les professionnels de la santé mentale.
- Le manque de spécialisation requise dans le cadre du recrutement, de la sélection et de la formation du personnel.
- La « stabilisation » des symptômes comportementaux de la santé mentale semble être l’objectif primordial des CRT co-implantés.
- Selon un examen des CNE, le SCC a systématiquement omis de tirer des leçons ou de prévenir de nombreux incidents graves et décès.
- L’absence marquée de défenseurs des droits des patients dévoués dans les CRT empiète sur les droits et les besoins de ces patients.
Nos constatations ont révélé que les problèmes et les préoccupations de longue date soulevés par le Bureau et le Dr Bradford sont toujours présents aujourd’hui. De plus, dans le contexte d’une population vieillissante et de plus en plus complexe, les conditions se sont sans doute exacerbées depuis le dernier rapport sur les CRT. Ces établissements ne sont pas en mesure d’offrir des soins hospitaliers psychiatriques spécialisés, en particulier aux personnes ayant de graves besoins en santé mentale et physique. Au mieux, ils offrent ce que l’on attend de niveaux intermédiaires de soins à des fins de stabilisation, et non de traitements ou de soins à long terme. Bien qu’ils soient appelés centres régionaux de traitement (CRT), ces établissements sont essentiellement des pénitenciers offrant des services psychiatriques avec une capacité limitée pour les soins d’urgence. Aucun des CRT n’est à la hauteur de son nom et ne peut être estimé comme un véritable hôpital psychiatrique.
Constatations
1. Infrastructure désuète et inappropriée pour un hôpital psychiatrique et un milieu hospitalier thérapeutique
La majorité des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête se sont fait poser une question fondamentale : cet établissement est-il une prison ou un hôpital? D’un point de vue environnemental, cette réponse n’est que trop évidente. Dans l’ensemble, ces centres ne sont pas différents de ceux des autres établissements fédéraux. Comme l’a indiqué un directeur d’établissement : « Lorsque vous vous promènerez dans l’établissement, je vous laisserai en juger par vous-même. »
De plus, une grande partie du personnel a soulevé l’âge et la conception de l’infrastructure lorsqu’on leur a demandé quels étaient les plus grands défis auxquels ils faisaient face dans la prestation de services dans un centre de traitement correctionnel. Le Centre de rétablissement Shepody, par exemple, se trouve à l’intérieur des murs du Pénitencier de Dorchester, construit en 1880 en tant qu’établissement à sécurité maximale et actuellement le deuxième plus ancien pénitencier canadien en activité. Par conséquent, les patients psychiatriques sont confinés dans des unités bordées de cellules exiguës et à barreaux, offrant un espace limité pour les traitements et les programmes. Le personnel de la santé qui est responsable de la tenue de dossiers et discute des cas des patients doit le faire dans des modules de contrôle encombrés, à quelques mètres des agents correctionnels. Mis à part les préoccupations relatives à la protection de la vie privée, cette proximité symbolise l’influence constante du personnel de sécurité sur les disciplines de la santé et de la santé mentale dans chacun des centres régionaux de traitement.
Le Centre régional de santé mentale (CRSM), par exemple, fait partie de l’Établissement Archambault, construit à l’origine comme un établissement à sécurité maximale. Le CRT (Ontario) comprend deux unités distinctes de 96 lits, l’une sur le terrain de l’Établissement de Bath (sécurité moyenne) et l’autre à l’Établissement de Millhaven (sécurité maximale). Comme le Bureau l’a déjà signalé, la conception de ces unités se trouve dans de nombreux établissements, car cela se prête à la commodité d’un appel d’offres et d’une construction rapides. Ailleurs, ce modèle de « copier-coller » a été réutilisé pour inclure les unités d’intervention structurée, les rangées de suivi thérapeutique, les rangées de sécurité maximale intégrées et non-intégrées et les rangées de transition. Comme dans chacune de ces autres applications, les CRT qui utilisent cette conception manquent d’espace suffisant pour fournir des interventions cliniques, des programmes, de l’éducation et des services aux Autochtones Comme l’a décrit un directeur d’établissement : « Lorsque vous placez des patients dans une unité de 96 personnes et que vous l’appelez un centre de traitement, ce n’est pas correct. Ce n’est pas du tout propice à un environnement thérapeutique. ».
Même le seul CRT autonome et construit à cet effet, le Centre psychiatrique régional, à Saskatoon, qui occupe une propriété louée de l’Université de la Saskatchewan, n’est pas à l’abri des installations traditionnelles d’un établissement à haute sécurité. Des barbelés tapissent désormais la cour intérieure de l’établissement, en réponse à une tentative d’évasion en 2019, malgré la résistance de l’Université en raison des répercussions négatives que cela aurait sur le répit que la cour offrait auparavant aux patients. Un psychiatre que nous avons interviewé a fait des réflexions importantes : « Cet endroit était censé être un établissement unique. Il a été créé pour fournir des soins de haute qualité et être un chef de file en santé mentale médico-légale, en enseignement clinique et en réadaptation. Il n’a pas été conçu pour être l’un des CRT. Nous ne sommes pas censés fonctionner comme un pénitencier. C’est une prison, avec la possibilité de se faire soigner. »
Certaines modifications ont été apportées à l’infrastructure existante pour tenter d’accommoder certains segments de la population de patients, comme les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Au CRT Pacifique, par exemple, l’unité gériatrique a été réaménagée avec des portes plus grandes et des lits d’hôpital. Malgré ces changements, les cinq établissements ne conviennent pas structurellement et sur le plan environnemental à des soins thérapeutiques ou axés sur l’accessibilité.
Le Centre d’excellence en santé
Au cours de cette enquête, des enquêtes ont été menées pour déterminer si des plans étaient en cours pour régler ces problèmes d’infrastructure bien connus et de longue date. En réponse à une demande de renseignements, le SCC a indiqué que sa Direction générale des services techniques et des installations était en train d’élaborer de nouvelles normes pour les CRT et, par conséquent, de mettre fin à toute nouvelle construction, à tout grand projet d’immobilisations ou à tout réaménagement de plans directeurs pour toutes les installations, sauf pour un établissement. L’exception est le Centre de rétablissement Shepody, qui devait être remplacé depuis longtemps par un nouveau Centre d’excellence en santé (CES).
Le Bureau a tenté d’obtenir plus d’information sur le projet de CES, qui a été annoncé pour la première fois en 2018 comme une « ressource nationale » pour répondre aux besoins de plus en plus complexes de la population de patients10. Depuis, les coûts prévus pour le projet ont explosé, de 300 à 400 millions de dollars à environ 1,3 milliard de dollars, ce qui représente le plus important investissement fédéral au Nouveau-Brunswick depuis la construction du pont de la Confédération au milieu des années 1990. Bien que le SCC ait été réticent à divulguer les plans de cette installation au Bureau, l’information a été communiquée périodiquement au grand public au cours des années qui ont suivi l’annonce du projet. Par exemple, le 19 décembre 2024, le ministre de la Sécurité publique de l’époque, Dominic Leblanc, a confirmé lors d’une conférence de presse que le CES comprendra 150 lits, soit près du triple de la capacité actuelle du Centre de rétablissement Shepody. Il offrira des services bilingues et accueillera les hommes et les femmes, y compris les patients vieillissants et les personnes ayant une incapacité physique. Mis à part ces détails, peu de choses ont été révélées concernant la philosophie directrice, l’approche en matière de prestation de soins, le recrutement de personnel approprié, etc., qui feraient de ce centre un « centre d’excellence » qui se distingue des CRT et du modèle existants.
Le projet, qui a connu de nombreux retards depuis son annonce, au moment d’écrire ces lignes, est à l’étape de la demande de propositions pour trouver un entrepreneur approprié. Bien qu’il y ait un consensus sur le fait que le Centre de rétablissement Shepody a grandement besoin d’un remplacement, le coût du CES est stupéfiant et, comme le Bureau l’a recommandé dans le passé, le SCC ne devrait pas se lancer dans la construction de nouvelles options coûteuses et à la fine pointe de la technologie pour loger les personnes nécessitant des soins de santé mentale et physique importants. Les services correctionnels et les soins spécialisés en santé mentale ne devraient jamais être sous le même toit. Cette approche est incompatible avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)11.
Le Bureau n’a vu aucune preuve suggérant que le CES fonctionnera fondamentalement différemment du modèle actuel du CRT, malgré nos demandes de voir de tels plans. Sept ans après son annonce, un terrain vide à côté du pénitencier existant est inactif, en attendant une possible première pelletée de terre. La réalité inquiétante est que jusqu’à ce que le CES soit opérationnel, les patients continueront d’être hébergés dans un établissement qui est manifestement inapproprié et incompatible avec un centre de traitement, ce que le SCC lui-même a reconnu. Selon les documents fournis par le SCC, la phase de conception et de construction devrait s’étendre jusqu’en 2032. À l’exception du CES, toute nouvelle construction ou tout grand projet d’immobilisations lié aux CRT sera reporté jusqu’à ce que les nouvelles normes soient en place, après quoi les plans directeurs des installations restantes contenant des CRT ou l’équivalent seront réexaminés.
2. Les CRT sont devenus des centres de détention pour le nombre croissant de personnes âgées et en situation de handicap derrière les barreaux
« Le vieillissement de la population est un autre problème. Je reçois beaucoup de références pour des personnes qui n’ont pas leur place dans un lit d’hôpital, qui vieillissent simplement et qui ont besoin de médicaments intraveineux. »
Chef, Services de santé
Selon le SCC, bien que 82 % des personnes purgeant une peine dans un centre de traitement aient reçu un diagnostic de santé mentale, 30 % des personnes dans les CRT ne répondent pas aux critères d’admission du SCC (c.-à-d. qu’elles n’ont pas d’échelle des besoins en matière de santé mentale au dossier indiquant des besoins considérables ou élevés). Ces personnes ont été admises dans un CRT en grande partie sur la base d’une « admission exceptionnelle », c’est-à-dire des personnes ayant une incapacité physique grave qui ont besoin de soins infirmiers 24 heures sur 24 ou d’autres soins cliniques qui ne sont pas disponibles dans la région. Les plus courantes sont les affections relatives à l’âge, notamment l’hypertension, l’hépatite C, la tuberculose, le diabète, la dyslipidémie, l’arthrose, l’insuffisance rénale chronique et la maladie pulmonaire obstructive chronique.
À l’heure actuelle, les CRT abritent une population beaucoup plus âgée et ayant une incapacité par rapport aux autres établissements fédéraux. Plus précisément, la proportion de personnes âgées de plus de 50 ans représente 42 % de l’ensemble de la population du CRT, comparativement à 26 % de leurs établissements co-implantés. Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 25 % des personnes dans les lits du CRT, alors qu’elles ne représentent que 7 % de celles dans les établissements ordinaires. Le Bureau a déjà fait état du nombre croissant de personnes âgées dans les établissements fédéraux et a formulé des recommandations au Service et au gouvernement afin d’accroître les options de mise en liberté pour les personnes vieillissantes et mourantes, d’améliorer les partenariats avec les fournisseurs de services communautaires spécialisés et de réaffecter de façon importante les ressources existantes des établissements aux services correctionnels communautaires afin de mieux répondre aux besoins de réinsertion sociale des délinquants vieillissants. En se promenant dans ces unités, il est évident que ces patients ne présenteraient aucun risque indu pour la société et pourraient être gérés facilement et en toute sécurité dans la collectivité, conformément à l’obligation légale du SCC d’appliquer les « mesures les moins restrictives » lors de l’administration des peines.
Le nombre de personnes de plus de 50 ans dans les services correctionnels fédéraux a continué d’augmenter d’une année à l’autre et continuera de le faire. Compte tenu de cette tendance, l’infrastructure et les services en place sont totalement inadéquats pour répondre humainement aux besoins de cette population. Par exemple, l’unité de psychogériatrie Mackenzie du CPR a des problèmes d’infrastructure physique, y compris des cellules construites dans les années 1970, sans prévoir l’espace requis ou les besoins uniques d’une population gériatrique. Les patients âgés souffrant de maladies comme l’incontinence et ayant besoin d’un bref changement, par exemple, se retrouvent limités par les routines de l’établissement, y compris les patrouilles de sécurité, le temps désigné de cellule ou les dénombrements officiels. Ces conditions nuisent à la santé et au bien-être des patients ainsi qu’à leur droit à des soins dignes.


Compte tenu des besoins croissants en matière de soins de santé physique et mentale et de la nature concomitante de ces problèmes qui accompagnent l’âge, le SCC doit faire face à la demande croissante de soins spécialisés et y répondre. Mis à part la qualité des soins, à l’heure actuelle, des choix sont faits et des exceptions sont accordées pour ceux qui ont des besoins urgents en matière de soins physiques, ce qui signifie que beaucoup de ceux qui ont besoin de soins psychiatriques restent dans un établissement ordinaire en raison d’un manque de places dans les CRT. Selon le SCC, 3 % de la population carcérale répond aux critères d’admission à un CRT, mais n’y est pas. Ces personnes sont pour la plupart à sécurité maximale, sont des Autochtones et/ou des femmes. Nous croyons comprendre que le secteur des Services de santé du SCC fait actuellement l’objet d’une initiative visant non seulement à normaliser les services dans les CRT, mais aussi à élaborer un plan pour faire face à ces pressions toujours croissantes. Le Bureau attend les résultats de cet exercice indispensable.
3. Les mesures de sécurité ont préséance sur la prestation de soins de santé physique et mentale
« Pour comprendre la philosophie des soins qui a évolué dans le centre de traitement, il suffit de regarder l’effectif du personnel. À la création du centre de traitement, l’effectif des AC [agents correctionnels] aux infirmiers et infirmières était d’environ 50 AC pour 100 membres du personnel infirmier, et les membres du personnel infirmier étaient responsables des programmes de soins physiques et d’intervention en santé mentale; ces personnes connaissaient bien leurs patients. À l’heure actuelle, il y a quelque 130 AC pour 48 membre du personnel infirmier. En raison de l’orientation que le SCC a choisi de prendre, le centre de traitement ressemble plus à une prison aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été. »
Psychiatre
Accent injustifié sur les mesures de sécurité et la perception du risque
Bien qu’ils soient enclins à imposer des mesures de sécurité élevées et à traiter souvent ces établissements comme des établissements à sécurité maximale en raison de leur colocalisation ou de la présence de patients à sécurité maximale, ils voient en réalité moins de participation aux gangs et de violence. Les agents du renseignement de sécurité jouent un rôle diffèrent, car des enjeux comme l’introduction d’objets interdits et la présence de groupes menaçant la sécurité (GMS) sont beaucoup moins prononcés. Un directeur d’établissement a expliqué que l’appartenance à un gang devient moins déterminante dans les CRT une fois que les gens réalisent qu’ils n’ont pas à adopter la même identité que dans un établissement régulier. Il a ajouté que « les personnes des GMS réalisent qu’ils n’ont pas besoin d’être à la hauteur de l’étiquette que nous, l’organisation, leur avons donnée. »
Au cours des cinq derniers exercices financiers, les CRT ont enregistré 961 incidents de possession d’objets interdits12, ce qui représente moins de 2 % de tous les incidents de possession d’objets interdits au cours de cette période. En fait, le personnel a signalé que le détournement de médicaments, y compris le traitement par agonistes opioïdes comme le Suboxone, pose beaucoup plus de problèmes dans ces établissements que la contrebande traditionnelle trouvée dans d’autres établissements ordinaires. Le détournement de médicaments par les patients consiste à mal acheminer ou à utiliser à mauvais escient les médicaments prescrits à des fins personnelles ou à les revendre. Par exemple, un directeur d’établissement a noté que « nous n’avons pas de problème avec les drones ici. Je suis une grande pharmacie. Les patients peuvent obtenir ce qu’ils veulent en parlant à un médecin. »
Néanmoins, il ne fait aucun doute que travailler avec une population complexe et parfois volatile comporte un risque inhérent. Au cours des cinq derniers exercices financiers, les CRT ont enregistré 34 tentatives de suicide et près de 1 500 cas de blessures auto-infligées. Au cours de la même période, trois patients se sont suicidés13.
Obstacles physiques à l’interaction entre le personnel et les patients et à la sécurité dynamique
Des incidents violents, y compris des voies de fait contre le personnel, se produisent et peuvent souvent précipiter l’imposition de mesures de sécurité supplémentaires, ce qui a une incidence sur la structure physique et la routine. Il y a un discours prédominant selon lequel le personnel correctionnel est un « intervenant », ce qui, en principe, va à l’encontre de la notion de détermination précoce, d’intervention et de sécurité dynamique, qui sont toutes essentielles dans un établissement de santé mentale. Il n’est donc pas surprenant que le personnel de la santé des établissements où ce sentiment est le plus perceptible ait tendance à refléter ses homologues correctionnels. Comme l’a fait remarquer une directrice exécutive avec frustration : « Beaucoup de nos infirmières et infirmiers portent des épaulettes maintenant. »
Bien que l’instinct de fortifier un établissement correctionnel puisse être compris, certaines mesures de sécurité disproportionnées, souvent sous forme d’obstacles physiques, coûtent beaucoup à l’interaction entre le personnel et le patient, à l’observation, à la relation thérapeutique et à la prestation dynamique des services. Lorsque les interactions en personne entre les patients et le personnel, qu’elles soient programmées ou spontanées, sont limitées par les structures, l’accès et la qualité des soins sont considérablement réduits.
Cette attitude générale et cette régression n’ont jamais été plus évidentes qu’au CPR de Saskatoon, où le personnel correctionnel et le personnel de la santé se retirent de plus en plus des unités et accomplissent davantage de tâches dans des modules de contrôle et des postes de soins infirmiers fermés. Au centre de l’unité Bow du CPR, par exemple, un poste de travail en forme de fer à cheval, conçu à l’origine pour favoriser l’observation directe et l’interaction avec les patients, est abandonné au profit d’un module intérieur et d’une nouvelle cloison vitrée du sol au plafond qui met la distance entre le personnel et les patients. Lors de notre inspection de cette unité, des négociations ont eu lieu avec le syndicat représentant le personnel infirmier après qu’il a été encouragé par la direction à quitter son poste de soins infirmiers fermé pendant 15 minutes par jour pour être plus visible pour les patients, ce qui a entraîné de la résistance et des exigences pour plus de barrières physiques.
Pour aggraver les problèmes de sécurité, les CRT sont estimés comme ayant une désignation de sécurité à multiples niveaux. La Directive du commissaire (DC) 706 – Classification des établissements définit certains de ces paramètres et attentes comportementales comme suit :
Sécurité
- Quand un centre régional de traitement sera bien délimité, sécurisé et contrôlé. Des armes à feu seront conservées dans le centre de traitement et seront utilisées pour assurer la sécurité du périmètre. Cependant, elles ne seront déployées dans le centre qu’en cas de situation d’urgence, sous réserve de l’autorisation du directeur de l’établissement.
Normes de comportement
- Les normes de comportement applicables aux détenus des centres régionaux de traitement correspondront à leur cote de sécurité, et on s’attend à ce que les détenus respectent leur plan de traitement et leur Plan correctionnel.
En pratique, cela signifie que les patients dont le niveau de sécurité des délinquants correspond à un niveau de sécurité minimal, moyen ou maximal peuvent être admis dans un CRT à partir d’établissements ayant l’un des niveaux de sécurité susmentionnés. Une fois admis au CRT, les patients peuvent se retrouver dans des unités résidentielles où des personnes présentaient un risque plus élevé pour la sécurité. Bien que la gestion de la complexité d’une telle population puisse être un point de fierté pour certains, cela contribue généralement à la culture axée sur la sécurité qui imprègne les CRT, car le personnel correctionnel semble se concentrer sur la présence de personnes à sécurité maximale traditionnellement classifiées et par conséquent traiter l’établissement comme s’il s’agissait d’un établissement à sécurité maximale. Combinée aux pièges structurels d’un environnement carcéral, cette attitude générale donne à ces établissements l’impression d’être encore plus éloignés de ce que l’on pourrait attendre d’un hôpital psychiatrique. Un psychiatre a décrit la dynamique observée dans les CRT en déclarant que « les préoccupations opérationnelles l’emportent toujours sur les préoccupations cliniques. »
Bien qu’elles soient moins courantes que dans les établissements réguliers, les décisions d’imposer des confinements sont également purement opérationnelles et comprennent peu ou pas de consultation clinique sur les répercussions potentielles qu’elles peuvent avoir sur la population de patients et la qualité des soins. À un endroit, par exemple, les psychiatres ont indiqué que les patients étaient enfermés dans leur cellule pendant la majeure partie de la journée de travail, laissant environ deux heures le matin et deux heures l’après-midi pour que les patients soient vus par la psychiatrie, le personnel de santé mentale, le personnel infirmier, les agents de libération conditionnelle et/ou pour participer aux programmes. De plus, la présence du personnel de sécurité dans une unité était estimée comme tant essentielle à la routine opérationnelle que, si elle n’était pas dotée d’agents correctionnels, une unité entière serait verrouillée. C’est-à-dire que les patients étaient enfermés dans leur cellule, quel que soit le nombre de membres du personnel des services de santé dans l’unité, prêts à voir les patients.
Obstacles culturels et attitudinaux à l’interaction entre le personnel et les patients et à la sécurité dynamique
« Le problème est la façon dont le langage a changé. Même les infirmières et les infirmiers disent maintenant détenu au lieu de patient Si vous ne vous intégrez pas à la culture, vous serez exclu. »
Psychiatre
« On se fait parfois dire par les agents “Hey tu es dans un pen ici” […]. Avant si tu disais “je veux voir monsieur un tel”, tu te le faisais dire que ce n’était pas un Monsieur […] c’est sûr qu’ici tu dois faire ta place sans les confronter et je sais très bien que je ne peux pas donner d’ordre à des officiers. »
Membre du personnel infirmier
Les rappels omniprésents que l’on est dans une prison ne sont pas seulement visuels, mais s’étendent également au langage utilisé par le personnel de l’établissement en référence aux personnes qui y résident pour être traitées. Tout au long de l’enquête, ces personnes ont été continuellement appelées « détenus » plutôt que « patients » par tous les membres du personnel correctionnel que nous avons interviewés. Bien que cela soit moins fréquent, les professionnels de la santé mentale, y compris les psychologues et les psychiatres, faisaient parfois cette distinction avant de se corriger.
L’influence de la culture, des attitudes, du choix du langage et des perceptions des « détenus » par rapport aux « patients » peuvent imposer des obstacles considérables au traitement. Cette dynamique était évidente dans tous les CRT. L’encapsulation de ces attitudes a été mise en évidence par une affiche stratégiquement placée près d’une fenêtre de distribution de médicaments dans le module de contrôle de l’unité Bow du CPR. L’affiche était collée à l’intérieur du plexiglas de la structure, l’image et l’impression étant tournées vers les patients. Le message aux patients se lisait comme suit :
L’altérité, le dénigrement et/ou la déshumanisation des patients ayant des besoins complexes en matière de santé mentale dans un « hôpital psychiatrique agréé » sont tout simplement inacceptables. Cela est nettement comparé à la façon dont les préoccupations en matière de sécurité sont gérées et traitées, et les patients sont vus, dans les centres de traitement psychiatrique médico-légal et les hôpitaux provinciaux dont le profil des patients est également composé de personnes ayant des besoins complexes en matière de santé mentale qui, parfois, présentent des comportements imprévisibles. Les centres provinciaux de psychiatrie médico-légaux que nous avons visités nous ont informés que les premiers points de contact pour tous les patients sont les services de santé et les professionnels de la santé mentale. En fait, leurs partenaires de sécurité ne sont pas présents dans les unités, ne gèrent pas les déplacements et ne font pas de rondes, ce qui est courant dans un centre de traitement fédéral. Au contraire, au premier signe qu’un patient semble avoir des difficultés ou montrer des signes de détresse, les services de santé et le personnel de santé mentale font appel au patient dans le but de l’éviter, de le gérer et/ou de le stabiliser.
La capacité de prévoir et d’observer les signes de détresse ou de décompensation exige une familiarité, une observation et une interaction importantes avec les patients – un travail à temps plein, 24 heures sur 24. Ce n’est qu’en tout dernier recours, lorsqu’un patient est agressif, qu’il faut appeler les partenaires de sécurité pour obtenir de l’aide. Leur rôle au moment de leur arrivée est clairement conciliant et le désamorçage avec la manipulation physique ne doit être utilisé que si nécessaire pour assurer la sécurité des patients et du personnel. Bien sûr, la capacité de prévoir et d’observer les signes de détresse ou de décompensation et d’éviter les comportements agressifs n’est pas toujours possible Les hôpitaux psychiatriques médico-légaux provinciaux ont connu leur part d’incidents où le personnel des services de santé a été blessé ou où un patient s’est échappé. Malgré cela, ils sont restés fidèles à leur mission et à leur mandat d’hôpital psychiatrique et se sont abstenus d’utiliser rapidement des solutions statiques axées sur la sécurité. Ces établissements constituent une preuve de principe que les centres régionaux de traitement correctionnel peuvent être gérés d’une manière axée sur la santé, lorsqu’il y a la volonté organisationnelle, l’engagement et le soutien d’une philosophie et d’une approche opérationnelles aussi fondamentales.
Par exemple, à la suite d’une évasion dans l’un de ces établissements médico-légaux provinciaux, et malgré les pressions pour installer des barbelés à lames, la possibilité qu’un patient soit pris au piège, empêtré et mutilé dans des barbelés à lames a joué un rôle important dans la délibération des options. Des solutions de rechange ont donc été explorées et ont donné lieu à l’installation d’une clôture en forme de « canne de bonbon » – une clôture munie d’un boîtier en aluminium en forme de canne de bonbon – qui rend les évasions futures difficiles, mais réduit les risques pour la sécurité des patients. De même, à la suite d’incidents où le personnel a subi des blessures physiques, les hôpitaux ont accru la formation et développé des compétences de désamorçage plus efficaces, et ont entrepris des examens importants (internes et externes) des incidents qu’ils ont utilisés comme outil d’apprentissage organisationnel. Les recommandations de ces examens, en particulier celles qui ont profité au bien-être et à la sécurité des patients et du public, ont été bien accueillies plutôt que rejetées.
Bien que certains membres du personnel du CRT aient noté qu’une baisse perceptible de la sécurité dynamique était constante et de longue date, certains membres du personnel étaient d’avis que le début de la pandémie de COVID-19 a également entraîné un changement important dans cette dynamique. Le personnel a soudainement perçu les patients comme un risque supplémentaire pour eux et leurs familles. Par conséquent, la qualité et la quantité des interactions ont diminué. Ce renversement de la sécurité dynamique et de la mobilisation envers les patients reflète la tendance que le Bureau a constatée dans son enquête portant sur les établissements autonomes à sécurité maximale pour hommes en 2023-202414.
Un affrontement entre les secteurs opérationnel et des soins de santé
« La gouvernance représente un énorme problème Le modèle actuel est horrible La politique de santé est très claire; la politique opérationnelle est très claire; mais la politique des centres régionaux de traitement n’existe pas Cela ne nous permet pas de travailler dans une zone d’ambiguïté ».
Directeur d’établissement
« Je crois fermement que nous avons besoin de notre propre politique. Nous essayons d’être la santé et les opérations et les deux ne fonctionnent pas ensemble. Nous conduisons sur des routes différentes, mais allonsnous au même endroit? »
Sous-directeur
« On travaille ici toujours sur un petit fond de mésentente. Il y a un fossé entre la santé et les opérations et l’équilibre entre les deux demeure fragile. Cela a un impact sur le climat de travail. »
Gestionnaire correctionnel
L’augmentation de la sécurisation des centres de traitement (infrastructure, protocoles et culture du personnel), combinée à la diminution des approches dynamiques en matière de sécurité et de traitement, est encore plus entravée par les conflits entre les secteurs des soins de santé et des opérations. Au cours de cette enquête, l’une des meilleures illustrations de ce fossé a peut-être émergé à la suite de la publication d’un rapport de cas du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada (CISPC) en mars 2020, qui a conclu que « […] le SCC a négligé de prendre des mesures adéquates pour mettre un terme à l’insubordination de plusieurs agents correctionnels ainsi qu’au harcèlement et à l’intimidation par ceux-ci à l’égard d’autres employés au Centre régional de santé mentale (CRSM), à l’Établissement Archambault15. » Le rapport décrivait en détail le harcèlement systémique des agents correctionnels du CRSM à l’égard des professionnels de la santé mentale travaillant dans les unités et de divers gestionnaires, en raison du désir des agents correctionnels de dicter où un psychologue était autorisé à voir un patient.
Pour protester contre l’appui de la direction au psychologue pour conseiller le patient dans son bureau, un agent correctionnel affecté au CRSM a quitté son poste. Cela a laissé plusieurs employés du CRSM enfermés dans des bureaux avec des patients sans soutien à proximité pendant près de 30 minutes, tandis qu’une infirmière a été enfermée dans une rangée pleine de patients dans une situation semblable. Le rapport du CISPC a documenté les exemples de harcèlement suivants :
« Certains agents correctionnels ont placé bien en vue un ourson en peluche illustrant leur dénigrement du travail des employés du CRSM.
Certains agents correctionnels ont fabriqué et affiché des bannières portant des messages discriminatoires qui dénigraient et ridiculisaient les détenus du CRSM aux prises avec des problèmes de santé mentale ainsi que le travail des employés du CRSM16. »
Ces événements, associés à des actes d’insubordination, de racisme et d’intimidation, connexes ou non, commis par le personnel correctionnel à l’encontre de ses collègues, illustrent clairement la différence fondamentale de perspective entre la sécurité et les soins aux patients. Au cours de l’enquête actuelle, des récits semblables ont émergé. Par exemple, deux professionnels de la santé mentale que nous avons interviewés dans un centre de traitement ont raconté qu’environ deux ans auparavant, le personnel correctionnel avait tenté de convaincre les patients d’une unité qu’un chien était présent, allant jusqu’à apporter un bol d’eau et un bol de nourriture pour chiens dans le seul but de confondre les patients pour leur propre plaisir.
En ce qui concerne l’échange de renseignements personnels portant sur la santé entre ces groupes, il est évident qu’il y a une compréhension différente et souvent pauvre de ce qui peut ou doit être communiqué à la fois sur le plan interdisciplinaire et avec le personnel opérationnel. Compte tenu de l’interdépendance des soins de santé, de la santé mentale et des opérations, il est essentiel de communiquer des renseignements essentiels portant sur les patients pour assurer leur sécurité et leur traitement efficace. On s’attendrait donc à trouver plus de clarté en ce qui concerne le principe du « besoin de savoir ». Pourtant, à chacun des CRT, le personnel a exprimé de la confusion et de la frustration à l’égard de ce qui était communiqué.
4. La dépendance excessive à l’usage de la force à l’endroit des patients, y compris l’utilisation inquiétante d’un agent organique inflammatoire comme moyen d’interrompre l’automutilation
Le Bureau a soulevé à maintes reprises des préoccupations concernant le recours à la force dans les établissements fédéraux depuis la mise en œuvre du Modèle d’engagement et d’intervention (MEI) du SCC, en janvier 2018, en particulier en ce qui concerne l’accent supposé mis par le Service sur la priorité des interventions non physiques et de désamorçage en cas d’incident et l’intégration des soins de santé dans le nouveau MEI. De plus, le recours à la force à l’endroit de personnes vulnérables, y compris celles aux prises avec des problèmes mentaux et physiques, a suscité une inquiétude supplémentaire et va à l’encontre des recommandations formulées dans l’évaluation du MEI de 2021 par le SCC17. Pour le contexte, entre avril 2024 et janvier 2025, il y a eu un total de 195 incidents uniques de recours à la force impliquant 137 personnes incarcérées dans les cinq CRT et près de 1 000 incidents de ce type au cours des cinq dernières années18.
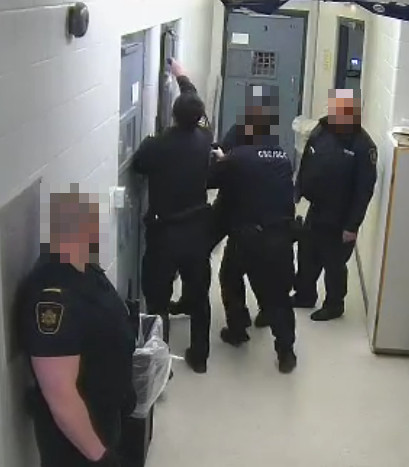
Malgré le besoin déterminé d’utiliser des solutions de rechange à la force avec ce segment de la population, les patients sont plus susceptibles d’être confrontés à la force que dans un établissement régulier. Bien qu’ils ne représentent qu’environ 4 % de la population carcérale fédérale totale, les incidents de recours à la force dans les CRT représentaient 10 % de tous les incidents de recours à la force dans les services correctionnels fédéraux en 2024-2025 (195/1 908) et 11 % de tous les incidents de recours à la force au cours des cinq dernières années (994/8 777). Le taux d’incidents de recours à la force dans les CRT en 2024-2025 était de 38 pour 100 personnes, comparativement à un taux global de 12 incidents pour 100 personnes dans tous les autres établissements. Malgré quelques fluctuations mineures, ce taux est demeuré relativement stable au cours des dernières années.
Peut-être en raison de leurs profils distincts ou de leur colocalisation, les incidents de recours à la force ne se produisent pas uniformément dans les CRT. Par exemple, en 2024- 2025, la plupart des incidents de recours à la force se sont produits au CRT de Millhaven (41,5 %), suivi du CPR Prairies (34 %). En ce qui concerne les types d’incidents qui entraînent le recours à la force, en 2024-2025, les principales causes étaient les suivantes :
- 37 % des incidents de recours à la force ont été causés par un événement lié à une voie de fait;
- 35 % étaient en réponse à des « problèmes relatifs au comportement »;
- 21 % sont survenus en réponse à des incidents d’automutilation.
Au cours de la même période, les principaux types d’intervention utilisés dans les CRT étaient le matériel de contrainte (54 %), la force non mortelle ne déclenchant pas une réaction inflammatoire (26 %) et les pulvérisateurs et munitions déclenchant une réaction inflammatoire (18 %), ces derniers étant particulièrement préoccupants pour le Bureau dans le contexte d’incidents d’automutilation. Si nous étudions les cinq derniers exercices financiers, sur le total (366) des incidents de recours à la force survenus dans les CRT en réponse à un comportement d’automutilation ou à une tentative de suicide, des pulvérisateurs et munitions déclenchant une réaction inflammatoire ont été utilisés dans 38 % des cas (139/366). Des exemples décrivant diverses interventions en cas de recours à la force dans les CRT se trouvent dans l’annexe qui suit la conclusion du présent rapport.
Bien que troublant, il convient de noter qu’il y a eu un total de 1 534 incidents d’automutilation et de tentative de suicide dans les CRT au cours de cette période. Cela signifie que la force a été utilisée dans environ le quart (24 %) de ces incidents et, par conséquent, des pulvérisateurs et munitions déclenchant une réaction inflammatoire ont été utilisés dans 9 % de tous les incidents consignés d’automutilation ou de tentative de suicide dans l’ensemble. Bien qu’une analyse sur le plan de l’incident soit justifiée pour déterminer la pertinence des mesures et des types de force utilisés, nous sommes néanmoins d’avis que ce niveau de force ne devrait être réservé qu’aux circonstances les plus exceptionnelles de détresse ou de crise mentale aiguë, en dernier recours. Bien que les personnes dans les centres de traitement puissent présenter des problèmes plus complexes, on pourrait s’attendre à moins d’usage de la force et à une plus grande dépendance aux réponses thérapeutiques ou aux techniques de désamorçage, comme l’illustrent les exemples des hôpitaux médico-légaux correctionnels communautaires et provinciaux qui suivent.
La principale différence entre un CRT exploité par le SCC et un hôpital médico-légal provincial ou communautaire est de savoir qui est estimé comme le premier intervenant. Dans l’ensemble, les agents correctionnels jouent ce rôle dans les établissements du SCC, en particulier le soir et la fin de semaine, tandis que leurs homologues provinciaux et communautaires ont tendance à compter sur des professionnels de la santé mentale pour agir comme personnel de première ligne par défaut dans le cadre de ces situations.
Approches de rechange efficaces en matière de sécurité dans un milieu correctionnel psychiatrique
Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent
À l’Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent, un établissement psychiatrique de l’annexe 1 coopéré par le ministère du Solliciteur général de l’Ontario et les Services de santé Royal Ottawa, la fréquence des incidents chez les résidents admis à l’Unité de traitement en milieu fermé est atténuée par l’utilisation de contrats comportementaux officiels. Les résidents signent ces contrats en sachant que le non-respect des conditions peut entraîner leur congé et, à l’inverse, que le respect des conditions peut leur valoir divers privilèges. En cas de conflit entre les résidents ou le personnel, des efforts importants sont déployés pour mobiliser la médiation et le règlement des différends, souvent en présence de cliniciens.
En principe, le personnel correctionnel n’est pas visible dans les unités et la grande majorité des activités quotidiennes sont gérées par des professionnels de la santé et de la santé mentale. Le personnel correctionnel effectue rarement des patrouilles de sécurité dans les unités, se concentrant plutôt sur la sécurité du périmètre, et agit principalement en réponse à des incidents graves. Notre personnel a appris que l’effort concerté visant à éliminer l’influence et l’intervention de la sécurité statique des agents armés et en uniforme dans un milieu de traitement a été couronné de succès et a amélioré l’aspect thérapeutique du centre de traitement. Dans les rares cas où un résident devait être placé sur un lit de contrainte à point fixe, la négociation était effectuée exclusivement par le personnel infirmier et le personnel de soins de santé semblable. De plus, lorsque les résidents étaient placés sous surveillance constante en raison d’un risque de suicide ou d’automutilation, la supervision était assurée par le personnel médical, et non par des agents correctionnels.
Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel (INPLPP)
Tout comme pour l’Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent, l’INPLPP utilise une approche consciente pour intégrer des mesures de sécurité dynamique et statique. Encore une fois, les mesures de sécurité statique et la présence de sécurité sont gardées hors de la vue du patient autant que possible. La sécurité dynamique (c.-à-d. l’interaction persistante ou soutenue avec les patients) est au cœur des préoccupations, car l’INPLPP met l’accent sur la nécessité pour le personnel d’apprendre à connaître les patients, et ce, afin d’être en mesure de détecter rapidement les crises, d’offrir du soutien et d’intervenir tout en restant conscient des préoccupations en matière de sécurité.
5. La faiblesse de la structure de gouvernance et l’absence de politique nationale entraînent une confusion des rôles et l’affaiblissement de la prise de décisions cliniques par les professionnels de la santé mentale
Prise de décision confuse
Dans le rapport de 2023-2024 du Bureau portant sur le décès de Stéphane Bissonnette au CRT de Millhaven, nous avons décrit les conditions dans lesquelles M. Bissonnette se trouvait fréquemment. Celles-ci comprenaient de nombreux placements dans le système de contrainte Pinel (SCP) et son placement sous surveillance du suicide modifiée au moment de son décès. Ce sont quelques-unes des conditions les plus restrictives auxquelles un patient suicidaire ou autodestructeur peut être soumis, destinées à être utilisées en dernier recours si toutes les autres mesures visant à mettre fin au comportement ont échoué. Le SCP consiste en des dispositifs de contention à points variables (jusqu’à sept), généralement fixés à un lit, utilisés pour immobiliser complètement ou partiellement des parties du corps et des membres des patients. Les mesures d’observation intensifiée, comme la surveillance modifiée ou la surveillance accrue, consistent à prendre la décision de placer une personne dans une cellule d’observation spécialement conçue, sous surveillance continue par le personnel, soit directement, soit par TVCF. Les patients sont souvent déshabillés et obligés de porter des jaquettes de sécurité anti-suicide spécialement conçues.


Cette enquête a révélé que la politique définissant les pouvoirs décisionnels en cas de comportement autodestructeur ou suicidaire, la Directive du commissaire 843 – Interventions pour préserver la vie et prévenir les blessures corporelles graves laisse beaucoup de place à l’interprétation sur le plan du site. Fait déroutant, malgré la présence de professionnels de la santé mentale formés et d’un directeur exécutif dans chaque CRT, la décision de placer ou de retirer les patients dans le système de contrainte Pinel revient au directeur de l’établissement, à moins que le directeur exécutif n’ait été désigné comme un délégué. Il en va de même pour le placement initial des patients sous surveillance accrue ou modifiée et les modifications subséquentes apportées aux conditions. Nous avons constaté que dans seulement deux ordres permanents, le directeur exécutif était explicitement désigné comme l’autorité désignée pour prendre de telles décisions. Plusieurs psychiatres ont signalé que, même s’ils sont de garde après les heures habituelles de travail, de telles décisions, qu’ils estiment de nature psychiatrique, peuvent être prises par le personnel opérationnel, comme les gestionnaires correctionnels responsables des établissements après les heures normales de jour, pour qu’ils soient informés après coup. Bien que cela puisse être conforme à la directive générale, il y a un désaccord sur l’expérience requise pour prendre de telles décisions.
Les ordres permanents découlant de la Directive du commissaire 843 varient considérablement d’un établissement à l’autre19. Notamment, il existe des divergences dans les responsabilités décisionnelles pour la surveillance élevée et la surveillance modifiée. Par exemple, le directeur exécutif est responsable des décisions dans certains CRT, tandis que dans d’autres, c’est le directeur de l’établissement qui supervise les placements ou les modifications subséquentes. De plus, le manque de clarté et l’incohérence des directives concernant les responsabilités en dehors des heures normales sont perceptibles et pourraient entraîner des retards dans les interventions ainsi qu’une mauvaise interprétation générale. L’utilisation du système de contrainte Pinel montre également des écarts dans les procédures d’autorisation et de prise de décision, notamment en ce qui concerne la participation du personnel en santé mentale : si certains établissements exigent une consultation avant d’intervenir, d’autres ne fournissent aucune précision à ce sujet, ou les instructions relatives aux consignes du commissaire permettent un haut niveau de discrétion. De plus, la surveillance de la santé mentale, un autre statut d’observation, est généralement supervisée par des professionnels de la santé, mais les détails peuvent varier, encore une fois, en particulier en ce qui concerne les responsabilités en dehors des heures habituelles.
En pratique, nous avons constaté que les décisions de placer les personnes dans ces conditions restrictives étaient prises différemment, selon le centre de traitement et la volonté du directeur de l’établissement ou du directeur exécutif d’assumer ce rôle. Par exemple, un directeur d’établissement que nous avons interviewé a décrit son appréhension à l’idée d’assumer le rôle et d’avoir à faire face au fait d’être le décideur de ces enjeux cliniques, notant qu’il n’y avait aucun soutien pour l’aider à éclairer son autorisation et qu’il avait dû recourir à des professionnels de la santé mentale pour obtenir des conseils. Un autre directeur d’établissement a clairement expliqué que son expérience, principalement dans les opérations et les interventions correctionnelles, ne lui fournissait pas l’expérience nécessaire pour ce genre d’évaluation et de décision. Le fait de retirer ce genre de décisions des mains de professionnels de la santé mentale formés sape leur expérience, leur jugement et leur expertise clinique, ce qui entraîne du ressentiment, de l’épuisement professionnel et des luttes au sein du personnel. Le personnel médical au CRSM, par exemple, dont certains travaillent dans des hôpitaux externes et des environnements médico-légaux comme l’Institut Pinel, a indiqué qu’il jouissait d’une autonomie professionnelle moindre dans le centre de traitement en raison de la structure de gouvernance et des politiques actuellement en place.
Absence d’une politique propre au CRT
« Les [directives du commissaire] n’ont rien à voir avec la qualité des soins aux patients. Comme point de départ, les DC sont bien, mais elles doivent aller au-delà. Les gens, en particulier les nouveaux employés, s’arrêteront à se conformer aux DC. »
Chef, Services de santé
L’une des indications les plus claires de la structure de gouvernance confuse en place est l’absence d’instruments de politique propres aux CRT. Une politique propre aux centres de traitement peut par la suite donner lieu à des ordres permanents utiles et propres au site, tout en mettant l’accent sur les soins aux patients et la santé mentale.
En raison de la nature unique des établissements co-implantés, ces CRT et leurs établissements partagés partagent également une liste de membres du personnel correctionnel. En pratique, cela peut signifier qu’un agent correctionnel qui travaille habituellement dans une prison, comme l’Établissement de Millhaven, qui est un établissement à sécurité maximale, peut être affecté au centre de traitement adjacent. Bien que certains membres du personnel correctionnel expriment un intérêt réel et une volonté de travailler dans le domaine de la santé mentale, cela dépend des besoins en dotation et de l’ancienneté, conformément à l’Entente globale entre SCC et le Syndicat des agents correctionnels du Canada20. Les problèmes de recrutement et de déploiement ne sont pas propres au personnel de sécurité, car le personnel infirmier des établissements coimplantés est souvent réticent à accepter des postes au CRT ou vice versa, ce qui pose des difficultés à la direction. Comme l’a expliqué un gestionnaire correctionnel : « Le [centre de traitement] n’est pas très populaire. […] Nous voyons des gens faire leur carrière ici, mais pas pour les bonnes raisons. »
La gouvernance est plus qu’une simple répartition des tâches et du pouvoir décisionnel. La question de savoir qui a le pouvoir décisionnel sur quels secteurs en ce qui concerne la prise de décisions cliniques, bien qu’importante, fait pâle figure en comparaison des enjeux plus larges de gouvernance. Il s’agit notamment de la sélection du personnel, de la formation du personnel, de l’intégration du personnel et d’une mission ou d’un mandat qui vise à combiner les efforts de tout le personnel vers un objectif commun. La bonne gouvernance et le leadership dans les domaines susmentionnés donnent le ton, les attentes, les normes, les objectifs et le potentiel de réalisation de toute installation. Ceux-ci ont des répercussions sur l’environnement de travail, le moral et la résilience du personnel et, en fin de compte, sur la qualité de vie du patient.
6. Le manque de spécialisation requise dans le cadre du recrutement, de la sélection et de la formation du personnel
L’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) : importance du recrutement, de la sélection et de la formation du personnel dans les établissements spécialisés
Règle 74 :
1. L’administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de tout grade, car c’est de l’intégrité, de l’humanité, de l’aptitude personnelle et des capacités professionnelles de ce personnel que dépend la bonne gestion des prisons. […]
Règle 75 :
[…] 2. Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent suivre, avant d’entrer en service, une formation générale et spéciale adaptée, qui tienne compte des meilleures pratiques existantes fondées sur l’observation des faits dans le domaine des sciences pénales Seuls les candidats ayant réussi les épreuves théoriques et pratiques sanctionnant cette formation sont autorisés à intégrer les services pénitentiaires.
3. L’administration pénitentiaire doit continuer d’offrir à son personnel une formation en cours d’emploi qui permette à ce dernier d’entretenir et d’améliorer ses connaissances et ses capacités professionnelles après son entrée en service et tout au long de sa carrière.
Règle 76 :
1. La formation visée au paragraphe 2 de la règle 75 doit inclure, au minimum, des enseignements concernant :
- Les lois, réglementations et politiques nationales pertinentes, ainsi que les instruments internationaux et régionaux applicables, dont les dispositions doivent guider le travail et l’interaction du personnel pénitentiaire avec les détenus;
- Les droits et devoirs qui s’appliquent aux membres du personnel pénitentiaire dans l’exercice de leurs fonctions, notamment le respect de la dignité humaine des détenus et l’interdiction de certains comportements, en particulier la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
- La sécurité et la sûreté, notamment la notion de sécurité dynamique, l’usage de la force et de moyens de contrainte, ainsi que la prise en charge des délinquants violents, en tenant dûment compte des techniques de prévention et de désamorçage telles que la négociation et la médiation;
- Les premiers soins, les besoins psychosociaux des détenus et les dynamiques propres au milieu carcéral, ainsi que la protection et l’assistance sociales, notamment le dépistage précoce des problèmes de santé mentale.
Lacunes dans le cadre du recrutement et de la formation du personnel correctionnel
« Le Programme de formation correctionnelle ne fait que préparer les agents correctionnels à devenir des CX-01 Un PowerPoint en ligne ne prépare pas quelqu’un à venir travailler dans un environnement comme celui-ci. »
Directeur d’établissement
« Il y a un manque important de discipline et la direction du centre de traitement n’a aucun pouvoir sur les agents correctionnels. Certains d’entre eux s’énervent facilement ou encore sont inadéquats. Je comprends que cela vienne des détenus, mais de là à les traiter comme des ordures […] ».
Chef, Services de santé
« La formation virtuelle en ligne ne fonctionne tout simplement pas. »
Directeur d’établissement
« Les normes de formation semblent s’être dégradées. Il y a trop de formation en ligne. »
Gestionnaire correctionnel
Bien que les évaluations et les qualifications pour devenir agent correctionnel ont plus ou moins restées les mêmes au cours des dernières années, les cadres supérieurs des opérations interrogés dans le cadre de cette enquête ont exprimé leur frustration face à la baisse perçue de la sélection des recrues de qualité et de leur niveau de préparation après avoir terminé le Programme de formation correctionnelle (PFC), le programme de formation du SCC pour les nouveaux agents correctionnels. Le PFC est modifié afin d’offrir aux intervenants de première ligne et aux kimisinaw21 la Formation axée sur les femmes – Programme d’orientation (FAFPO), en raison de la nature et des besoins uniques de la population institutionnelle. En revanche, le personnel destiné à travailler dans les CRT ne reçoit aucune formation supplémentaire ou spécialisée en santé mentale pour venir enrichir ce qui est (peu) enseigné par le PFC. Le PFC comprend trois étapes, dont les deux premières, d’une durée de sept à huit semaines, sont entièrement réalisées en ligne22. Compte tenu de la nature appliquée, interpersonnelle et intense qu’impliquerait un poste dans un centre de traitement, un tel accent sur l’enseignement théorique en ligne dénote une lacune importante dans la formation et la préparation du personnel.
En examinant de plus près le contenu et la qualité de la formation, un total de cinq modules fournit de l’information portant sur le travail avec les personnes ayant des problèmes de santé mentale, allant de la violence familiale à la prévention et aux interventions en matière de suicide et d’automutilation, en passant par les principes fondamentaux de la santé mentale. Trois modules sont proposés pour cibler la santé mentale des agents et partager les ressources et les outils disponibles (par exemple, Introduction au Programme d’aide aux employés et Gestion du stress lié aux incidents critiques). Au cours du PFC, le temps de formation consacré à la santé mentale des agents dépasse le temps consacré à la formation des recrues sur le travail avec les personnes qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale. Sur un programme de 446 heures, les recrues consacrent environ 24,75 heures (seulement 5,6 % du temps de formation) à la formation liée au travail avec les personnes ayant des problèmes de santé mentale, tandis que 25,6 heures sont consacrées à la santé mentale des agents. Il va sans dire que la santé mentale et la sécurité des agents sont un sujet important à aborder dans la formation initiale. Cependant, la méthode et le nombre d’heures de formation pour le personnel qui travaillera dans un contexte de traitement sont clairement insuffisants et préparent le personnel à une myriade de défis dans leur façon d’aborder leur travail, ce qui a en retour des répercussions négatives en cascade sur les soins aux patients. Bien que les recrues reçoivent un aperçu de la législation portant sur les renseignements personnels sur la santé, par exemple, il existe une certaine confusion quant au type de renseignements qui peuvent être demandés à leurs homologues des soins de santé et de la santé mentale. Cela est particulièrement préoccupant compte tenu de l’importance de communiquer des détails pertinents sur le comportement, l’état et les risques du patient qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité du patient et du personnel. Parallèlement, les nouvelles recrues qui se destinent aux CRT doivent avoir une compréhension plus approfondie des lois applicables sur les renseignements personnels sur la santé et la protection de la vie privée afin de protéger la confidentialité des patients.
Pratique prometteuse : Formation en thérapie comportementale dialectique (TCD) au CPR (Prairies)
Afin de renforcer les compétences des nouvelles recrues, le CPR de Saskatoon a commencé à offrir sa propre formation en santé mentale aux nouveaux agents correctionnels. Les psychologues agissent à titre de formateurs et facilitent une séance de deux jours ayant pour thème : Introduction et l’accompagnement à la thérapie comportementale dialectique (TCD). Cette psychothérapie fondée sur des données probantes vise à enseigner aux patients des compétences pour gérer efficacement les émotions importantes, faire face à des situations difficiles et améliorer leurs relations. Des appels aux participants ont lieu périodiquement, et le personnel est appuyé par la direction de l’établissement pour prendre du temps rémunéré à l’extérieur de l’établissement pour assister à la séance de formation au centre d’apprentissage et de perfectionnement correctionnel de Saskatoon.
La formation spécialisée, comme la TCD, n’est généralement pas proposée aux agents correctionnels, mais devrait être un pilier de la formation du personnel des centres de traitement. Il est nécessaire non seulement de développer un ensemble de compétences pertinentes pour les patients avec lesquels ils travaillent, mais aussi d’améliorer leur propre résilience, de prévenir les traumatismes et l’épuisement professionnel, et d’améliorer leur compréhension des décisions prises pour gérer et soutenir les patients. Notamment, le rapport du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada mentionné précédemment recommandait également que le SCC élabore et offre une formation particulière sur une base continue aux agents correctionnels et aux gestionnaires sur le travail dans un environnement multidisciplinaire, comme au CRSM, qui sert les détenus ayant des problèmes de santé mentale.
Lacunes dans le cadre du recrutement et de la formation du personnel de la santé
Bien qu’il existe des problèmes importants dans le recrutement, la sélection, la formation et le maintien en poste des agents correctionnels, ces problèmes s’appliquent également au personnel infirmier et aux autres professionnels des services de santé. Cette enquête a révélé que le recrutement d’infirmières et d’infirmiers autorisés (IA) et d’infirmières et d’infirmiers psychiatriques autorisés (IPA) pour travailler dans les CRT était un défi considérable, plus dans certaines régions que dans d’autres. En partie en raison d’une pénurie générale d’infirmières et d’infirmiers et d’un marché d’embauche concurrentiel, les salaires provinciaux étant souvent plus attrayants que les salaires du personnel infirmier du SCC, ont des répercussions négatives sur le recrutement pour les services correctionnels. Il a également été noté que la dotation en personnel de ces unités de santé mentale est particulièrement difficile compte tenu des besoins complexes de leurs patients aigus et du travail très exigeant. Les cadres supérieurs et intermédiaires ont fait remarquer que la couverture des soins infirmiers est parfois difficile, d’autant plus que les IA hésitent à remplacer les IPA. Cela s’est reflété dans l’attitude selon laquelle « un infirmier ou une infirmière est un infirmier ou une infirmière en fin de compte » et si la couverture est nécessaire, il n’y a aucune raison pour qu’un IA ne puisse pas couvrir un quart de travail qui est habituellement occupé par un IPA. Cette approche de gestion n’a pas été bien accueillie par les infirmières et les infirmiers.
À l’instar des lacunes du PFC, le processus de formation d’intégration offert aux infirmières et aux infirmiers et a été décrit comme insuffisant pour donner à un nouveau membre du personnel la confiance nécessaire pour s’acquitter de son rôle en travaillant avec le profil complexe d’un CRT. Le processus d’intégration, bien que de durée légèrement différente d’un site à l’autre, consiste souvent en environ cinq jours de formation, principalement en ligne. Cela comprend l’examen des politiques des Services de santé, la familiarisation avec l’accomplissement de plusieurs tâches fondées sur des listes de contrôle et la formation sur la prévention du suicide et de l’automutilation. Habituellement, une nouvelle infirmière ou un nouvel infirmier observerait ensuite une infirmière ou un infirmier expérimenté pendant environ six jours (par exemple, quatre quarts de 12 heures de jour et deux quarts de 12 heures en soirée). Malheureusement, comme on l’a expliqué, une nouvelle infirmière ou un nouvel infirmier ne serait pas nécessairement formé par la même personne pendant les six jours, ce qui entraînerait des redondances dans les expériences de formation et un manque de continuité. Les personnes interrogées ont indiqué que six jours n’étaient pas suffisants, et certaines nouvelles recrues ont exprimé un manque de confiance compte tenu de l’unicité du contexte, de la structure et des besoins en matière de santé mentale des patients. Il convient de noter que certains sites ont expliqué qu’ils envisageaient d’affecter une nouvelle recrue à un mentor pour les six jours de formation afin d’assurer la continuité. De plus, un manuel d’intégration était en cours d’élaboration dans un centre de traitement pour assurer la continuité et une expérience de formation complète, ainsi que pour servir de ressource après l’expérience de formation. À l’échelle locale, la formation continue se limitait généralement à la formation annuelle en cas d’urgence médicale, à la formation de recyclage professionnel en ligne sur la prévention du suicide et à l’instruction sur l’administration des listes de contrôle relatives aux soins infirmiers. Dans certains établissements, les infirmières et les infirmiers recevaient une allocation à consacrer à des expériences de formation à l’extérieur du SCC afin de respecter les exigences en matière de pratique et de permis.
Le recrutement et le maintien en poste d’autres professionnels de la santé mentale (SM) (par exemple, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, psychologues, conseillers en comportement) pour travailler dans les CRT, bien qu’ils soient parfois difficiles (surtout pour les psychologues), ne présentaient pas les mêmes défis que pour le personnel infirmier; cependant, des préoccupations ont été exprimées quant à la qualité et à la durée du processus d’intégration du personnel de santé mentale en général. La plupart de ces professionnels ont indiqué qu’ils s’appuyaient sur leur formation professionnelle et leurs normes pour guider leur travail et qu’ils s’appuyaient sur leur expérience de travail antérieure pour les aider à s’adapter au régime du SCC. Un travailleur social a indiqué qu’il n’aurait jamais été en mesure de s’orienter et de travailler avec succès au SCC s’il n’avait pas eu 20 ans d’expérience dans son domaine.
7. La « stabilisation » des symptômes comportementaux de la santé mentale semble être l’objectif primordial des CRT co-implantés
L’objectif du séjour d’un patient dans un CRT dépend en grande partie de l’établissement où il est admis. Alors que certains CRT comprennent une proportion plus élevée de patients gériatriques et en situation de handicap, susceptibles de purger une plus longue partie de leur peine dans ce milieu, d’autres établissements traitent des patients souffrant de symptômes aigus, qui seront retournés à leur établissement d’origine après une période de stabilisation. Plutôt que de cerner et de traiter les facteurs sous-jacents et de mettre l’accent sur l’aspect psychosocial des soins, dans la plupart des cas, le rôle principal des CRT semble être de fournir des soins pharmacologiques, médicaux et/ou de santé mentale à court terme pour stabiliser les patients, dans le but de les intégrer à la population correctionnelle générale. Néanmoins, le personnel de certains sites a signalé qu’au congé d’un traitement réel dans un CRT, les patients ont attendu des mois avant de retourner dans la population générale. Les établissements « d’origine » d’où les patients ont été admis sont parfois réticents à accepter des transferts au sein de dans leur population. Cela est encore davantage compliqué par les incompatibilités23 dans les établissements d’origine et/ou la résistance des patients qui veulent rester dans un CRT, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur la continuité des soins.
Malgré un besoin évident et une forte demande de traitement dans ces établissements, ils ne sont pas à l’abri des personnes qui manipulent le système pour y être admis. Pour certains, le temps passé dans un CRT est estimé comme « plus facile » qu’un établissement régulier. Cela amène certaines personnes incarcérées qui souhaitent profiter de ce milieu, ou de la population vulnérable qu’il abrite, à prendre des mesures qui pourraient justifier l’admission ou prolonger leur séjour dans un CRT, y compris l’automutilation et la tentative de suicide. Le personnel correctionnel a mentionné la facilité avec laquelle il croit pouvoir déterminer qui il estime être un « patient » par rapport à un « détenu » lorsqu’il se trouve dans une unité donnée. Comme l’a explicitement décrit un gestionnaire correctionnel : « Vous êtes peut-être la proie [dans un établissement à sécurité maximale], mais ici, vous êtes un prédateur. »
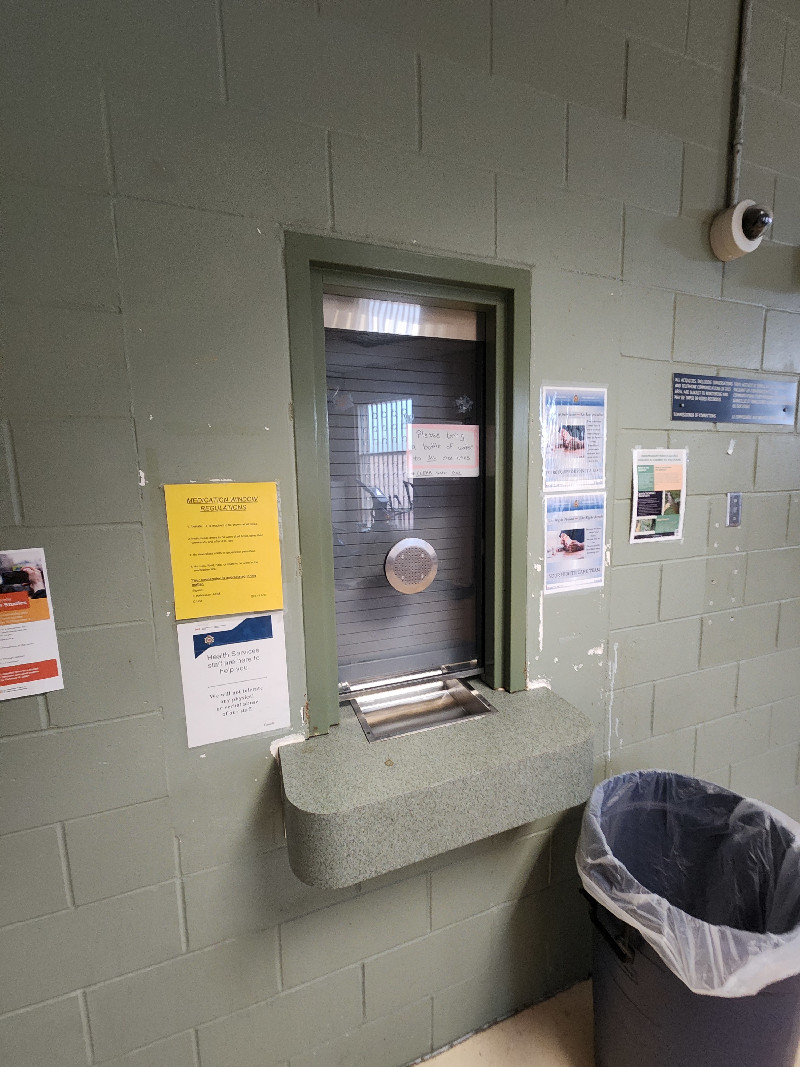
Néanmoins, dans le cas où les centres régionaux de traitement rencontreraient un patient qui hésite à retourner dans un établissement d’origine et qui pourrait en fait s’automutiler pour y parvenir, comment le personnel évalue-t-il la valeur de la résistance pour déterminer un processus de transition approprié? L’équipe chargée de l’enquête a entendu le personnel de la gestion de cas qui, par exemple, a décrit son appréhension à l’idée d’informer les patients d’un congé imminent. Ils ont décrit le fait de retarder délibérément l’information des patients par crainte de faire face à des cas d’automutilation, plutôt que de chercher à faire face, à analyser et à résoudre la résistance. Cette résistance et cette attitude à l’égard du retour d’un patient dans un environnement comme la sécurité maximale après le traitement témoignent de la pertinence du « dépistage » pour réussir après un séjour dans un CRT. Compte tenu de cela, il n’est pas surprenant que la réadmission aux CRT pour un traitement supplémentaire soit courante. De plus, cette situation met également en évidence l’incapacité du SCC d’offrir un environnement sûr et humain dans les établissements à sécurité maximale – tout autre endroit semble plus sûr.
Tableau 3. Admissions, réadmissions et congés du CRT par exercice financier
| EXERCICE FINANCIER | TOTAL DES ADMISSIONS | POURCENTAGE DES RÉADMISSIONS | TOTAL DES CONGÉS |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 829 | 49,6 % | 846 |
| 2020-2021 | 765 | 47,2 % | 834 |
| 2021-2022 | 922 | 50,3 % | 877 |
| 2022-2023 | 1109 | 50,6 % | 1083 |
| 2023-2024 | 902 | 55,9 % | 922 |
| Total général | 4527 | 50,8 % | 4562 |
Source: Les données ont été extraites de l’Entrepôt de données du SCC le 25 septembre 2024 et comprennent les admissions et les congés quotidiens du CRT déclarés par le Système de gestion de l’information sur la santé. Le SCC a indiqué que les admissions plus élevées au cours de l’exercice financier 2022-2023 sont attribuables à l’utilisation de lits des CRT pour l’isolement médical, qui était nécessaire pour toutes les nouvelles admissions pendant la pandémie.
Programmes et possibilités d’emploi limités
En raison de la durée variée et souvent relativement courte du séjour des patients dans les CRT par rapport aux établissements réguliers, les programmes correctionnels, les possibilités d’éducation et d’emploi sont limités. Nous avons entendu dire que les possibilités d’emploi et de formation professionnelle offertes aux patients consistent presque entièrement en le nettoyage, le service des repas et l’entretien de l’unité. En ce qui concerne les programmes, le Modèle de programme correctionnel intégré (MPCI), par exemple, mis à l’essai pour la première fois en janvier 2010, a été présenté comme une approche remaniée des programmes correctionnels visant à fournir des interventions plus rapides; améliorer l’accessibilité, la pertinence et la crédibilité; réduire les redondances dans les programmes; et rendre la transition vers la programmation communautaire plus harmonieuse. Comme l’a signalé le Bureau dans son rapport annuel de 2010-2011, la refonte du modèle de prestation des programmes correctionnels répond à une tendance vers des peines plus courtes, une baisse des taux d’octroi de semi-liberté et de libération conditionnelle totale, et un profil de délinquant plus complexe24. La responsabilité d’offrir de nombreux programmes, dont certains étaient conçus uniquement pour certains segments de la population et offerts notamment dans les CRT, est aussi passée de diverses disciplines, y compris les psychologues et les infirmières et infirmiers, aux agents de programmes correctionnels (APC). Autrefois un programme de traitement des délinquants sexuels de renommée internationale, par exemple, le Programme pour délinquants sexuels Clearwater du CPR, plus tard connu sous le nom de Programme « Wellspring », n’existe plus, et la prestation de ce contenu spécialisé a été transférée du personnel des Services de santé au personnel des interventions sous l’égide du MPCI.
La nature de la population du CRT est telle que les programmes et les cours d’éducation habituels du MPCI ne peuvent pas être offerts périodiquement en grands groupes. Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’infrastructure existante et les limites d’espace constituent aussi un obstacle important à la prestation de services Une version « adaptée » du MPCI peut être présentée en groupes plus petits, avec un langage simplifié, plus de répétitions et moins de contenu; cependant, certains sites n’avaient pas d’APC formés pour offrir cette version, tandis que d’autres ne pourraient offrir que les quelques volets du MPCI (par exemple, volets multicibles et délinquants sexuels) disponibles dans un format adapté. Néanmoins, certains établissements, comme le CPR, ont indiqué avoir la capacité d’offrir des programmes individuels pour les cas plus complexes, rendus possibles grâce au soutien de la gestion de l’établissement. Cela a pour conséquence que les personnes hébergées dans les CRT subiront des retards dans leurs plans correctionnels en raison de certaines de ces réalités et limites Invariablement, un séjour dans un CRT entraînera malheureusement des possibilités de mise en liberté anticipée retardées dans de nombreux cas. Punir les personnes qui ont des problèmes de santé mentale pour qu’elles purgent de plus longues périodes d’incarcération semble totalement injustifié et équivaut ainsi à une violation des droits de la personne.
De plus, malgré le fait que les patients autochtones sont également considérablement surreprésentés dans les CRT, représentant 35,9 % de la population totale des CRT25, l’enquête a révélé que les programmes et services culturels offerts aux patients autochtones dans les CRT sont grandement insuffisants. Nous avons observé que les lieux sacrés étaient petits, arides et exigus Certaines unités n’avaient pas une ventilation adéquate pour accueillir les cérémonies de purification au « smudging » à l’intérieur, laissant ceux qui souhaitaient participer à l’extérieur dans les éléments. Autre exemple, le CPR, qui compte la plus forte proportion de patients autochtones (environ 62 %)26, n’a pas de loge de sudation quatre-saisons Un tel accès limité aux programmes et services autochtones est incompatible avec la loi et les politiques.
Bien que la « stabilisation » des symptômes des patients dans le but de les réintégrer dans une population générale puisse être l’objectif principal des CRT, il n’est pas rare que les patients soient libérés directement dans la collectivité. Étant donné l’absence de possibilités d’emploi ou de formation professionnelle importantes, ces personnes sont difficilement prêtes à entrer sur le marché du travail. En l’absence de planificateurs cliniques consacrés à la continuité des soins, les travailleurs sociaux sont généralement chargés de cette responsabilité supplémentaire, même s’ils ont leur propre charge de travail. Une partie de ces tâches, en collaboration avec l’agent de libération conditionnelle du patient, consiste à s’assurer que le patient est mis en contact avec des mesures de soutien adéquates en santé mentale, qu’il dispose des pièces d’identité appropriées et qu’il dispose de suffisamment de médicaments pour couvrir cette transition. Comme il est expliqué plus en détail dans la section du présent rapport intitulée Le fardeau de la collectivité : la discontinuité des services de santé mentale après la mise en liberté, ce n’est souvent pas le cas et la continuité des soins dans la collectivité est précaire.
8. Selon un examen des CNE, le SCC a systématiquement omis de tirer des leçons ou de prévenir de nombreux incidents graves et décès
Lorsqu’un incident survient dans un établissement ou dans la collectivité, les autorités compétentes du SCC peuvent ordonner la tenue d’une enquête ou d’un examen. Selon le site Web du SCC, les objectifs de l’enquête portant sur un incident sont les suivants : 1) évaluer les circonstances entourant l’incident et produire un rapport à cet égard; 2) fournir des renseignements afin qu’il puisse prendre des mesures, le cas échéant, pour éviter que des incidents semblables se reproduisent; 3) en apprendre sur les pratiques exemplaires et les communiquer; et 4) faire des constatations et formuler des recommandations. Pour les incidents graves (par exemple, entraînant des lésions corporelles graves ou même la mort), des comités d’enquête nationaux (niveaux I et II) peuvent être convoqués en vertu de diverses sections de la LSCMLC, et ce, selon la nature de l’incident.
Afin de mieux comprendre les circonstances dans lesquelles les incidents graves se produisent dans les CRT et d’examiner la façon dont ces incidents sont enquêtés, signalés, traités et prévenus par le Service, ce Bureau a effectué un examen quinquennal du Comité national d’enquête (CNE) sur les incidents graves survenus dans les centres de traitement. Au cours de cette période, un total de 37 CNE ont été menés à la suite d’incidents dans chacun des cinq CRT. Les incidents faisant l’objet de l’enquête comprenaient : dix-neuf décès en établissement, huit tentatives de suicide, comprenant trois tentatives de suicide avec automutilation subséquente, et quatre agressions sexuelles présumées. Parmi les autres incidents faisant l’objet d’une enquête, mentionnons les suivants : l’automutilation (2), l’évasion (2), les blessures (1) et la séquestration du personnel (1). Le Centre psychiatrique régional a enregistré le plus grand nombre d’incidents (16) au cours de la période d’examen.
Bien que chaque incident ait impliqué des circonstances uniques, l’examen a permis de dégager les constatations thématiques suivantes :
- Les incidents, y compris les décès évitables de personnes en détention, découlent en partie d’une culture de travail décousue, axée sur les tâches et réactive. Il est devenu évident, grâce à l’examen d’un certain nombre d’incidents, que le personnel travaille souvent en vase clos, ce qui entraîne une rupture dangereuse et parfois mortelle de la communication et des soins efficaces aux patients.
- En raison d’une culture de travail réactive et axée sur les tâches, des renseignements importants sur les cas sont documentés, mais ne sont pas utilisés pour guider les actions, les interventions ou les soins qui pourraient autrement avoir des conséquences sur la prévention d’incidents graves.
- À l’inverse, de mauvaises pratiques en matière de documentation, en particulier la consignation insuffisante des changements pertinents dans l’état de santé mentale des personnes, créent d’importantes lacunes en matière de renseignements qui pourraient autrement être utilisés pour signaler les fluctuations ou les trajectoires de décompensation. Ce suivi de l’information est essentiel à la prévention des incidents graves et des décès.
- Comme l’ont indiqué les rapports précédents du Bureau, de nombreux incidents dans plusieurs régions ont été signalés comme impliquant des patrouilles de sécurité, y compris des dénombrements en position debout, qui étaient de mauvaise qualité en raison de leur durée, de leur fréquence et/ou de la vérification que les détenus sont en vie et qu’ils se portent bien.
- En plus d’une mauvaise documentation et d’un mauvais partage des renseignements, les incidents dénotaient une mauvaise compréhension et/ou une mauvaise interprétation par le personnel opérationnel et le personnel des soins de santé quant aux signes de détresse ou à un comportement manifestement anormal.
Conformément à bon nombre des constatations du sixième rapport du Comité d’examen indépendant, cet examen a révélé plusieurs aspects préoccupants des CNE eux-mêmes. Notre examen a révélé que le CNE aux CRT et les rapports qui en découlaient :
- étaient étonnamment silencieux concernant les détails contextuels importants concernant la qualité et la nature des interventions et des thérapies offertes aux personnes ayant des problèmes de santé mentale;
- étaient trop axés sur les enjeux de conformité (par exemple, l’accomplissement des tâches conformément à la politique) et le placement approprié de la documentation dans le dossier d’une personne, à l’exclusion de l’évaluation de la qualité du traitement ou des interventions administrées;
- ne prêtaient pas suffisamment attention à l’enquête, à l’évaluation et à la formulation de recommandations substantielles sur l’évaluation de la santé mentale et les plans de traitement (ou l’absence d’évaluation de la santé mentale et de plans de traitement) pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale; la prise en compte de la participation et des progrès dans le cadre du traitement ou de l’intervention; et comment la résistance au traitement était gérée;
- n’étaient pas partagés de manière uniforme et importante à l’échelle nationale avec le personnel en tant qu’outil d’apprentissage, et ne remplissaient donc pas l’une de leurs fonctions principales, et sans doute la plus importante, soit un outil d’enseignement et de prévention des incidents après l’événement;
- étaient rarement utilisés comme outil de mobilisation des connaissances pour offrir des exemples fondés sur des données probantes de méthodes préventives efficaces lors de l’interaction avec des personnes ayant des besoins importants en santé mentale, en particulier celles qui sont en crise.
9. L’absence marquée de défenseurs des droits des patients dévoués dans les CRT empiète sur les droits et les besoins des patients.
Le Bureau réclame depuis longtemps la mise en œuvre de services indépendants et externes de défense des droits des patients dans les établissements du SCC, notamment à la suite de la sanction royale du projet de loi C-83 (Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi) le 21 juin 2019. Le projet de loi a introduit de nouvelles dispositions portant sur les soins de santé en vertu de la LSCMLC, reconnaissant officiellement l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique du personnel de soins de santé du SCC. L’article 89.1 exige que le SCC donne accès à des services de défense des droits des patients aux personnes incarcérées sous responsabilité fédérale afin de les aider à mieux comprendre leurs droits et leurs responsabilités en matière de soins de santé.
Mon Bureau a fait de tels appels pendant plus d’une décennie, et des recommandations ont été formulées en 2012-2013, en 2017-2018, et, plus récemment, en 2022-2023. Il a notamment demandé au SCC d’examiner les pratiques exemplaires nationales et internationales dans le domaine de la défense des droits des patients, d’élaborer un modèle solide pour fournir des conseils et du soutien aux patients, et de veiller à ce que leurs droits soient pleinement compris et respectés.
Un modèle de défense des droits des patients indépendant et solide est nécessaire dans tous les établissements, mais cette exigence n’est que renforcée dans un centre de traitement, car certains obstacles que nous avons déjà mis en évidence désavantagent les plus vulnérables Cela comprend un manque de capacité de consentement éclairé et, comme nous l’avons mentionné tout au long du présent rapport, une double loyauté en raison d’une structure de gouvernance influencée par les services correctionnels. De plus, le Bureau a déjà recommandé de nommer des défenseurs des droits des patients aux CRT, car les patients peuvent être internés, traités ou immobilisés physiquement involontairement à des fins de soins de santé27.
Six ans après l’adoption du projet de loi C-83 et plus d’une décennie après que le Bureau a commencé à demander leur création, le SCC continue de ne pas agir pour mettre en place des défenseurs indépendants des patients, un besoin urgent qui a été évident au cours de cette enquête.
Conclusion
Comme il est indiqué dans d’autres sections du présent rapport annuel, la prévalence des problèmes de santé mentale et la nécessité d’adopter des approches modernes, novatrices, adaptées et efficaces pour servir les personnes souffrant de problèmes de santé mentale sont plus cruciales que jamais. La population vieillissante de nos centres de traitement, dont beaucoup ont des déficiences cognitives et neurodégénératives si avancées que tout danger pour les autres est nul, reste inactive dans ce qui se présente, ostensiblement, comme des environnements carcéraux traditionnels. Les établissements médico-légaux externes que nous avons visités nous ont donné un aperçu de ce à quoi peut et devrait ressembler l’avant-garde des soins de santé mentale pour les délinquants.
Les personnes déclarées non criminellement responsables n’ont pas leur place dans les établissements correctionnels fédéraux, où leurs droits et leur traitement sont incompatibles avec les quelques politiques propres au CRT. Une telle pratique est aussi dangereuse que déroutante.
Compte tenu des constatations découlant de cette enquête, y compris le niveau de soins inférieur aux normes auquel on ne s’attendrait pas d’un hôpital psychiatrique désigné et agréé, l’idée que ces établissements puissent conserver ces titres de compétences est préoccupante. Bien que le SCC puisse être outillé pour fournir, au mieux, des soins de santé mentale intermédiaires et des services temporaires en cas d’urgence, les établissements existants sont très loin de leurs homologues provinciaux externes que nous avons visités.
Bien que les CRT desservent un segment incroyablement difficile de la population institutionnelle à bien des égards, une approche générale en matière de recrutement, de sélection, de formation et de déploiement a rempli ces installations de personnel qui se sent mal outillé pour travailler avec une telle population. Nous avons rencontré de nombreux professionnels dévoués tout au long de ces visites qui avaient les meilleures intentions et un dévouement professionnel, mais qui étaient liés par des listes de contrôle prescriptives, une perte d’autonomie professionnelle, une culture de gouvernance confuse et un accent toujours plus important sur la sécurité. Cela aussi a donné lieu à de nombreux exemples de luttes ou de tensions avec le personnel des services de santé et à des cas répétés de mauvais traitement des personnes les plus atteintes de trouble de santé mentale sous la garde du SCC. Pour de nombreux patients, cette garde devrait être remise en question, car ces constatations soulignent la nécessité de réaffecter des fonds à des établissements provinciaux et communautaires plus compétents et spécialisés. Bien que je reconnaisse la difficulté de réaliser un tel changement, les dépenses exorbitantes pour une seule installation ne permettront pas de résoudre les enjeux systémiques et organisationnels. Cependant, si des changements aussi importants étaient apportés, peut-être que la succession de décès, de suicides et de violence pourrait être interrompue. À l’heure actuelle, cependant, ces centres de traitement offrent ce que l’on attendrait des soins intermédiaires, au mieux, et ne fournissent pas de soins psychiatriques dans un milieu thérapeutique.
Avant que les recommandations ci-dessous puissent être mises en œuvre, le SCC doit d’abord donner suite aux deux recommandations que j’ai formulées dans mon Message de l’enquêteur correctionnel, à savoir que les CRT soient redéfinis comme des établissements de soins de santé mentale intermédiaires, en mettant l’accent sur le transfert des personnes atteintes d’un trouble de santé mentale grave vers des hôpitaux psychiatriques communautaires mieux adaptés à leurs besoins; et que le gouvernement du Canada reconsidère son récent investissement dans un établissement de remplacement, le Centre de rétablissement Shepody, et qu’il aide plutôt le SCC à réaffecter les ressources actuelles pour faciliter les transfèrements aux hôpitaux psychiatriques provinciaux.
Je recommande qu’une fois que les CRT seront redéfinis en établissements de soins intermédiaires en santé mentale :
- Le SCC travaille avec des professionnels de la santé mentale pour voir comment l’infrastructure actuelle du CRT pourrait être considérablement améliorée et devenir plus thérapeutique, y compris l’utilisation de peinture, de plantes, d’herbe dans les cours, de bancs, de tapis, d’affiches et de canapés où les problèmes de sécurité pourraient être atténués.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE EN PRINCIPE
La recommandation et les conclusions sous-jacentes sont d’accord en général; cependant, d’autres mesures sont nécessaires avant que l’agence puisse s’engager à la mise en œuvre.
Reconnaissant que les environnements physiques soient d’importants facteurs contributifs qui peuvent servir à favoriser la stabilité, le rétablissement et la guérison, le SCC tâchera de trouver des occasions d’optimiser l’infrastructure des centres régionaux de traitement.
Les centres régionaux de traitement offrent un environnement thérapeutique propice aux interventions de traitement, au rétablissement ainsi qu’a un fonctionnement et à une qualité de vie améliorés. En se fondant sur les principes de conception physique du Centre d’excellence en santé, le SCC collaborera avec les intervenants internes, dont le personnel et les gestionnaires des domaines de la santé et des opérations, et les détenus dans le cadre de l’examen des centres régionaux de traitement en vue d’examiner l’infrastructure et les environnements physiques de ces centres dans le but à long terme d’élaborer des options propres à chaque établissement pour optimiser l’espace existant.
Le SCC s’affaire à élaborer un plan d’action pour l’environnement bâti des Services de santé, l’objectif premier étant d’établir une vision stratégique à long terme en ce qui a trait aux besoins en installations des Services de santé dans l’ensemble des établissements du SCC. Pour ce faire, on procèdera notamment à l’examen des besoins des centres régionaux de traitement et des unités de santé des établissements (y compris des unités de soins intermédiaires de santé mentale) et on déterminera comment ces éléments interagiront et fonctionneront de manière cohésive pour répondre aux besoins en évolution des Services de santé, ce qui comprend l’examen des rôles actuels et de la fonctionnalité et le recensement des possibilités d’amélioration. Le dressage d’un inventaire complet des biens existants et la réalisation d’une analyse de leur usage et efficacité constituent des éléments critiques de ce processus. À l’issue du processus, de nouvelles normes seront élaborées pour l’environnement bâti, donnant lieu à la création de projets d’infrastructure visant à rendre les installations conformes aux nouvelles normes. Parallèlement, le SCC continuera d’examiner les projets liés aux centres régionaux de traitement et aux unités de soins intermédiaires de santé mentale existants dans le but de concevoir des stratégies appropriées qui favorisent la création d’espaces thérapeutiques offrant un meilleur soutien au sein de ces installations tout en répondant aux besoins de sécurité. Aux fins de la création du plan d’action pour l’environnement bâti des Services de santé, on procédera à un examen exhaustif pour déterminer comment les infrastructures actuelles et futures pourront être grandement améliorées. Par la suite, les projets proposés pour amener des changements physiques devront être soumis dans le cadre du processus annuel de lettre d’appel du SCC pour la priorisation des projets et l’attribution des fonds à ceux-ci en fonction des pouvoirs budgétaires, d’acquisition et de passation de marchés et des ressources disponibles.
Prochaines étapes :
- Le SCC a entrepris un examen des centres régionaux de traitement pour établir une référence normalisée en matière de prestation de services.
- Le SCC a entrepris un examen de l’infrastructure relative aux services de santé dans l’ensemble des établissements du SCC.
Échéancier : Exercice 2026 à 2027
- Le ministre de la Sécurité publique examine et évalue immédiatement les options de mise en liberté (par exemple, libération conditionnelle pour raisons médicales et/ou gériatriques) pour les patients âgés et de longue date qui ne posent pas de risque indu pour la sécurité publique, et propose des modifications législatives à la LSCMLC en conséquence. Le SCC devrait investir activement dans les services correctionnels communautaires afin de créer des lits dans les établissements de soins de longue durée, de soins palliatifs, et les maisons de retraite, et ce, avec un objectif de 200 lits d’ici cinq ans.
Réponse de la Sécurité publique : ACCEPTÉE EN PRINCIPE
Il est important que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) reflète les besoins et les réalités de la population carcérale fédérale actuelle, y compris ceux qui sont plus âgés, qui nécessitent un niveau plus élevé de soins médicaux ou qui approchent de la fin de leur vie. En fonction du risque individuel qu'ils représentent pour la sécurité publique, il est admis qu'un établissement fédéral n'est pas toujours le lieu le plus approprié pour certains détenus. Cette reconnaissance est implicite dans la LSCMLC, où les outils en place peuvent être utilisés pour répondre aux besoins de ces détenus dans certaines circonstances.
La LSCMLC contient à présent des dispositions qui permettent aux détenus fédéraux d'avoir accès à des soins médicaux appropriés dans la communauté grâce à des absences temporaires. Les absences temporaires avec ou sans escorte peuvent être autorisées pour une durée illimitée si elles sont pour des raisons médicales. En outre, l'article 121, paragraphe 1, permet à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) d'accorder la libération conditionnelle à tout moment à un détenu dans des cas exceptionnels, notamment à ceux qui sont en phase terminale d'une maladie ou à ceux dont la santé physique ou mentale risque d'être gravement affectée s'ils sont maintenus en détention.
Sécurité publique Canada est conscient que les détenus fédéraux âgés et ceux qui approchent de la fin de leur vie constituent un groupe démographique ayant des besoins et des caractéristiques uniques, et que les services et l'infrastructure des établissements fédéraux ne sont pas toujours les plus appropriés ou les plus suffisants pour cette population, donc le portefeuille de la Sécurité publique continuera à explorer les moyens de renforcer toutes les formes de libération conditionnelle.
En outre, dans le cadre du plan de partenariat de Services de santé du SCC, le SCC continuera à rechercher des partenariats centrés sur les services post libératoires afin d'assurer la continuité des soins, notamment en travaillant avec les provinces et les territoires sur les obstacles à l'accès aux soins de santé provinciaux rencontrés par les détenus lors de leur mise en liberté, et en explorant les options de soins palliatifs dans la communauté.
- Le SCC élabore une politique particulière à la gouvernance et au fonctionnement des CRT, en consultation avec des professionnels externes expérimentés en santé mentale dès sa création.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE EN PRINCIPE
Reconnaissant l’importance de la clarté des rôles, le SCC veillera à ce que les rôles soient clairement définis dans les politiques et les lignes directrices auxquelles le personnel peut avoir facilement accès.
Dans le cadre de son examen des centres régionaux de traitement, le SCC examinera les politiques et les lignes directrices afférentes. Des modifications seront notamment apportées aux politiques pour clairement définir les pouvoirs, les responsabilités et les orientations stratégiques en matière de prestation de services.
Prochaine étape : Le SCC a entrepris un examen des centres régionaux de traitement pour établir une référence normalisée en matière de prestation de services.
Échéancier : Exercice 2026 à 2027
- Le SCC examine la mise en œuvre du Modèle d’engagement et d’intervention en mettant l’accent sur son application auprès des personnes souffrant de troubles de santé mentale. Le SCC devrait également cesser d’utiliser des pulvérisateurs déclenchant une réaction inflammatoire comme première intervention en cas d’automutilation, en faveur d’interventions et de techniques axées sur les soins de santé, le désamorçage et les techniques thérapeutiques.
Réponse du SCC : REJETÉ
Le SCC est déterminé à veiller à ce que toutes les interventions, y compris celles en réponse à l’automutilation, soient gérées par l’utilisation des moyens les plus sécuritaires et raisonnables possible. Le SCC priorise le recours aux interventions verbales et à des techniques d’intervention graduelle pour désamorcer les situations lorsque le temps et les circonstances le permettent. Ces principes font partie intégrante du Modèle d’engagement et d’intervention du SCC, qui favorise des interventions axées sur la santé et centrées sur la personne, ainsi qu’une évaluation continue du risque. Le personnel est tenu de prendre en compte les besoins individuels de chaque détenu, en particulier ceux liés à la santé mentale, et de veiller à ce que les interventions soient nécessaires, proportionnelles et axées sur la sécurité.
En 2021, le SCC a réalisé un examen exhaustif du Modale d’engagement et d’intervention, à l’issue duquel plusieurs recommandations ont été formulées. Celles-ci ont depuis et a mises en œuvre afin d’améliorer l’efficacité du modèle et de garantir qu’il demeure adapté aux réalités des établissements.
Le Modèle d’engagement et d’intervention repose sur un cadre axé sur le risque qui oriente les interventions du personnel à l’égard des incidents, y compris des incidents de détresse en santé mentale. Il met l’accent sur une prise de décision raisonnable et axée sur la santé et prévoit la réalisation d’une évaluation continue par le personnel de l’état mental du détenu, de sa capacité à suivre les directives et de ses antécédents en matière d’automutilation et de comportements suicidaires. Le vaporisateur d’oléorésine de Capsicum n’est utilisé que lorsque les autres techniques de désamorçage s’avèrent inefficaces et que la situation présente un risque sérieux.
Dans le but d’offrir un meilleur soutien aux personnes présentant un risque de suicide ou d’automutilation, le SCC a mis en place le Cadre clinique du SCC pour l’identification, la gestion et l’intervention pour les individus présentant une vulnérabilité au suicide ou à l’automutilation. Ce cadre favorise la prise de mesures proactives et le recours aux interventions les moins restrictives possible, la réalisation d’un suivi en temps opportun et la prestation d’une formation améliorée au personnel. Il associe les comportements suicidaires à un continuum nécessitant divers niveaux de soins et encourage les interventions précoces et préventives. Le plan de sécurité constitue l’un des principaux éléments du cadre; il s’agit d’un document conjoint évolutif élabore par le personnel et le détenu afin d’aider à reconnaitre les signes avant-coureurs et de prévenir les crises.
Prochaine étape : Suivi continu
- Le SCC élabore un modèle de gouvernance pour les CRT, semblable à celui des établissements psychiatriques médico-légaux communautaires externes, y compris une structure autonome de rapports et de gouvernance afin que toutes les questions relatives à la santé, des listes de dotation distinctes à la formation du personnel, en passant par le contrôle complet et sans entrave des budgets et des ressources, soient décidées par les cliniciens, et non par les directeurs d’établissement ou le personnel opérationnel.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE EN PARTIE
Reconnaissant qu’une structure de gouvernance claire est essentielle à l’exploitation efficace des centres régionaux de traitement et à la prestation de soins de qualité aux patients, le SCC a mis en place un modèle de gouvernance qui définit clairement les rôles du personnel des services de santé et des opérations en établissement.
À compter de septembre 2007, le SCC a procède à l’intégration de la prestation de services, des autorités hiérarchiques et des responsabilités des gestionnaires en santé au sein du Secteur des services de santé. Ainsi, que les soins de santé soient offerts dans les établissements réguliers, la collectivité ou les centres régionaux de traitement, les gestionnaires qui en sont responsables relèvent directement de la commissaire adjointe des Services de santé. Plus précisément, on a procédé à l’intégration des responsabilités relatives aux services de santé physique assurés dans les établissements réguliers (septembre 2007), aux services de santé mentale assurés dans les établissements réguliers et la collectivité (avril 2013), et aux services assurés dans les centres régionaux de traitement (avril 2014).
Cette structure de gouvernance permet de s’assurer que les activités de dotation en personnel, d’établissement des horaires et de gestion budgétaire se rapportant aux services de santé relèvent de la compétence de la direction en santé et non du personnel opérationnel. Bien que cette structure soit déjà en place dans tous les centres régionaux de traitement, le SCC révisera ses politiques et ses lignes directrices en santé afin de clarifier les rôles et les responsabilités et d’assurer une compréhension et une application uniformes à l’échelle de l’organisation.
Prochaine étape : Le SCC a entrepris un examen des centres régionaux de traitement pour établir une référence normalisée en matière de prestation de services.
Échéancier : Exercice 2026 à 2027
- Le SCC élabore de la formation, des processus d’intégration, des politiques, des procédures et des directives propres à la fonction et à l’objectif des CRT et au bien-être des patients.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE
Reconnaissant l’importance d’une communication claire des rôles et des responsabilités au personnel, en particulier dans les environnements spécialisés comme les centres régionaux de traitement, le SCC s’efforce de peaufiner les processus internes pour mieux soutenir le personnel et assurer une compréhension uniforme à l’échelle de l’organisation.
Le SCC peaufine les procédures d’intégration du personnel de la santé dans le cadre de la stratégie globale en matière de ressources humaines pour le Secteur des services de santé. Dans le cadre de cette initiative, les besoins uniques du personnel des centres régionaux de traitement en matière d’intégration seront déterminés à l’aide d’une évaluation des besoins d’apprentissage.
De plus, le Secteur des services de santé du SCC a entrepris un examen exhaustif des besoins de perfectionnement professionnel pour veiller à ce que les professionnels de la santé, y compris ceux qui travaillent dans les centres régionaux de traitement, développent toutes les compétences associées à leur champ d’exercice.
Le SCC examinera également les politiques et les lignes directrices en vigueur liées aux centres régionaux de traitement pour recenser des possibilités de réaliser des gains d’efficience et d’apporter des précisions. Les politiques révisées préciseront clairement la fonction et la raison d’être des centres régionaux de traitement, et accorderont une grande importance à la santé et au bien-être des personnes incarcérées.
Prochaines étapes :
- Le SCC a entrepris un examen des centres régionaux de traitement pour établir une référence normalisée en matière de prestation de services.
- Le SCC peaufinera les procédures d’intégration du personnel de la santé dans le cadre de la stratégie globale en matière de ressources humaines pour le Secteur des services de santé.
- Le SCC réalisera un examen exhaustif des besoins de perfectionnement professionnel pour aider les professionnels de la santé à développer toutes les compétences associées à leur champ d’exercice.
Échéancier : Exercice 2026 à 2027
- Le SCC élabore un mandat et un énoncé de mission précis qui reflètent le but, les objectifs et la méthodologie autour desquels le personnel de toutes les disciplines peut unir collectivement ses efforts pour atteindre un objectif commun.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE
Dans le cadre de son examen des centres régionaux de traitement, le SCC examinera toutes les politiques et lignes directrices en vigueur afférentes pour établir une référence normalisée en matière de prestation de services. Les travaux comprendront l’établissement d’une orientation claire relativement au mandat et à la mission des centres régionaux de traitement et permettront d’assurer leur harmonisation avec les objectifs organisationnels généraux du SCC.
Une fois son examen exhaustif terminé, le SCC veillera à intégrer des mesures d’évaluation du rendement des activités des centres régionaux de traitement à son cadre de mesure du rendement. Cela permettra d’assurer une surveillance et une reddition de comptes cohérentes dans l’ensemble des centres régionaux de traitement.
Prochaines étapes :
- Le SCC a entrepris un examen des centres régionaux de traitement pour établir une référence normalisée en matière de prestation de services.
- Le SCC examinera toutes les politiques et lignes directrices en vigueur liées aux centres régionaux de traitement pour établir une référence normalisée en matière de prestation de services.
Échéancier : Exercice 2026 à 2027
- Le SCC élabore des pratiques pour s’assurer que le processus du CNE permette de trouver un juste équilibre entre l’enquête portant sur la conformité avec les enjeux relatifs aux questions de qualité, de nature et de fréquence des interventions offertes aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, y compris le traitement de ces rapports comme des outils d’apprentissage et de mobilisation des connaissances cohérents à l’échelle du service, afin de prévenir d’autres décès et blessures graves.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE EN PARTIE
La Direction des enquêtes sur les incidents et le Secteur des services de santé procèdent conjointement à un examen pour déterminer le mécanisme qui sera retenu parmi les suivants pour faire la lumière surtout décès en établissement : convocation d’un comité d’enquête nationale ou examen de la qualité des soins. Lorsqu’un décès est initialement considéré comme résultant de causes naturelles, le Secteur des services de santé ordonne la tenue d’un examen de la qualité des soins conformément aux règles, aux règlements et à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour examiner les facteurs liés aux soins de santé. Les responsables de l’unité opérationnelle concernée procèdent donne à un examen des soins fournis et les observations qui en découlent sont utilisées pour rédiger un rapport national d’examen de la qualité des soins.
S’il est déterminé qu’un comité d’enquête nationale doit être convoqué, l’examen porte sur des aspects clés de l’incident afin de cerner les problèmes récurrents et les pratiques exemplaires en lien avec la gestion des personnes sous la responsabilité du SCC et la prestation de soins à ces personnes. Des domaines d’enquête clairement définis permettent de mieux comprendre les problèmes, notamment en ce qui concerne la nature et la qualité des interventions effectuées auprès de toutes les personnes. La collecte, l’analyse, le suivi et l’évaluation des données en vue de cerner les tendances contribueront à améliorer la qualité, favorisant la prise de décisions éclairées et mettant en lumière les problèmes systémiques. La communication d’information et des résultats des examens de la qualité des soins et des enquêtes nationales permet de poursuivre l’apprentissage du personnel du SCC et d’assurer sa mobilisation continue pour éviter que de tels incidents se produisent a l’avenir.
Prochaines étapes :
Un examen de tous les incidents entrainant un décès ou des blessures graves est réalisé chaque semaine pour s’assurer que le secteur concerné se voit assigner l’enquête et pour éviter le dédoublement des efforts.
Échéancier : En cours
Examen et inclusion des domaines d’enquête stratégiques dans les ordres de convocation dans le but de cibler les domaines clés propres à l’incident pour un processus d’enquête simplifie.
Échéancier : Été 2025
Les résultats des examens de la qualité des soins et des enquêtes nationales sont communiqués par divers moyens et salon des délais préétablis.
Comptes rendus locaux et régionaux/nationaux : Des comptes rendus sont prévus à l’issue de chaque enquête nationale pour examiner les constatations et les recommandations et en discuter.
Échéancier : En coursRéunion sur les enquêtes nationales : Des cadres supérieurs de l’ensemble du Service se réunissent une fois par trimestre pour examiner les constatations liées aux problèmes récurrents et aux tendances, les pratiques exemplaires ainsi que les recommandations et les plans d’action issus des enquêtes nationales et des examens de la qualité des soins et en discuter.
Échéancier : Sur une base trimestrielleBulletins de constatations principales : Publication régulière et continue de bulletins trimestriels présentant une synthèse des constatations issues d’enquêtes nationales présentées à la réunion sur les enquêtes nationales (quatre fois par année) et de bulletins thématiques présentant les problèmes récurrents et les tendances (au besoin; probablement quatre fois par année).
Échéancier : En coursParticipation continue des enquêteurs nationaux de la Direction des enquêtes sur les incidents au continuum d’apprentissage mis en place en janvier 2022 Diverses possibilités d’apprentissage sont offertes pour préparer les enquêteurs à travailler efficacement en milieu correctionnel. Elles sont principalement axées sur la réalisation d’enquêtes impartiales et la compréhension des facteurs pertinents, comme les antécédents sociaux et de santé physique et mentale des détenus, ainsi que leurs vulnérabilités et leurs facteurs de protection.
Échéancier : Automne 2025.
Le SCC s’affaire à mettre à jour le processus d’examen de la qualité des soins afin de renforcer la prestation de soins, l’assurance et l’amélioration de la qualité, ainsi que la collaboration intersectorielle.
Échéancier : Automne 2025
- Le SCC désigne immédiatement, au minimum, un défenseur des droits des patients dans chaque CRT pour soutenir les soins centrés sur le patient et fournir une défense légitimement indépendante des patients dans leur navigation dans le système médical dans un contexte correctionnel.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE
Le Secteur des services de santé du SCC s’affaire déjà à mettre en place le Service de représentation des patients en 2025. Les délinquantes, les délinquants dans les établissements à sécurité maximale pour hommes offrant des services de soins intermédiaires en santé mentale et les délinquants dans les centres régionaux de traitement auront un accès prioritaire à ce service. Aux termes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Service de représentation des patients viendra appuyer les détenus en ce qui a trait aux questions en matière de soins de santé et aidera les détenus et les membres de leur famille ou une personne de confiance désignée par le détenu à comprendre les droits et les responsabilités des détenus en matière de soins de santé.
Le modèle du Service de représentation des patients est appuyé par le Comité consultatif national des défenseurs des patients, qui a été mis sur pied au printemps 2025 et qui est composé d’intervenants internes et externes Le Comité fournit des conseils et des recommandations dans le cadre de la mise en œuvre et de la prestation du Service de représentation des patients.
Prochaine étape : Le SCC a amorcé la mise en place du Service de représentation des patients, ce qui comprend la mise sur pied d’un comité consultatif. Le SCC procédera éventuellement à son élargissement afin d’offrir des services dans chaque région.
Échéancier : Exercice 2025 à 2026
Enfin, bien que seulement quatre des cinq CRT soient des établissements psychiatriques désignés en vertu de la législation provinciale sur la santé, j’informe le SCC que j’enverrai une copie de ce rapport aux cinq ministres provinciaux de la Santé où se trouvent les CRT pour leur faire part de mes préoccupations au sujet de la désignation provinciale des CRT comme hôpitaux psychiatriques en vertu de leur législation provinciale respective en matière de santé mentale.
Annexe A : Exemples de cas de recours à la force par les CRT
Une approche collaborative, interdisciplinaire et centrée sur la personne pour une évaluation de l’état physique suivant un recours à la force
Le vendredi 19 janvier 2024, au CRT (Millhaven), un patient en détresse a déclenché l’alarme de sa cellule. Le personnel d’intervention l’a trouvé, menaçant de s’automutiler si un gestionnaire correctionnel (GC) n’était pas appelé pour résoudre des problèmes avec certains de ses effets personnels. L’homme est monté sur sa toilette dans la cellule d’observation et a tenté de démonter le système d’extinction d’incendie. Un agent correctionnel a donné plusieurs ordres directs à l’individu de descendre de l’évier et de cesser de menacer de s’automutiler. L’homme s’est ensuite penché en avant, ce qui a amené l’agent à croire qu’il allait sauter la tête la première sur le plancher de béton. L’agent a ensuite aspergé le patient d’agent organique inflammatoire, ce qui l’a obligé à descendre au sol. Malgré les recommandations du personnel, l’homme a refusé d’être déplacé vers la décontamination. Bien que le recours à la force n’ait pas été saisi sur une caméra vidéo portative, ce qui a rendu impossible l’examen de l’intervention par le BEC, un analyste du recours à la force a examiné l’approche adoptée par le personnel après le déploiement de l’agent inflammatoire.
Après avoir eu recours à la force, le personnel s’est entretenu avec le patient à plusieurs reprises. Le personnel des soins de santé et de la santé mentale s’est rendu à la cellule du patient pour discuter de son état mental et de son bien-être physique. Le représentant en santé mentale a discuté avec lui pendant environ cinq minutes et lui a offert du soutien en santé mentale, malgré l’état d’agitation de la personne. Le patient est devenu de plus en plus hostile, ce qui a amené le personnel de santé mentale et les agents correctionnels à adopter une « approche axée sur le bien-être ». Par exemple, on les a vus l’encourager à accepter la douche de décontamination pour « se vider la tête ». Après que le personnel de santé mentale a quitté les lieux, le reste du personnel a continué à communiquer avec la personne, l’assurant que le GC était en route tout en réitérant qu’une douche de décontamination serait bonne pour lui. On pouvait entendre des membres du personnel de santé et des agents correctionnels discuter entre eux d’un plan pour assurer la sécurité de la personne, convenant que leurs efforts continus pour l’encourager à prendre une douche de décontamination étaient essentiels. Après que l’homme est monté sur sa toilette une fois de plus, on a vu le personnel engager une conversation pour tenter de désamorcer la situation. Une fois arrivé à la cellule, le GC s’est entretenu avec la personne en lui posant des questions sur son bien-être et son bien-être physique. Le patient a ensuite fourni des détails sur les raisons pour lesquelles son comportement s’est initialement exacerbé, notamment parce qu’il voulait un transfèrement d’établissement et qu’il avait un problème avec ses effets personnels. Le patient a de nouveau refusé, après de nouvelles tentatives du personnel, de prendre une douche de décontamination. Les efforts continus du personnel pour encourager le patient à prendre une douche de décontamination ont finalement été couronnés de succès, car il a accepté de prendre une douche environ 30 minutes après la discussion avec le GC.
L’approche adoptée lors de cette intervention interdisciplinaire au CRT (Millhaven) est rarement observée par le Bureau. Chaque membre du personnel qui s’est entretenu avec le patient a parlé de manière calme et respectueuse, même dans les moments où la personne était dans un état d’agitation. Les membres du personnel ont su quand se mobiliser verbalement avec lui, quand prendre du recul et lui donner de l’espace, et quand simplement l’informer qu’ils étaient présents et disponibles pour le soutenir. Le personnel s’est surpassé, offrant des possibilités de décontamination environ huit fois, dépassant ce qui est exigé par la politique. En conclusion, tout en se demandant si l’utilisation d’agents inflammatoires dans la situation du détenu était la réponse appropriée, le Bureau a constaté qu’une fois cette force utilisée, elle était suivie d’une approche « centrée sur la personne » qui devrait toujours être prioritaire dans le contexte particulier de la santé mentale.
De nombreux incidents de recours à la force et des décisions de transfert douteuses
Contrairement au premier exemple, le cas actuel démontre l’insuffisance du SCC à gérer efficacement les personnes ayant de graves besoins en matière de santé mentale. Il s’agit d’une femme incarcérée ayant des antécédents de problèmes de santé mentale qui purge sa première peine de ressort fédéral et qui a été impliquée dans de multiples incidents, dont la plupart relatifs à des voies de fait contre le personnel, et qui a été transférée à de nombreuses reprises. Plus précisément, les enquêteurs et les analystes du BEC ont relevé 66 incidents de recours à la force impliquant la patiente au cours de la période à l’étude (avril 2023 à février 2025), ce qui représente une moyenne de six incidents de recours à la force par mois. Les analystes ont noté que près de la moitié de ces incidents se sont produits en réponse à des comportements d’automutilation, dont 12 au Centre psychiatrique régional (CPR), un établissement qui devrait être en mesure de répondre aux besoins en matière de santé mentale. Il ne semble pas y avoir de différence entre les interventions prises par les agents du CPR et d’autres établissements pour femmes. Dans les incidents d’automutilation, le même scénario se répète : communication initiale, négociation, ordres verbaux, utilisation d’un bouclier et contrôle physique, utilisation d’un masque anti-crachat, application de menottes et, si elles sont estimées nécessaires, entraves. La délinquante a ensuite été placée dans le système de contrainte Pinel après l’autorisation du personnel médical. Bien qu’un tel processus puisse sembler rassurant à première vue en raison de sa nature graduelle, le Bureau est particulièrement préoccupé par l’utilisation excessive du système de contrainte Pinel, car la fréquence des interventions aurait dû assurer la prévisibilité et amener à envisager des solutions de rechange à une mesure aussi extrême.
De plus, depuis le début de sa peine au CPR en 2023, la délinquante a été transférée à plusieurs reprises entre plusieurs établissements. Elle a connu un nombre particulièrement élevé de transferts pendant une si courte période d’incarcération et, dans certains cas, a été dans un établissement pendant moins d’un mois, et ce, avant d’être transférée de nouveau. Bien que d’autres établissements aient déterminé le CPR comme l’établissement le plus approprié pour répondre aux besoins de cette personne, elle a tout de même été transférée à plusieurs reprises et sans plan clair pour gérer efficacement ses besoins. Par exemple, la raison invoquée par le CPR pour la décision de la transférer était « un manque général d’engagement envers les activités quotidiennes, les programmes et la thérapie ».
Établissant des similitudes inquiétantes avec les cas que nous avons déjà rapportés28, mon Bureau trouve pour le moins troublant qu’après avoir déterminé que la santé mentale d’une personne doit être suffisamment grave pour justifier son admission dans un centre de traitement, le Service invoque « un manque général d’engagement » de la part de la patiente pour justifier la fin des soins dans un établissement psychiatrique. Cependant, le SCC a décidé de transférer la patiente dans un établissement où le personnel et l’infrastructure thérapeutiques font défaut. Il ne devrait pas être surprenant que ses comportements de décompensation commencent à augmenter, ce qui entraîne en retour plus d’incidents de recours à la force. Mon Bureau continue de surveiller de près la situation de la délinquante dans son établissement, en particulier en ce qui concerne sa participation à des incidents de recours à la force, les évaluations de santé mentale auxquelles elle pourrait être soumise ainsi que toute décision susceptible d’avoir une incidence sur les transfèrements d’établissement.
Preuve de violence à l’endroit d’une personne incarcérée et faux témoignage du personnel
Le 10 mars 2025, au Centre régional de santé mentale, un patient a tenté d’attraper la main d’un agent qui livrait du papier hygiénique par la trappe de nourriture de la cellule. Croyant que son collègue risquait d’être agressé, un deuxième agent s’est précipité sur les lieux et a frappé les mains du patient de six à sept fois par la trappe ouverte. Cependant, aucune blessure n’a été relevée par le personnel infirmier lors de l’évaluation physique. Dans leurs rapports, les agents impliqués dans l’incident ont justifié les coups portés à l’individu en affirmant qu’il avait réussi à saisir le bras du premier agent, ce qui constituait une menace légitime justifiant une intervention de recours à la force. Notre analyse de l’incident a toutefois révélé que la tentative du patient d’attraper le bras de l’agent a été infructueuse. Le premier agent en question recule et s’éloigne de la trappe de nourriture avant que son collègue n’intervienne pour lui donner les coups. Étant donné que le patient est resté confiné dans sa cellule et que les coups ont été infligés près de dix secondes après le début de l’intervention du deuxième agent, il est impossible que des techniques de désamorçage aient été employées en réponse à la menace, si jamais elle était présente.
À la suite de l’examen préliminaire, l’établissement a réfuté le témoignage des deux agents correctionnels et a déterminé que le recours à la force n’était ni nécessaire ni proportionné L’examen a également permis de conclure qu’ils ne respectaient pas les règles énoncées dans le Modèle d’engagement et d’intervention (MEI), qui est censé guider le personnel du SCC dans l’application d’une approche équilibrée à l’utilisation d’une intervention centrée sur la personne.
Dans cet incident, mon Bureau ne s’inquiète pas seulement de la violence subie par le patient, mais le fait qu’il s’agisse d’une personne ayant des besoins en matière de santé mentale rend cette violence d’autant plus odieuse. Il est tout aussi choquant que deux fonctionnaires (c.-à-d. les agents qui se sont rendus dans la cellule du délinquant) ont tenté de dissimuler une violation flagrante du Code criminel et des règles régissant le recours à la force dans les prisons fédérales en fournissant un faux témoignage dans des rapports internes. La réponse du SCC à l’inconduite du personnel impliqué dans l’incident s’est limitée à des rappels verbaux lors des réunions de compte rendu et à l’utilisation du cas à des fins de formation. Dans ce cas-ci, la direction de l’établissement a jugé la situation suffisamment préoccupante pour alerter mon Bureau et la police. Par conséquent, le Bureau ne croit pas qu’une telle réponse soit adéquate, compte tenu des circonstances.
Passer entre les mailles du filet : les personnes purgeant une peine de ressort fédéral ayant des déficits cognitifs
Les troubles et les déficits cognitifs29 sont relatifs aux déficiences des fonctions cognitives d’une personne, y compris l’apprentissage, la mémoire, la perception, l’attention, la résolution de problèmes, le langage et le fonctionnement exécutif. Bien que la gravité et l’éventail des besoins cognitifs puissent varier considérablement d’une personne à l’autre, les personnes ayant des déficits cognitifs peuvent éprouver des pertes de mémoire, des difficultés d’attention, des difficultés d’organisation et de planification, ainsi que des difficultés de langage ou de perception.
Il est évident dans la littérature qu’il n’y a pas de définition uniforme des troubles intellectuels et cognitifs ou encore des incapacités, et que les termes peuvent varier selon ce que l’on essaie de saisir (par exemple, termes diagnostiques formels vs termes inclusifs plus larges). Aux fins de cette étude, le déficit cognitif sera utilisé comme un terme regroupant un éventail de déficiences et de troubles développementaux, cognitifs, intellectuels et neurologiques, avec un accent particulier sur les enjeux relatifs à la déficience intellectuelle ou développementale (DID), à trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF), le trouble du spectre de l’autisme (TSA), au traumatisme crânien (TC) et à certaines références au trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
Déficits cognitifs : prévalence et défis dans le milieu correctionnel
Bien que la plupart des personnes ayant des déficits cognitifs ne soient jamais impliquées dans le système de justice pénale, de plus en plus de données probantes suggèrent que ces personnes sont surreprésentées dans les milieux correctionnels30. Il existe de grandes divergences dans la littérature canadienne et internationale en ce qui concerne les taux de prévalence en raison de la variabilité des méthodologies, des outils d’évaluation, des échantillons de population, des définitions, etc. Par exemple, les taux de prévalence des personnes atteintes d’un TSA dans les services correctionnels varient de 2 % à 17 %31, tandis que les taux de personnes atteintes d’un TC varient de 5,5 % à 46 %32 Les taux de personnes atteintes du TSAF dans certains pays, comme l’Australie, atteignent 36 %, tandis qu’au Canada, la prévalence du TSAF dans les milieux correctionnels varie considérablement selon la méthode d’évaluation utilisée, allant de 1,8 % à 23 %33. Il est important pour les organismes correctionnels de connaître la prévalence, car cela donne une idée de la portée des besoins des personnes, qui devrait être utilisée pour éclairer l’affectation appropriée des ressources, des services et des approches de gestion des cas.
Les déficits cognitifs peuvent entraîner des comportements potentiellement difficiles en raison d’une déficience de la capacité de suivre des règles et des directives, de réguler les émotions et les actions, et de comprendre les codes et les comportements sociaux. La recherche suggère que ces enjeux peuvent entraîner des désavantages dans les milieux carcéraux, car ils peuvent faire des personnes la cible de violence et de victimisation et peuvent être confondus avec un non-respect intentionnel par le personnel, engendrant ainsi des mesures punitives34. Cela entraîne un isolement accru, des niveaux de sécurité plus élevés, des niveaux disproportionnés de recours à la force, ainsi qu’un cycle continu de problèmes35.
Selon la littérature, les personnes ayant des déficits cognitifs se retrouvent souvent face à des ressources limitées dans les services correctionnels, y compris des mécanismes de soutien et des programmes adéquats36. Les personnes en détention éprouvent souvent des difficultés de réadaptation dans l’établissement et de retour dans la collectivité en raison de leurs besoins uniques et de leurs ressources et services limités. La recherche a montré que cela entraîne souvent une boucle de rétroaction de la récidive37. Comme l’a si bien dit l’auteur d’un article, les personnes incarcérées avec une incapacité (y compris intellectuelles) sont les « prisonniers oubliés » et les soumettre à un environnement et à une culture carcérale intrinsèquement inadéquats, problématiques et « capacitistes » « néglige, aggrave et punit davantage leur incapacité »38. Bien que le Bureau ait abordé des enjeux semblables, comme les troubles d’apprentissage dans les contextes éducatifs, dans le rapport annuel de 2019-2020, les déficits cognitifs sont un domaine que nous n’avons pas étudié en profondeur et qui mérite donc une attention particulière.
Il est toutefois important de préciser que le SCC n’est pas la seule autorité correctionnelle à ne pas s’attaquer adéquatement aux déficits cognitifs. D’après mon expérience, je suis certain que, de manière universelle, toutes les autorités correctionnelles provinciales et internationales n’ont pas accordé suffisamment d’attention à cette importante question. Un récent rapport historique du Bureau de l’inspecteur des services de garde du gouvernement de l’Australie-Occidentale s’est penché sur cet enjeu particulier, soulignant de multiples lacunes et défis dans la gestion et le soutien des personnes ayant des déficits cognitifs en détention39. À mon avis, il s’agit d’une occasion unique à saisir pour le SCC afin de faire preuve de leadership à l’échelle nationale et internationale en élaborant des stratégies fondées sur des données probantes pour combler les déficits cognitifs en milieu carcéral.
Enquête en cours
Dans le cadre de la présente enquête, le Bureau a examiné l’approche du SCC en matière de détermination, de soutien et d’adaptation des services et des interventions pour les personnes ayant des déficits cognitifs. Comme il a été mentionné ci-dessus, cette enquête a porté sur le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF), le traumatisme crânien (TC), le trouble du spectre de l’autisme (TSA), et la déficience intellectuelle ou développementale (DID). Bien que nous n’ayons pas exclu le TDAH ou les troubles d’apprentissage40, ils l’ont été davantage lorsque nous avons examiné des domaines particuliers, comme les programmes et l’éducation. Les déficits relatifs à l’âge et à la démence dépassaient la portée du présent rapport, compte tenu des besoins uniques de cette population en matière de santé mentale et physique. Le Bureau a déjà publié un rapport spécial sur le vieillissement de la population dans les services correctionnels en 2019, qui mettait l’accent sur les défis cognitifs relatifs aux personnes atteintes de démence et de la maladie d’Alzheimer et sur la question intrinsèquement problématique des services correctionnels qui agissent comme établissements de soins de longue durée41. Les enjeux soulevés dans le présent rapport sont toujours d’actualité et continueront de s’accentuer à mesure que la population carcérale vieillissante augmentera.
Nous nous sommes appuyés sur de multiples sources, y compris des examens de la littérature internationale42, des documents, des politiques et des données du SCC, ainsi que des entrevues semi-structurées avec 35 employés du SCC. Le personnel interviewé variait selon les postes (par exemple, psychologues, chefs et gestionnaires de la santé mentale, personnel chargé de l’éducation, personnel chargé des programmes, membres du personnel infirmier, travailleurs sociaux, ergothérapeutes) et comprenait des représentants de toutes les régions, de tous les niveaux de sécurité et d’établissements pour hommes et pour femmes.
Nous sommes d’ailleurs très reconnaissants au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour le soutien et les conseils d’experts que nous avons reçus au cours de cette enquête. Le CAMH a effectué une revue exhaustive de la littérature pour nous et plusieurs psychiatres et professionnels de la santé mentale nous ont fourni des renseignements et des conseils précieux. Le SCC bénéficierait grandement de l’expertise du CAMH et devrait le consulter en tant que partenaire dans le cadre de sa réponse à nos recommandations. Le SCC devrait également envisager de faire appel à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel (INPLPP) de Montréal, au Québec, alors qu’il tente de combler les lacunes importantes dans les services proposés aux personnes ayant des déficits cognitifs. L’INPLPP a notamment développé une expertise importante dans ce domaine.
Au cours de cette enquête, et notamment grâce à l’information recueillie lors de notre analyse des données, de l’examen des documents et des entrevues, les thèmes suivants sont ressortis :
- des politiques désuètes et vagues qui fournissent peu d’indications;
- la prévalence des déficits cognitifs est probablement sous-estimée;
- la stigmatisation, la sécurité et les défis de la vie en établissement pour les personnes présentant des déficits cognitifs;
- des outils de dépistage et d’évaluation inefficaces et incohérents font en sorte que les personnes passent entre les mailles du filet;
- les programmes correctionnels, l’éducation et la formation professionnelle manquent de réceptivité;
- une formation inadéquate du personnel et l’insuffisance des ressources compromettent la qualité des soins.
Constatations
Des politiques désuètes et vagues qui fournissent peu d’indications
Les principaux documents de politique qui guident la gestion par le SCC des personnes purgeant une peine de ressort fédéral ayant des déficits cognitifs sont la Ligne directrice 800-10 : Déficience intellectuelle43 et les Lignes directrices en santé mentale du SCC44. Lors de notre examen de ces documents, nous avons constaté que le contenu et les directives de ces documents étaient vagues, de haut niveau et brefs. Par exemple, la Ligne directrice 800-10 qui est spécifique à la déficience intellectuelle, ne fait que deux pages, et ne tient pas compte d’autres déficits cognitifs, malgré la complexité des besoins de cette population. La majorité de la politique redirige le personnel vers plusieurs autres politiques qui traitent d’approches génériques des opérations du SCC qui mentionnent rarement les besoins propres aux personnes ayant des déficits cognitifs. Au cours de nos entrevues avec le personnel, nous avons appris que la politique était perçue comme inadéquate et offrait peu d’orientations. Le personnel a également noté que, comparativement aux versions précédentes, les Lignes directrices en santé mentale du SCC actuelles semblent « diluées » et, comme l’a indiqué un membre du personnel, « négligent complètement les besoins de cette population ». Bien que les besoins cognitifs soient différents de ceux d’autres problèmes de santé mentale, comme le trouble de la personnalité limite ou la schizophrénie, les déficits cognitifs relèvent toujours de la catégorie plus large de la santé mentale et relèvent donc de la responsabilité du personnel en santé mentale du SCC. En plus d’exiger des révisions mises à jour (cette Ligne directrice devait être révisée en 2020 et n’a pas encore été mise à jour), une orientation plus concrète et des directives pratiques pour le personnel sont clairement nécessaires.
La prévalence des déficits cognitifs est probablement sous-estimée
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la prévalence des personnes ayant des déficits cognitifs dans le système correctionnel fédéral demeure difficile à établir. Selon les données fournies par le SCC, selon ses estimations et ses définitions, seulement 4,1 % de la population carcérale a reçu un diagnostic lié à un déficit cognitif, un nombre qui grimpe à 17 % lorsque le TDAH est inclus (tableau 1).
Tableau 1. Prévalence des personnes incarcérées sous responsabilité fédérale ayant reçu un diagnostic de déficit cognitif
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
|---|---|---|---|
| Tous les diagnostics de déficit cognitif | 12,7 % | 16,2 % | 17,2 % |
| Diagnostics de déficits cognitifs, à l’exclusion du TDAH | 2,4 % | 3,8 % | 4,1 % |
| Par diagnostic | |||
| Trouble du spectre de l’autisme (TSA) | 0,2 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) | 11,1 % | 14,0 % | 15,0 % |
| Déficience intellectuelle | 1,0 % | 1,4 % | 1,4 % |
| Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) | 0,5 % | 1,0 % | 1,3 % |
| Lésion cérébrale acquise | 0,6 % | 1,1 % | 1,1 % |
Remarque. Les chiffres peuvent ne pas correspondre au total général, car les personnes peuvent avoir plus d’un diagnostic.
Les données du SCC indiquent également que seulement 1,5 % de la population sous responsabilité fédérale possède un indicateur de déficience cognitive du Système de gestion des délinquants (SGD)45. Selon la façon dont les déficits cognitifs sont définis et mesurés, ces chiffres varient considérablement, et ce, même dans les rapports du SCC. Par exemple, une recherche antérieure du SCC a estimé que quelque 25 % des hommes incarcérés dans une région avaient un certain niveau de déficit cognitif, et que 15 % avaient des déficits multiples ou au moins un déficit grave46. Plusieurs membres du personnel que nous avons interviewés ont indiqué que le SCC sous-estime la prévalence, certains estimant que les chiffres sont plus proches de 25 % à 30 %. Un membre du personnel a indiqué que, même si la prévalence est inférieure, les besoins sont très variés et nécessitent un soutien important, comme elle l’a fait remarquer : « Si j’ai cinq personnes autistes, cela peut sembler petit dans la population, mais c’est beaucoup de travail et de ressources pour répondre à leurs besoins. »
La stigmatisation, la sécurité et les défis de la vie en établissement pour les personnes présentant des déficits cognitifs
Conformément aux défis individuels décrits dans la littérature plus large, le personnel qui nous a parlé a donné un aperçu de l’expérience institutionnelle des personnes ayant des déficits cognitifs. Plusieurs membres du personnel ont souligné le défi des personnes qui ne veulent pas accepter un diagnostic, admettre qu’elles ont un déficit ou accepter l’aide du personnel pour diverses raisons, y compris la stigmatisation. Il peut donc être très difficile de s’engager efficacement avec ces personnes, ce qui a des répercussions négatives sur leur réadaptation. De nombreux membres du personnel ont également soulevé des préoccupations pour la sécurité de ces personnes, soulignant que beaucoup d’entre elles courent un risque plus élevé d’être victimisées, intimidées et exploitées. Par exemple, le personnel a décrit des incidents où des personnes ayant des déficits cognitifs avaient accumulé des dettes importantes envers d’autres personnes incarcérées parce qu’elles ne comprenaient pas le concept de dette. Dans d’autres cas, des personnes ont subi des pressions ou ont été manipulées pour agresser d’autres personnes ou s’impliquer dans des incidents, ce qui a entraîné des infractions et des rapports d’incident à leur dossier.
Nous avons entendu dire que beaucoup de ces personnes font souvent face à des problèmes de surcharge sensorielle, de régulation émotionnelle et de contrôle des impulsions, de mémoire, de respect d’horaires et de règles, et de participation à des programmes ou à l’école. Malheureusement, ces symptômes sont souvent interprétés à tort comme de la « désobéissance » et estimés comme de la non-conformité, ce qui peut dégénérer en une personne étiquetée comme un « cas problématique », créant ainsi un cycle d’adversité. Pour certaines personnes, maîtriser les tâches quotidiennes (par exemple, hygiène, lessive, préparation des repas, respect des rendez-vous) peut représenter une difficulté importante. Le personnel a indiqué que même si certaines personnes peuvent bien s’en sortir avec la structure et la routine de la vie en établissement, cela peut facilement changer lorsqu’une personne perd une partie de ce soutien lorsque cette structure change (par exemple, transfèrement dans un autre établissement, mise en liberté dans la collectivité).
Un dépistage et une évaluation inefficaces et incohérents font en sorte que les personnes passent entre les mailles du filet.
Le dépistage, l’évaluation et la détermination des déficits cognitifs sont une première étape essentielle vers des soins et des interventions adaptés. Selon la politique du SCC, un processus officiel est en place pour l’évaluation du fonctionnement cognitif, tel qu’il est décrit dans la Ligne directrice 800-10. Ce processus comprend notamment les étapes suivantes : 1) le dépistage et la détermination à l’admission; 2) l’aiguillage par le chef des services de santé mentale pour une évaluation et un diagnostic potentiel par un psychologue spécialisé; 3) la rédaction d’un rapport détaillé contenant des recommandations pour des soins et des interventions appropriés; 4) l’activation d’un indicateur de besoins en matière de troubles cognitifs dans le Système de gestion des délinquants et la diffusion du rapport à l’équipe de gestion de cas pour qu’elle en tienne compte dans son plan correctionnel.
Selon la documentation du SCC, les principaux outils de dépistage utilisés par les Services de santé afin d’examiner le fonctionnement cognitif et signaler une évaluation de suivi potentielle sont les suivants :
- Évaluation du Système informatisé de dépistage des troubles mentaux à l’évaluation initiale (SIDTMEI), qui comprend la Mesure des capacités cognitives générales pour adultes (General Ability Measure for Adults [GAMA])47.
- L’Échelle des besoins en santé mentale (EBSM), qui comprend les cotes des besoins globaux en matière de santé mentale et les cotes des besoins en matière de santé mentale dans des domaines précis de fonctionnement48.
- L’Examen de l’état mental (EEM), qui comprend une évaluation structurée et un « instantané » du fonctionnement comportemental et cognitif actuel.
D’après les résultats de ces outils de dépistage, si les personnes sont repérées, elles devraient être dirigées vers une évaluation plus approfondie et un diagnostic officiel possible par les Services de santé. Cependant, de nombreux membres du personnel à qui nous avons parlé ont remis en question l’efficacité de ces outils de dépistage et leur capacité à repérer les personnes pour une évaluation plus approfondie. Par exemple, étant donné que le SIDTMEI est informatisé, volontaire et nécessite une formation spécialisée pour l’administrer, son utilisation est inconsistante. Dans certains sites qui n’avaient pas de personnel formé à l’égard du SIDTMEI, aucune personne incarcérée n’a fait l’objet d’un dépistage. Même le personnel qui administre les outils n’était pas convaincu que ces mesures décrivent adéquatement les déficits cognitifs. Par exemple, un membre du personnel a précisé que des affections comme les lésions cérébrales, les troubles du spectre de l’autisme et le TSAF ne sont pas prises en compte par l’EBSM et d’autres outils semblables.
Bien que la politique du SCC décrive une approche structurée et officielle pour aiguiller et évaluer les personnes en vue d’un diagnostic officiel, l’information communiquée au Bureau suggère le contraire. Le personnel nous a indiqué que, même si les outils de dépistage identifient une personne, le processus d’aiguillage et d’administration des évaluations cognitives ou neuropsychologiques comporte plusieurs lacunes, notamment une grande variabilité dans l’accès, la rapidité et le type d’évaluations cognitives administrées. Certains sites comptaient des psychologues qualifiés pour administrer certaines évaluations, tandis que d’autres devaient confier des évaluations à une ressource communautaire ou diriger les personnes vers un centre régional de traitement (CRT) du SCC. Pour cette raison, selon l’endroit où la personne est évaluée, différents outils et processus de diagnostic peuvent être utilisés. Bien qu’un diagnostic officiel ne soit pas toujours requis pour déterminer les besoins d’une personne, il peut être essentiel pour développer des plans de traitement efficace et déterminer les soutiens appropriés. Dans certains cas, particulièrement dans la communauté, un diagnostic est nécessaire pour avoir accès aux services.
La plupart des sites ont indiqué que la dotation était le principal défi pour cerner rapidement les besoins des personnes, soumettre des références et obtenir une évaluation en temps opportun. Ces outils d’évaluation comportent un fardeau administratif et le personnel qualifié pour les administrer est limité, ce qui signifie que le personnel en santé mentale doit prioriser les cas ayant des besoins plus élevés et les problèmes aigus de santé mentale. Cela était encore plus évident dans les sites pour femmes, où la majorité n’a pas d’accès direct aux ressources d’un CRT49. Comme l’a indiqué un membre du personnel des Services de santé : « Je n’ai pas le “luxe ” d’envoyer des femmes au CRT pour une évaluation et un traitement. Je peux soumettre une recommandation, mais cela signifie déraciner la personne, et ce, à quel prix? » De nombreux sites ont noté que, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas extrême ou que la personne ne vienne à l’établissement avec un diagnostic existant, les déficits cognitifs ne sont tout simplement pas estimés comme une priorité pour l’évaluation et le diagnostic. La priorité semble être la gestion de crise et la stabilisation des besoins aigus en santé mentale. Comme l’a indiqué un membre du personnel, l’accent est mis sur « l’extinction des incendies ». Pour aggraver davantage ce problème de ressources, plusieurs membres du personnel ont noté que les psychologues sont presque entièrement occupés à essayer de réaliser des évaluations psychologiques du risque (EPR), une question que nous avons soulevée dans notre dernier rapport annuel50. Comme l’a indiqué un membre du personnel des Services de santé : « Il y a une question d’évaluation de la santé mentale versus l’évaluation intellectuelle et le SCC n’est pas dans le métier d’évaluer la capacité intellectuelle ou cognitive, mais cela a une incidence directe sur l’incarcération, la réadaptation et la mise en liberté d’une personne incarcérée. »
Tous les membres du personnel que nous avons interviewés nous ont indiqué que le processus actuel de dépistage et d’évaluation ne capte pas beaucoup de personnes ayant des déficits cognitifs qui ont besoin de soutien. Nous avons entendu à maintes reprises l’expression « passer entre les mailles du filet » par les membres du personnel pour désigner les personnes qui se perdent dans le système, qui ont de la difficulté à s’adapter à l’environnement institutionnel et qui ont inévitablement de la difficulté à se réhabiliter. Comme l’a indiqué un membre du personnel en parlant de sa frustration face à l’insuffisance des outils et du processus d’évaluation des déficits cognitifs du SCC : « Nous ne réussissons pas à capter ces personnes-là, et cela a une incidence directe sur le succès de l’incarcération et de la mise en liberté de la personne. »
Défis relatifs à l’évaluation du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) – Exemple de cas
Le Bureau a appris qu’une personne présentait clairement des difficultés cognitives, mais qui se voyait refuser des opportunités (par exemple, permissions de sortir, placements à l’extérieur) parce qu’elle souffrait probablement du TSAF. Par exemple, dans le cadre d’une évaluation en vue d’une décision où le SCC a refusé une demande de permission de sortir avec escorte (PSAE), le SCC a constaté que la personne était probablement atteinte du TSAF et a énuméré plusieurs symptômes du TSAF pour justifier le refus (par exemple, problèmes d’autorégulation, faibles compétences en résolution de problèmes). Bien qu’il ait déterminé la probabilité du TSAF, rien ne prouvait que le SCC avait pris des mesures pour faire évaluer cette personne aux fins d’un diagnostic ou lui donner accès à des services appropriés. Après les interventions de ce Bureau, au moment de la rédaction du présent rapport, cette personne devait subir une évaluation officielle concernant le TSAF. Le personnel du SCC a reconnu que cela l’aiderait à comprendre et à prendre en compte les problèmes de réceptivité de cette personne en ce qui concerne les décisions concernant les placements à l’extérieur et les PSAE.
Clinique d’évaluation et de diagnostic du TSAFc
Le processus d’évaluation du TSAF exige beaucoup de ressources et peut souvent être difficile en raison de renseignements inconnus ou manquants concernant l’exposition prénatale à l’alcool, les antécédents médicaux, les actes de naissance, etc. La clinique d’évaluation et de diagnostic du TSAF du SCC, qui a d’abord été mise à l’essai au Centre psychiatrique régional (CPR) en 2018-2019, a été mise sur pied pour mieux déterminer les patients atteints d’un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale et élaborer des recommandations de traitement pour faciliter la réadaptation et la mise en liberté éventuelle d’une personne. Le modèle de clinique est désormais disponible dans les CRT des régions des Prairies, de l’Atlantique et du Pacifique. Le processus de diagnostic et de recommandations comprend plusieurs étapes :
- la réception et présélection par le coordonnateur du programme;
- l’évaluation psychologique complète par le neuropsychologue;
- la mesure des traits faciaux sentinelles par le clinicien-psychiatre principal;
- l’évaluation des aptitudes à la vie quotidienne et des besoins par l’ergothérapeute;
- la réunion de la clinique avec la participation de toute l’équipe du TSAF;
- la communication du diagnostic au patient par le coordonnateur clinique et le psychiatre;
- la planification clinique du congé effectuée par un travailleur social.
Bien que la clinique du CPR ait montré des pratiques prometteuses avec plusieurs employés dévoués51, au moment de nos entrevues, le Bureau a été informé que la clinique était à l’arrêt en raison des problèmes de recrutement et de contrats.
Les programmes correctionnels, l’éducation et la formation professionnelle manquent de réceptivité
De nombreux thèmes sont ressortis de nos entrevues concernant les lacunes et les défis de l’approche du SCC à l’égard des programmes correctionnels, de l’éducation et de la formation professionnelle. Des décennies de données probantes ont longtemps démontré que les interventions correctionnelles qui s’harmonisent avec les principes du Risque-Besoin-Réceptivité (RBR) sont plus efficaces pour réduire le risque de récidive52 d’une personne. Le principe de réceptivité fait référence à la prestation d’interventions et de programmes d’une manière compatible avec le style d’apprentissage et les capacités d’une personne Le concept de réceptivité est mentionné dans les politiques, les lignes directrices et les documents de programmation du SCC. Malheureusement, comme l’illustrent nos constatations, ce principe est souvent négligé lorsqu’il s’agit de personnes ayant des déficits cognitifs.
Programmes correctionnels
Au SCC, il existe deux principaux types de programmes : les programmes généraux, qui sont conçus pour la population générale, et les programmes adaptés, qui s’adressent aux personnes qui ne sont pas en mesure de participer aux options générales en raison de « besoins particuliers en matière de réceptivité, y compris les besoins en matière de santé, les déficiences intellectuelles et développementales (déficiences cognitives), les incapacités physiques ou les troubles d’apprentissage qui pourraient avoir une incidence importante sur leur fonctionnement53 ».
Général. Selon le SCC, pour terminer le programme général, « un délinquant doit être en mesure d’apprendre et de comprendre de nouveaux concepts et compétences, de comprendre comment ces concepts s’appliquent à sa vie (en ce qui concerne lui-même et ceux qui l’entourent) et être en mesure de comprendre l’incidence de ces nouvelles compétences sur ses facteurs de risque. Dans le cadre du MPCI [Modèle de programme correctionnel intégré], on s’attend à ce que les délinquants soient en mesure de s’asseoir et d’apprendre pendant une période de deux heures, sans devenir trop agités, distraits, somnolents ou excessivement perturbateurs54. » Il s’agit d’une attente irréaliste pour de nombreux membres de la population carcérale, et pas seulement pour ceux qui gèrent des déficits. Le personnel chargé des programmes nous a indiqué que les personnes ayant des déficits cognitifs ont souvent de la difficulté à comprendre dans les programmes généraux et que cela se manifeste généralement de deux façons : 1) une personne a du mal à suivre le programme, se tait, essaie de se cacher ou se désengage; ou 2) une personne devient frustrée et perturbatrice, et cause des problèmes avec les autres participants. Dans ces cas, certains membres du personnel ont noté que les avantages des programmes peuvent être limités, et les personnes sont souvent étiquetées comme non conformes, ce qui peut notamment avoir des répercussions négatives et à long terme sur leur plan correctionnel.
Adapté. Le programme adapté a été conçu pour fournir aux personnes un contenu semblable à celui inclus dans le courant principal, mais avec des modifications comme des groupes plus petits (six participants), des séances plus courtes, un contenu modifié pour répondre aux besoins de réceptivité et plus d’occasions de soutien individualisé de la part de l’animateur. Bien que cette approche puisse sembler prometteuse sur papier, cette enquête a relevé de multiples lacunes et défis dans la pratique. Premièrement, le programme adapté n’est disponible que dans les sites pour hommes et principalement offert uniquement dans les CRT. De plus, nous avons découvert que dans certains CRT, le programme adapté n’avait pas été offert depuis des années, laissant plusieurs établissements et dans un cas, une région entière, sans options de programmation adéquates. Le personnel a également fait remarquer que la participation à une programmation adaptée est volontaire et que l’idée d’être transféré à un site du CRT décourage souvent les gens d’y participer. Certaines personnes ont fait remarquer que, dans certains cas, la perturbation du transfèrement ferait plus de mal que de bien.
Deuxièmement, les critères d’admission au volet du programme adapté sont assez stricts et donc limitatifs. À moins qu’une personne ne présente des déficits cognitifs importants et des besoins comorbides, elle est rarement admissible à la participation. Plusieurs personnes interrogées dans différents sites ont décrit un cycle répétitif de rejet de leurs recommandations. Un membre du personnel a dit avoir été tellement découragé par cela qu’il ne voyait plus l’intérêt de « consacrer tout le travail aux renvois », sachant qu’ils seraient simplement rejetés. Par conséquent, selon le SCC, il n’y avait que 60 inscriptions à ces programmes en 2023-2024. Étant donné la sous-estimation flagrante par le SCC de la prévalence des personnes en détention ayant des déficits cognitifs, 60 inscriptions (dont certaines n’ont peut-être même pas terminé le programme) sont bien inférieures au nombre de personnes qui pourraient bénéficier de ces types d’intervention. Même en utilisant les propres estimations du SCC de la prévalence des personnes ayant des déficits cognitifs, ces inscriptions suggèrent que le SCC n’offre des programmes adaptés qu’à environ 3 % de cette population55.
Troisièmement, la question des échéanciers irréalistes pour l’achèvement des programmes correctionnels a été soulevée par le personnel, invoquant le fait que ces pressions vont notamment à l’encontre de l’objectif des interventions. Comme l’a fait remarquer un gestionnaire des programmes correctionnels, « l’AC se concentre uniquement sur les chiffres. Faire plus de travail individuel est ce dont ces personnes ont besoin, mais cela ne donnera pas au SCC les chiffres qu’il veut. Il y a tellement plus d’accent sur la quantité versus la qualité maintenant, ce n’était pas comme ça quand j’ai commencé. » Un autre membre du personnel du programme a indiqué : « Les traîner à terminer le programme pour obtenir un “a assisté à toutes les séances” et aucun gain notable (puisqu’ils n’intègrent pas les concepts du programme, et encore moins les appliquent à des situations de la vie réelle) leur rend un mauvais service dans leur plan correctionnel. »
Nous avons entendu du personnel que, sans avoir un programme adapté facilement disponible et accessible, il incombe aux animateurs de faire du travail supplémentaire, d’ajuster le matériel, de fournir des ressources supplémentaires et plus de temps individuel pour aider les personnes ayant des déficits cognitifs et répondre à leurs besoins de réceptivité. Bien que le SCC mentionne le Module motivationnel (MM) – Volet soutien56 comme un mécanisme supplémentaire pour les personnes « admissibles » qui ont besoin de soutien dans leur participation au programme, le personnel a rarement mentionné cette option comme une option efficace lors de nos entrevues. Bien que le MM est parfois offert par d’autres membres du personnel chargé des programmes, la plupart du temps, il incombe à l’animateur du programme de fournir le soutien. Comme l’a fait remarquer un animateur de programme, « MM est ce que nous faisons déjà. Ce n’est pas une mesure de soutien supplémentaire. » Certains animateurs avaient pris l’initiative d’obtenir une formation externe portant sur les déficits cognitifs, d’acheter des ressources externes sur le sujet et d’appliquer ces connaissances pour adapter eux-mêmes les programmes; cependant, certains ont dit qu’ils avaient été réprimandés pour avoir essayé d’adapter le matériel, car cela peut compromettre « l’intégrité du programme ». Selon un gestionnaire des programmes correctionnels, « le SCC fait un travail horrible pour répondre aux exigences visant à offrir des programmes accessibles aux personnes ayant des déficits cognitifs. Cela dépend en grande partie de la créativité de l’animateur. »
Bien que le SCC ait mis en évidence des exemples de « trousses de réceptivité » qui visent à fournir des stratégies et des outils au personnel chargé des programmes qui travaille avec des personnes ayant des déficits cognitifs, les personnes interrogées nous ont indiqué que « personne ne les utilise ». Après examen de ces documents, l’information semble principalement de nature introductive et ne semble pas suffisante pour outiller les animateurs pour répondre à des besoins aussi divers.
Au cours de plusieurs entrevues avec des membres du personnel, nous avons entendu que, dans l’ensemble, le SCC ne fournit pas d’approche systématique et efficace pour répondre aux besoins de réceptivité des personnes ayant des déficits cognitifs dans les programmes. Même une évaluation interne du SCC57 a permis de signaler des préoccupations semblables en 2020, notant que la plupart des personnes ayant une incapacité intellectuelle, des troubles d’apprentissage ou des lésions cérébrales ne recevaient pas « d’adaptations, d’outils ou de soutien adéquats pour les aider à participer, malgré ces besoins ». L’évaluation a également permis de constater que « le personnel a déclaré avoir accès à des outils limités pour répondre aux besoins des délinquants ». Un rapport de recherche58 plus récent du SCC a révisé un échantillon de dossiers des animateurs de programme pour les participants ayant des déficiences cognitives ou des troubles d’apprentissage. Malgré que le rapport ait souligné que diverses mesures d’adaptation sont utilisées par les animateurs, il n’y a pas une approche uniforme ou une façon normalisée de suivre cette information. Le rapport a reconnu une lacune notable dans l’impossibilité de démontrer si les mesures d’adaptation répondent efficacement aux besoins des personnes. Les résultats suggèrent également qu’il incombe aux animateurs du programme d’aborder les facteurs de réceptivité des participants ayant des déficits cognitifs. Bien que cela fasse partie de leur rôle, nous avons appris lors de nos entrevues que les animateurs ne reçoivent ni le soutien ni les outils adéquats pour s’acquitter efficacement de ces responsabilités.
Éducation et formation professionnelle
Pour l’éducation, le SCC offre le programme de Formation de base des adultes – Programme adapté, qui a été adapté aux personnes ayant des « besoins particuliers en matière d’éducation auxquels on ne peut pas répondre à l’aide des programmes réguliers de formation de base des adultes59 ». Le personnel a parlé de pratiques et d’outils prometteurs, comme le Projet d’éducation numérique (PEN)60, les stylos de lecture et le programme WordQ61. Nous avons entendu parler de l’importance d’enseigner la littératie numérique et de fournir des outils accessibles, en particulier pour les personnes ayant des déficits cognitifs. Le PEN et d’autres ressources numériques ont été décrits comme étant essentiels à l’apprentissage et leur introduction a fait une différence importante pour les élèves ayant des déficits cognitifs et des difficultés d’apprentissage. Bien qu’il y ait eu des progrès, le personnel a également reconnu qu’il était toujours en retard en matière de technologie, d’accessibilité et de ressources éducatives. Un site a mentionné qu’il n’avait installé que récemment des ordinateurs fonctionnels dans la bibliothèque, tandis qu’un autre site avait quant à lui récemment délaissé les disquettes. L’accès à la technologie moderne (par exemple, tablettes) et à Internet, une question que le Bureau a soulevée à plusieurs reprises62, constitue encore une lacune importante dans l’éducation, non seulement pour les personnes ayant des déficits cognitifs, mais pour toutes les personnes incarcérées sous responsabilité fédérale.
Un autre thème qui est ressorti est l’importance démesurée accordée par le SCC aux exigences en matière d’éducation et de niveau scolaire pour que les personnes puissent aller de l’avant dans leurs plans correctionnels. Comme l’ont dit plusieurs membres du personnel chargé de l’éducation, le SCC estime la 12e année comme la seule issue, quels que soient les besoins individuels, les capacités cognitives ou si elle est réellement bénéfique pour la personne. Un membre du personnel chargé de l’éducation a fait remarquer : « Les détenus souffrant de déficience cognitive sont souvent stationnés à l’école dans le but de les aider à terminer leur scolarité. Tout le monde est frustré, mais leur plan correctionnel stipule qu’ils doivent être à l’école. Nous ne leur rendons pas service, car certains ne pourront peut-être jamais terminer leurs études. Ce que nous devrions faire, c’est plutôt les préparer à être indépendants dans la collectivité. »
Un membre du personnel a donné l’exemple d’une personne ayant un niveau de scolarité limité, de multiples déficits cognitifs et des troubles d’apprentissage, qui a éprouvé des difficultés scolaires et qui a eu de la difficulté à s’adapter à l’environnement institutionnel. Grâce aux efforts considérables déployés par le personnel pour fournir des mesures d’adaptation, des outils et un soutien individuel supplémentaires, cette personne a pu progresser dans ses études secondaires plus que quiconque l’avait prévu. Malgré cette réalisation notable, il a toujours été étiqueté comme non conforme, car il n’a pas pu terminer ses études de 12e année. Comme l’a fait remarquer un membre du personnel chargé de l’éducation : « Pour mobiliser de manière productive les gens [ayant des déficiences cognitives], nous devons leur donner des choses qu’ils peuvent être en mesure de gérer, du soutien par les pairs, les aider à faire la transition de l’école à l’emploi avec un coach professionnel. Nous n’allons pas les éduquer ou les guérir de leurs déficits, mais nous sommes tout de même obligés de faire quelque chose! »
Bien que les programmes de formation professionnelle et les possibilités d’emploi n’aient pas été discutés en profondeur au cours des entrevues, plusieurs membres du personnel ont souligné l’importance de ces programmes, en particulier pour les personnes ayant des déficits cognitifs. La mobilisation à l’égard d’un emploi peut fournir une structure et des compétences essentielles à ces personnes à leur mise en liberté. Certains membres du personnel ont fait remarquer que les possibilités d’emploi appropriées étaient limitées pour les personnes ayant des déficits cognitifs. Les personnes interrogées ont également parlé de l’importance d’un coordonnateur professionnel expérimenté qui peut travailler avec les forces et les capacités d’une personne, tout en soulignant qu’il s’agit d’un manque de personnel dans plusieurs sites.
Une formation inadéquate du personnel et l’insuffisance des ressources compromettent la qualité des soins
La majorité des sites ont reconnu que leur personnel n’avait pas reçu une formation adéquate pour travailler avec des personnes ayant des déficits cognitifs. Dans certains cas, le personnel a pris l’initiative de faire appel à des experts externes pour offrir des ateliers aux employés afin d’accroître la sensibilisation et la compréhension des déficits cognitifs. Certains membres du personnel ont parlé d’utiliser leurs fonds personnels pour suivre une formation à l’extérieur du SCC. Les personnes interrogées ont décrit le besoin d’une formation plus pratique, en personne et interactive par des professionnels qualifiés qui met l’accent sur l’apprentissage et l’application des compétences en milieu correctionnel. Ce besoin est devenu encore plus évident lorsqu’il s’agit du personnel opérationnel. Comme l’a indiqué une personne interrogée : « Je ne pense pas que la plupart des employés de première ligne sachent quoi que ce soit de ce genre de besoins [cognitifs] à moins d’avoir un lien personnel ou une expérience dans ce domaine. La plupart des agents correctionnels n’ont aucune idée de ce qui se passe – ils pensent simplement que la personne est “bizarre” et la rejettent et l’ignorent complètement, ou se concentrent trop sur elle et interprètent mal ses comportements. »
Selon le SCC, les déficits cognitifs font partie de la formation obligatoire portant sur les principes fondamentaux de la santé mentale offerte à toutes les recrues correctionnelles. Après avoir examiné ces documents, il est devenu très évident que la formation est terriblement inadéquate. Seule une poignée de diapositives sont consacrées aux déficits cognitifs avec une information très limitée et des omissions importantes (par exemple, déficience intellectuelle ou développementale, ou trouble du spectre de l’autisme). De plus, les interventions recommandées, comme « soyez patient, offrez des conseils et des réconforts, fournissez des directives claires… », sont superficielles et de bon sens.
La patience devrait être une norme minimale pour ceux qui travaillent avec des populations vulnérables, en particulier dans un environnement correctionnel. Nous avons également examiné un programme de formation de trois heures sur les déficits cognitifs que le SCC a récemment élaboré à l’intention des agents de libération conditionnelle, et nous avons constaté que, même si les documents étaient plus instructifs et à jour, il s’agissait encore au mieux d’une introduction. Comme l’a décrit un membre du personnel : « Je ne peux pas penser à un autre emploi qui vous oblige à prendre en charge autant de cas complexes avec si peu de formation. »
Conclusion
Dans l’ensemble, nos constatations démontrent que, malgré les efforts individuels de certains employés, le SCC laisse systématiquement tomber les personnes ayant des déficits cognitifs. Des politiques et des lignes directrices vagues, un dépistage et une évaluation inadéquats, une formation insuffisante du personnel et des possibilités limitées de modification de l’apprentissage et de l’acquisition de compétences contribuent à ce que les personnes purgeant une peine de ressort fédéral passent entre les mailles du filet. On s’attend à ce que les personnes naviguent dans un système déjà difficile avec des moyens inéquitables de répondre aux attentes institutionnelles, et encore moins à être adéquatement préparées à relever les défis inhérents à la réinsertion sociale. Ces lacunes sont emblématiques d’un système qui les a oubliés. Comme l’a indiqué un membre du personnel en réfléchissant à l’approche du SCC en matière d’interventions et de gestion de cette population : « Nous [le SCC] étions sur le point de faire de grandes choses il y a 10 ou 15 ans, mais nous sommes restés stagnants et, dans certains cas, nous avons même reculé. Comment pouvons-nous revenir en arrière? Comment avons-nous mal tourné? Est-ce en raison des politiques? Est-ce en raison du financement? Est-ce en raison de la dotation en personnel? J’estime que c’est tout ce qui précède! »
Bien que les membres du personnel qui ont pris le temps de nous parler aient partagé plusieurs de leurs préoccupations, ils ont également partagé certaines pratiques qui pourraient les aider à mieux les soutenir dans leur travail quotidien avec les personnes ayant des déficits cognitifs. Ces approches comprenaient différentes idées, notamment :
- le recours à des équipes interdisciplinaires pour discuter des besoins de la personne;
- des programmes de soutien par les pairs pour aider à acquérir des compétences de base, à prendre des notes, à s’adapter à la routine de l’établissement, etc.;
- des stratégies compensatoires et des aides visuelles (par exemple, calendrier visuel, notes et fournitures à code de couleur, rendez-vous plus courts, routines modifiées);
- des services d’ergothérapie et de psychoéducation;
- des unités désignées (par exemple, des unités formelles et informelles pour placer les personnes ayant des déficits cognitifs qui ont besoin de plus de soutien, afin de réduire le risque de victimisation);
- travailler avec des organismes externes (par exemple, le FASD Network63) pour obtenir des ressources et du soutien dans l’établissement et dans la collectivité.
Un récit inquiétant qui est ressorti au cours de cette enquête est la notion du SCC de « traiter » les personnes ayant des déficits cognitifs, en particulier celles ayant des déficits plus graves. Les déficits cognitifs ne peuvent et ne doivent pas être « corrigés » ou « traités ». Il faut plutôt travailler avec les personnes en fonction de leurs besoins et leur fournir les outils et les compétences nécessaires à la vie quotidienne. Cela s’inscrit dans le mandat du SCC de contribuer à la sécurité publique en aidant les personnes à réussir leur réinsertion sociale. Nous avons entendu à maintes reprises que le SCC adopte une approche universelle, ce qui expose de nombreuses personnes à un échec inévitable. Comme l’a indiqué un membre du personnel : « Quel est donc l’objectif ultime? Est-ce pour cocher un tas de cases et répondre aux exigences en matière de rapports, ou est-ce plutôt pour soutenir ces personnes et leur donner les compétences dont elles ont besoin? ». La rigidité et l’accent mis par le SCC sur le respect des jalons normatifs linéaires doivent être revus dans le contexte des besoins individuels et dans un esprit de réceptivité et, en fin de compte, de sécurité publique.
Je recommande que le SCC, en étroite collaboration avec des organismes communautaires externes spécialisés dans les déficits cognitifs, mette en œuvre les mesures suivantes :
- Examiner et mettre à jour les Lignes directrices 800-10 : Déficience intellectuelle et les Lignes directrices en santé mentale afin de fournir des politiques et des lignes directrices plus complètes pour la prise en charge et la supervision des personnes ayant des déficits cognitifs d’ici la fin de l’exercice financier 2025- 2026. Cela doit se faire en consultation avec le personnel de l’établissement qui s’occupe quotidiennement de ces enjeux.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE EN PARTIE
Reconnaissant les besoins uniques des détenus souffrant de déficiences intellectuelles, le SCC a mis en place des services pour appuyer le personnel et les détenus dans des domaines ciblés, notamment en ce qui concerne les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale et les déficiences intellectuelles. De plus, le SCC continuera d’envisager des mesures de soutien et des services pour cette population.
La prestation d’interventions efficaces en temps opportun pour répondre aux besoins en santé mentale des personnes incarcérées dans les établissements fédéraux est une priorité pour le SCC. Des services de soins de santé mentale sont offerts selon le niveau de soins requis. Pour ce faire, le Service compte sur des équipes interdisciplinaires de professionnels de la santé pour fournir des services et un soutien de manière concertée et offrir des interventions pour aider à répondre aux besoins en santé mentale des délinquants.
Le SCC continue de mobiliser les partenaires internes et externes à l’appui de la prestation d’interventions en santé, notamment en lien avec les déficiences intellectuelles, et plus particulièrement la démence. À cette fin, le SCC s’engage à examiner sa politique en vigueur, les Lignes directrices 800-10: Déficience intellectuelle, dans le but de mettre à jour l’information relative aux déficiences intellectuelles. De plus, dans le cadre des travaux du SCC en lien avec les détenus âges, le Secteur des services de santé se penchera sur les besoins dans le cadre du travail auprès des délinquants souffrant de démence.
Les deux examens seront réalisés en consultation avec les intervenants internes et externes et ont pour but de veiller à ce que les lignes directrices et les processus à l’intention du personnel soient conformes aux pratiques du SCC et dans la collectivité.
Prochaines étapes :
- Le SCC entreprendra un examen des Lignes directrices 800-10 :
Déficience intellectuelle, et procédera à leur mise à jour.
Échéancier : Exercice 2026 à 2027 -
Le SCC entreprendra un examen de son modèle de soins
gériatriques afin de tenir compte des besoins des détenus âges souffrant de
démence.
Échéancier : Exercice 2025 à 2026
- Déterminer et mettre en œuvre une approche cohérente, exhaustive, opportune et normalisée pour le dépistage et l’évaluation des personnes ayant des déficits cognitifs.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE
Reconnaissant l’importance d’un dépistage efficace comme élément clé du continuum de soins, le SCC continuera d’envisager des possibilités d’optimiser son approche en matière de dépistage et d’évaluation.
Comme mentionné dans la réponse à la recommandation 12, la prestation d’interventions efficaces en temps opportun pour répondre aux besoins en santé mentale des personnes incarcérées dans les établissements fédéraux est une priorité pour le SCC. Le SCC est déterminée à répondre aux besoins en santé mentale des personnes incarcérées sous sa responsabilité, y compris aux besoins de celles souffrant de déficiences intellectuelles.
Par conséquent, le SCC procédera à un examen des processus liés à la santé à l’admission. Dans le cadre de cet examen, il envisagera l’apport d’améliorations à la procédure de dépistage des déficiences intellectuelles à l’appui de la planification du traitement et de la détermination des mesures d’adaptation requises.
Il convient de noter qu’en 2018, le Centre psychiatrique régional de Saskatoon, en Saskatchewan, a entrepris de mettre sur pied une clinique de dépistage des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale pour offrir des services de dépistage, de soutien et d’éducation aux détenus. Depuis, cette initiative a été mise en œuvre dans les régions du Pacifique et de l’Atlantique. Ces cliniques permettent d’identifier les personnes souffrant de troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale qui ont d’importants besoins en santé mentale et de formuler les recommandations pertinentes en matière de traitements, d’interventions et de soutiens communautaires, au besoin. Les professionnels de la santé de l’équipe interdisciplinaire des cliniques s’appuient sur les lignes directrices en matière de pratiques exemplaires pour effectuer des dépistages, poser des diagnostics et réaliser des évaluations fonctionnelles (y compris des troubles mentaux concomitants) en lien avec les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale, ainsi que pour formuler des recommandations relativement à un traitement et un plan d’intervention individualisés. À ce jour, 52 évaluations ont été réalisées pour cette population.
Prochaine étape : Le SCC procédera à un examen des processus liés à la santé à l’admission, y compris de la procédure de dépistage des déficiences intellectuelles.
Échéancier : Hiver 2026
- Veiller à ce que des programmes correctionnels adaptés soient offerts à tous les sites, à ce que les animateurs de programmes reçoivent la formation appropriée pour offrir des programmes adaptés et à ce que le seuil d’admission aux programmes adaptés soit ajusté pour permettre un plus grand nombre de participants.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE EN PARTIE
Bien que le SCC est déterminé à veiller à ce que les délinquants aient accès aux programmes dont ils ont besoin, aucune recherche menée à ce jour ne suggère que le Service devrait élargir ses critères d’admissibilité pour la participation aux programmes adaptes. D’ailleurs, une recherche menée antérieurement au sujet de la participation aux programmes correctionnels et des déficiences intellectuelles a révèle que les taux de participation aux programmes correctionnels ne variaient pas d’un groupe de délinquants à l’autre, et que les délinquants ayant des déficiences intellectuelles qui amorçaient un programme correctionnel étaient aussi susceptibles que les autres d’achever ce programme. L’étude a aussi révélé qu’une recherche menée antérieurement a démontré que les intervenants assurant la prestation des programmes du SCC répondaient avec succès aux besoins des délinquants souffrant de troubles mentaux (Stewart, L. A., Wilton, G., et Sapers, J. [2016]). Par conséquent, le SCC s’oppose à la réduction du seuil des critères d’admissibilité pour permettre la participation d’un plus grand nombre de délinquants aux programmes adaptés.
Le SCC utilise un outil de dépistage efficace pour aider les agents de libération conditionnelle et les agents de programmes correctionnels à déterminer si un délinquant devrait être aiguillé ou non vers un programme adapté. Cet outil est complet et vise à s’assurer que seuls les délinquants qui ne peuvent réellement pas participer de manière significative à un programme régulier se voient offrir la possibilité de participer à un programme adapté. L’outil permet d’évaluer des domaines précis pour déterminer le niveau d’incidence potentiel d’une déficience intellectuelle ou en santé mentale sur la participation d’un délinquant à un programme, et de déterminer si une mesure d’adaptation peut être offerte pour permettre au délinquant de participer à un programme régulier, y compris grâce au soutien offert dans le cadre du volet Soutien du module motivationnel. Les aiguillages vers un programme adapté sont fondés sur de solides données probantes provenant entre autres d’évaluations de la santé mentale réalisés par des professionnels de la santé qualifiés ou d’évaluations cognitives réalisés par des membres du personnel des services de santé. Les délinquants ayant des déficiences intellectuelles légères à modérées ne satisfont pas typiquement aux critères d’admissibilité pour la participation à un programme adaptés étant donné qu’ils peuvent participer de manière significative à leur programme. Ces personnes font probablement partie du pourcentage estimé de 25 % des délinquants de sexe masculin avec déficiences intellectuelles mentionné dans le rapport du Bureau de l’enquêteur correctionnel.
Il convient de noter que les agents de programmes correctionnels sont formés pour répondre aux besoins précis des délinquants et qu’ils peuvent adapter le matériel, au besoin, à cette fin. Dans cette optique, des outils sont mis à la disposition du personnel, dont des trousses de ressources sur la réceptivité. Qui plus est, les formations initiales ont été restructurées dans le cadre de la révision du matériel du Modèle de programme correctionnel intègre. Par conséquent, tous les agents de programmes correctionnels qui suivent la formation initiale sur les volets multicible ou pour délinquants sexuels du Modèle de programme correctionnel intégré reçoivent aussi une formation sur le programme adapté correspondant à compter du 30 mai 2025. Le personnel sera ainsi mieux outillé pour aider à adapter les volets multicibles ou pour délinquants sexuels du Modèle de programme correctionnel intégré pour répondre aux besoins des délinquants ayant des déficiences intellectuelles.
Les programmes adaptés sont typiquement offerts dans les centres régionaux de traitement du pays, mais par le passé, des exceptions ont été accordées pour assurer la prestation de ce type de programme dans d’autres unités opérationnelles en présence de circonstances et de besoins uniques. Le SCC rappellera au personnel des régions qu’il peut consulter les responsables à l’administration centrale s’il estime nécessaire d’offrir un programme adapté dans d’autres unités opérationnelles.
Prochaines étapes :
- Restructurer les formations initiales afin que tous les agents
de programmes correctionnels qui suivent une formation initiale reçoivent aussi
une formation sur le programme adapté correspondant. Transmettre une note de
service aux régions pour communiquer la date d’entrée en vigueur des formations
initiales restructurées.
Échéancier : Travaux terminés en date du 30 mai 2025 - Rappeler au personnel des régions qu’il peut consulter les
responsables à l’administration centrale en cas de circonstances et de besoins
uniques pouvant nécessiter la prestation d’un programme adapté dans d’autres
unités opérationnelles que les centres régionaux de traitement.
Échéancier : Automne 2025
- Élaborer et mettre en œuvre une nouvelle formation obligatoire portant sur le travail avec les personnes ayant des déficits cognitifs en milieu correctionnel pour tout le personnel d’ici 2026-2027. Cela devrait notamment comprendre des documents plus complets et appliqués pour la formation des agents correctionnels.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE EN PARTIE
Reconnaissant l’importance d’offrir de la formation au personnel travaillant auprès de personnes ayant des déficiences intellectuelles en milieu correctionnel, et afin de répondre aux besoins, le SCC offre les formations suivantes sur les déficiences intellectuelles à son personnel :
- Formation sur les troubles cognitifs et les troubles de la personnalité :
Cette formation aide le personnel à mieux reconnaitre les troubles cognitifs et les troubles de la personnalité, y compris les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale et les traumatismes cérébraux, ainsi qu’à assurer une intervention adaptée. La formation permet de mieux comprendre les difficultés auxquelles les personnes souffrant de troubles cognitifs et de troubles de la personnalité peuvent être confrontées et présente des stratégies pratiques et efficaces pour les soutenir. Cette formation a été donnée aux agents de libération conditionnelle dans le cadre du Programme de perfectionnement continu des agents de libération conditionnelle en 2024 à 2025. - Principes fondamentaux en santé mentale :
Cette formation vise à permettre au personnel d’acquérir de solides compétences afin de comprendre les problèmes de santé mentale couramment observés en milieu correctionnel. Elle aide le personnel à reconnaître les signes de maladie mentale, à comprendre l’incidence de la santé mentale sur le comportement et à développer des compétences pour soutenir efficacement les personnes aux prises avec des difficultés liées à la santé mentale. La formation favorise également des interactions respectueuses, adaptées et sécuritaires entre le personnel et les détenus. Elle est obligatoire pour les agents correctionnels, les intervenants de première ligne, les gestionnaires correctionnels et les sœurs ainées/frères ainés. - Sensibilisation aux troubles d’apprentissage des délinquants : Cette formation est offerte à tous les agents correctionnels dans le cadre de la première étape du Programme de formation correctionnelle. Elle vise à sensibiliser le personnel aux troubles de l’apprentissage au sein de la population des délinquants, à l’aider à reconnaître les difficultés d’apprentissage et à mieux comprendre l’incidence de ces troubles sur le comportement et la communication. La formation présente également des stratégies pratiques pour soutenir plus efficacement les personnes ayant des troubles de l’apprentissage en milieu correctionnel.
- Divers scénarios dans le cadre du Programme de formation correctionnelle : Les participants au Programme de formation correctionnelle sont exposés à divers scénarios inspirés de situations réelles afin de les aider à reconnaître les troubles de santé mentale et les troubles cognitifs et à adapter leurs interventions en conséquence. Voici des exemples de situations examinées dans le cadre de ces scenarios : crise de panique, anxiété, trouble bipolaire, trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale et traumatisme cérébral. La formation comprend aussi des scénarios axés sur les détenus âgés, comme ceux souffrant d’Alzheimer. Ces exemples permettent au personnel de développer des compétences pratiques et de se sentir mieux outilles pour gérer les cas complexes avec empathie et professionnalisme, tout en assurant la sécurité.
Le SCC s’affaire à mettre en œuvre un modèle de soins gériatriques conforme au cadre de politique sur les détenus âgés, lequel est axé sur l’évaluation, la prévention, l’intervention et la promotion en matière de santé. Ce modèle vise à répondre aux besoins de santé en évolution des personnes âgées incarcérées, y compris à ceux des personnes souffrant de démence.
Comme il est mentionné dans la réponse à la recommandation 12, le SCC examine les besoins en formation du personnel travaillant auprès des délinquants âgés souffrant de démence. Une collaboration est en cours afin d’examiner et d’élargir la formation continue, en mettant l’accent sur l’éducation interprofessionnelle liée à la planification et à la facilitation des soins gériatriques. Ces initiatives visent à s’assurer que le personnel dispose des connaissances et des outils nécessaires pour offrir des soins empreints de compassion, éclairés et efficaces.
Prochaines étapes :
- Le SCC continuera d’offrir de la formation sur les déficiences
intellectuelles à son personnel.
Échéancier : En cours
- Le SCC offrira la formation Principes fondamentaux en santé
mentale a tous ses nouveaux employés.
Échéancier : Printemps 2026
- Les Services de santé entreprendront un examen du modèle
de soins gériatriques afin de tenir compte des besoins des détenus âgés souffrant
de démence.
Échéancier : Exercice 2025 à 2026
Le fardeau de la collectivité : la discontinuité des services de santé mentale après la mise en liberté
« On estime que lorsqu’ils sortent de l’établissement, ils finissent leur peine. Ils pensent : “Oh, la collectivité trouvera bien la solution”, mais ils ne nous aident pas à nous y retrouver! C’est là que le bât blesse, où tant de dommages peuvent se produire. Nous sommes le parent pauvre. C’est incroyable ce que nous pouvons accomplir avec le peu que nous avons. Il faut changer d’état d’esprit afin de mettre l’accent sur la collectivité. »
Membre du personnel du SCC qui travaille dans la collectivité
Comparativement aux autres personnes au Canada, les personnes purgeant une peine de ressort fédéral entrent dans le système correctionnel avec des taux disproportionnés d’instabilité financière et en matière de logement64, de mauvais résultats en matière d’emploi et d’économie65, un faible niveau de scolarité et d’alphabétisation66, des traumatismes infantiles67 et une prévalence élevée de troubles mentaux68 et de déficits cognitifs. Ajoutez à cela l’intersection de la race, du sexe ou de la stigmatisation du casier judiciaire, et il n’est pas surprenant que les personnes condamnées se heurtent à d’énormes obstacles à la réinsertion, y compris l’accès aux soins de santé mentale.
Lorsqu’une personne est condamnée à une peine de détention fédérale, elle perd l’accès aux prestations provinciales de soins de santé et à l’aide sociale pendant la période de son incarcération. Cette inadmissibilité repose sur la prémisse que l’État couvre leurs besoins essentiels pendant leur détention Le Service a l’obligation légale de fournir à chaque détenu des « soins de santé essentiels » et un « accès raisonnable aux soins de santé non essentiels69 ». Cette obligation ne s’applique qu’aux détenus, et non aux délinquants sous surveillance dans la collectivité70. Par conséquent, la prestation des soins de santé par le SCC peut être considérablement réduite à la libération. Une fois dans la collectivité, il est urgent de transférer la responsabilité de la personne à l’autorité sanitaire provinciale ou territoriale. Par conséquent, la transition des services de santé mentale institutionnels aux services de santé mentale communautaires peut être retardée ou même déraillée par le changement de responsabilité des services de santé, parfois avec des effets dévastateurs.
Pour soutenir ces efforts de transition et de réinsertion sociale en général, le SCC est responsable de la planification de la mise en liberté et de la surveillance dans la collectivité, ce qui comprend la facilitation d’un continuum de services de santé mentale. Cela commence en détention avec la planification clinique de la continuité des soins et se poursuit dans la collectivité grâce aux services de transition offerts par les équipes de santé mentale communautaires du SCC et des partenaires externes.
Il est important de reconnaître que l’accès aux services de santé mentale au Canada varie considérablement d’une province à l’autre, les collectivités rurales, éloignées, nordiques et les communautés des Premières Nations étant aux prises avec des obstacles considérables aux programmes de soins et de soutien social. Cela pose de réels défis au SCC. Toutefois, le SCC a l’obligation légale de fournir des services de santé et de soins de santé mentale conformes aux « normes professionnelles acceptées71 ». Malheureusement, toutes les collectivités ne respectent pas ces normes – en particulier les régions rurales, éloignées, nordiques et les communautés des Premières Nations – et cette disparité peut aggraver les inégalités en matière de santé pour les personnes purgeant une peine de ressort fédéral. Par conséquent, si le SCC souhaite contribuer à la sécurité publique par ses efforts de réinsertion sociale, il doit jouer un rôle plus actif et coordonné pour combler ces lacunes.
De la planification clinique de la continuité des soins à la santé mentale communautaire
Le SCC décrit la planification clinique de la continuité des soins comme un processus interdisciplinaire et axé sur le patient « visant à cerner et à se préparer aux besoins de soins de santé prévus d’une personne après sa mise en liberté au sein de la collectivité72 » dans le but d’assurer la continuité des soins. La planification clinique de la continuité des soins73 est dirigée par un ou plusieurs professionnels de la santé désignés et doit comprendre ce qui suit :
- Confirmer que la personne a une pièce d’identité, comme un certificat de naissance, avant sa libération.
- S’assurer que les médicaments de la personne sont vérifiés et disponibles au moment de sa sortie.
- Collaborer avec les partenaires communautaires pour mutualiser des renseignements pertinents sur la santé et coordonner les services de suivi et les rendez-vous afin d’assurer la continuité.
- Fournir une trousse de continuité des soins comprenant des ordonnances, des renseignements sur la santé, une liste de références, des fournisseurs de services communautaires et des dates de rendez-vous.
Bien que la planification clinique de la continuité des soins soit fournie à toutes les personnes libérées des services de soins de santé de la prison vers la collectivité, une « planification clinique de la continuité des soins améliorée » est nécessaire pour les personnes ayant des besoins modérés à élevés, y compris des besoins en matière de santé mentale. Cela demande un processus d’évaluation, de planification et de coordination plus approfondi. Une fois libérées, les personnes ayant des besoins en matière de santé mentale modérés à élevés peuvent être admissibles aux services de santé mentale communautaires (SMC) du SCC, qui peuvent comprendre la défense des droits, l’accompagnement clinique et la gestion des symptômes de santé mentale. Ces services sont classés par ordre de priorité en fonction des considérations de risque et des conditions spéciales imposées par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (par exemple, participer à un traitement ou à des services de counseling).
Bien que le continuum ci-dessus soit maintenant un élément clé de la stratégie actuelle du SCC en matière de santé mentale74, il a fallu deux décennies pour le préparer. En 2004, le Bureau a signalé « qu’il était urgent d’assurer la liaison entre le SCC et les organismes communautaires afin d’assurer la continuité du traitement et du soutien aux délinquants mis en liberté75. » Peu après, en 2006, le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (SOCI) a publié un rapport intitulé « De l’ombre à la lumière : la transformation des services concernant la santé mentale, la maladie mentale et la toxicomanie au Canada » (aussi connu sous le nom de rapport Kirby), qui recommandait « que le Service correctionnel du Canada mette sur pied un système de prise en charge qui garantisse aux délinquants l’accès aux traitements de santé mentale dont ils ont besoin après leur mise en liberté […] ». Ces rapports ont donné un élan à l’Initiative en santé mentale dans la collectivité (ISMC) du SCC, qui a reçu 29,1 millions de dollars en 2005 pour ses cinq premières années. Cet argent aiderait l’ISMC à accroître la planification clinique de la continuité des soins et à allouer des ressources à des soutiens et à des services communautaires, y compris des travailleurs sociaux cliniques, des infirmières et infirmiers en santé mentale, des maisons de transition et d’autres partenaires communautaires. En novembre 2008, le SCC a publié une évaluation officielle de l’ISMC76. SCC a constaté que l’initiative « a contribué à augmenter l’accès aux services de santé mentale » et que « les délinquants qui avaient reçu les services de spécialistes en santé mentale dans la collectivité étaient moins susceptibles de faire l’objet d’une suspension ou d’une révocation que le groupe témoin qui n’avait pas bénéficié des services offerts dans le cadre de l’ISMC ». Soit dit en passant, les recommandations formulées dans la présente évaluation préfiguraient les constatations de notre enquête actuelle.
Aujourd’hui, le continuum des soins de santé mentale – de la planification clinique de la continuité des soins aux services communautaires de santé mentale – est régi par un labyrinthe de politiques, de lignes directrices, d’outils et de listes de contrôle. Malgré cette vaste infrastructure stratégique, cette enquête portant sur la planification clinique de la continuité des soins et la continuité des services de santé mentale a révélé de nombreux échecs de mise en œuvre. Nos principales constatations sont les suivantes :
- L’érosion globale des services de santé mentale communautaires du SCC.
- Un décalage entre la politique et la pratique.
- Une évaluation imparfaite de la santé mentale exclut de nombreuses personnes qui ont besoin d’un soutien communautaire.
- Une faible mobilisation et un échange d’information insuffisant entre les établissements et la collectivité.
- Des obstacles à l’accès aux services de santé mentale à lors de la mise en liberté.
- Des obstacles importants à l’accès au logement.
Ces enjeux peuvent avoir des répercussions négatives sur la sécurité publique. Le SCC laisse tomber les Canadiens en ne fournissant pas de planification clinique de la continuité des soins et de services de santé mentale communautaires adéquats qui assureraient la santé et la sécurité des personnes purgeant une peine de ressort fédéral, du personnel du SCC et du public.
Enquête en cours
L’objectif de cette enquête était d’examiner la continuité des services de santé mentale pour les personnes purgeant une peine de ressort fédéral estimée par le SCC comme nécessitant une planification clinique améliorée de la continuité des soins en raison de besoins élevés en matière de santé mentale. En plus d’examiner la documentation du SCC, des entrevues semi-structurées ont été menées auprès du personnel du SCC en établissement et dans la collectivité, des personnes en libération conditionnelle et incarcérées et des intervenants externes. Au total, 147 personnes ont été interviewées dans les cinq régions, représentant plusieurs établissements correctionnels, districts de libération conditionnelle, centres correctionnels communautaires (CCC) et plus d’une douzaine d’établissements résidentiels communautaires (ERC) (maisons de transition).
Constatations
L’érosion globale des services de santé mentale communautaires du SCC
Bien que les services de santé mentale communautaires du SCC aient été touchés par la pandémie de COVID-19, leur érosion date de bien avant cette date. Au cours des entrevues, le personnel vétéran du SCC a souvent soulevé des préoccupations, spontanées, au sujet de la pression exercée sur les services de santé mentale communautaires, notant une baisse graduelle, mais notable, du financement et de l’établissement des priorités organisationnelles, à partir de peu après 2010 (c.-à-d. après la période initiale de mise en œuvre de cinq ans). Bien que les dépenses totales pour l’ISMC et d’autres services communautaires en matière de santé mentale soient demeurées relativement stables depuis sa première année de financement intégral en 2007-2008, nous avons constaté une diminution de 39 %, passant de 13,8 millions de dollars en 2009- 2010 à 8,4 millions de dollars en 2024-2025 lorsqu’il est ajusté en fonction de l’inflation77. Au cours de la même période, les dépenses annuelles globales du SCC ont été relativement stables, suivant le cours de l’inflation78. Cependant, l’entreprise continue de se concentrer sur les services correctionnels en établissement; bien qu’ils représentent environ 40 % de la population purgeant une peine de ressort fédéral en 2024-2025 (8 713 sur 23 516)79, les Services correctionnels communautaires n’ont reçu que 12 % du budget de 3,2 milliards de dollars du SCC et 9 % de son personnel80. En outre, moins de la moitié du budget des Services correctionnels communautaires a été consacré aux établissements résidentiels communautaires, aux CCC et aux services de santé - une petite fraction du budget total du SCC, ce qui représente un sous-investissement notable dans les services communautaires de santé mentale et de transition.
Bien que les investissements dans la santé mentale communautaire n’aient pas suivi la hausse des coûts, l’évolution du profil des libérés conditionnels sous responsabilité fédérale oblige davantage le membre du personnel du SCC qui travaille dans la collectivité et les partenaires communautaires à répondre aux troubles mentaux et aux dépendances complexes. La frustration de devoir « faire plus avec moins » était évidente lors des entrevues réalisées. « La santé mentale communautaire a besoin de plus de ressources », a expliqué un membre du personnel d’un centre correctionnel communautaire (CCC), « de plus en plus de personnes qui en ont besoin – nous faisons essentiellement plus avec moins. Si quelqu’un prend sa retraite ou démissionne, le poste n’est tout simplement pas pourvu. Il disparaît plutôt! » Un membre du personnel chargé de la santé mentale communautaire a indiqué ceci : « Sur papier, la continuité des soins est excellente. Dans la pratique, cependant, il semble que la continuité des soins ne soit pas une priorité. C’est plutôt mis en veilleuse. »
Bien que le SCC se soit engagé au cours des deux prochaines années à examiner « la prestation de services de santé communautaire dans le but d’établir des soins normalisés81 », le personnel que nous avons interviewé a exprimé des doutes quant à l’avenir de la santé mentale communautaire.
Décalage entre la politique et la pratique
Les personnes interrogées ont toutes appuyé la nécessité d’offrir des services aux personnes ayant des besoins en matière de santé mentale après leur mise en liberté. Ceux qui connaissent les politiques et les lignes directrices du SCC sur la planification clinique de la continuité des soins en ont reconnu le potentiel et la valeur, mais ont fait valoir que le labyrinthe de politiques et de procédures a en fait créé des obstacles à la continuité des soins. Les personnes interviewées ont exprimé leur frustration quant aux changements apportés aux politiques, aux stratégies et aux lignes directrices nationales qui sont très éloignées de la réalité des services correctionnels communautaires. Compte tenu de ce décalage, nous avons appris que de nombreux employés sont incapables de suivre les changements de politique.
De nombreuses personnes interrogées ne connaissaient pas les Rapports sur l’essentiel de l’état de santé à la mise en liberté (formulaire 1371) – un outil clé pour le personnel de la santé et de la gestion de cas sur les renseignements sur la santé relatifs à la libération – ou les Lignes directrices mises à jour sur la planification de l’admission, du transfèrement et de la continuité des soins des détenus (janvier 2024). Presque aucun ne connaissait la Matrice (outil) pour la planification de la continuité des soins, un document de référence rapide pour le personnel participant à la planification clinique de la continuité des soins. Bon nombre d’entre eux ont indiqué qu’ils étaient tellement débordés d’évaluations, de listes de contrôle et de lignes directrices qu’une conformité totale nuirait à leur capacité de faire un travail significatif avec les personnes qu’ils sont censés soutenir. Nous avons également entendu dire qu’il y a peu ou pas de reddition de comptes pour s’assurer que ceux qui ont besoin d’une planification clinique de la continuité des soins les reçoivent ou que les délais de congé sont respectés. Comme l’a indiqué un membre du personnel du SCC qui travaille dans la collectivité : « Bien que nous sachions que nous ne sommes pas conformes, personne ne respecte le processus […]. Le processus est si horrible que nous ne sommes pas en mesure de faire le bon travail que nous devons faire, alors nous l’ignorons. »
Une assurance de la reddition de comptes est la désignation d’un planificateur clinique de la continuité des soins. Selon les lignes directrices82 du SCC sur la planification clinique de la continuité des soins, chaque établissement doit affecter un « professionnel de la santé désigné pour diriger la planification clinique de la continuité des soins de chaque personne libérée », ce qui comprend une planification clinique améliorée de la continuité des soins. Les personnes interrogées ont toutefois indiqué qu’une planification clinique améliorée de la continuité des soins est souvent imposée au personnel de santé qui ne se consacre pas uniquement à ce travail. Comme l’a fait remarquer un membre du personnel de l’établissement : « Je pense que la planification clinique de la continuité des soins est intense et devrait être liée aux échéanciers correctionnels, plutôt qu’à quelque chose qui se fait sur le côté de son bureau. » Le SCC a confirmé qu’il n’y a que quatre planificateurs cliniques de la continuité des soins financés au Canada. Sans surprise, les entrevues ont révélé un système moins que parfait, le personnel se frayant un chemin à travers les obstacles pratiques et les responsabilités qui dépassent leur champ d’exercice. Une personne ayant de l’expérience dans la planification clinique de la continuité des soins a parlé de la façon dont le rôle est mieux adapté au travail social qu’aux soins infirmiers – un point qui a été repris par de nombreuses personnes interrogées : « Il est nécessaire d’améliorer le renforcement des capacités et l’établissement de partenariats. On suppose que la collectivité a ce réseau, mais en réalité, le renforcement des capacités et l’établissement de partenariats sont une entreprise à long terme. C’est le rôle du travailleur social, et je pense qu’il a été perdu en cours de route. […] Le SCC doit examiner attentivement ce rôle et la façon dont il l’a modifié pour avoir une incidence directe sur la réinsertion sociale. »
Il y a clairement des obstacles importants dans le processus de planification clinique de la continuité des soins du SCC, notamment un décalage entre les politiques nationales et les réalités de première ligne, une reddition de comptes limitée et une pénurie de planificateurs cliniques de la continuité des soins désignés. Il est compréhensible que le personnel soit frustré, estimant que ses meilleurs efforts sont minés par des problèmes systémiques indépendants de sa volonté.
Une évaluation imparfaite de la santé mentale exclut de nombreuses personnes qui ont besoin d’un soutien communautaire
Au-delà du décalage entre les politiques et les pratiques, il existe également des lacunes importantes dans l’utilisation des outils d’évaluation de la santé mentale par le SCC; des mesures qui sont censées être fondamentales pour déterminer les besoins d’une personne et éclairer la planification du traitement et la gestion des cas. Afin d’évaluer le niveau général de besoins en matière de santé mentale d’une personne dans les services correctionnels fédéraux, le SCC a élaboré sa propre Échelle des besoins en santé mentale (EBSM)83. Malgré qu’elle soit dans le cadre d’un processus plus vaste d’évaluation de la santé mentale, cette échelle est l’outil principal utilisé pour aider le personnel de l’établissement à aiguiller le personnel vers le service ou le niveau de soins approprié (par exemple : autosoins, soins primaires, santé mentale intermédiaire, hôpital psychiatrique, services de santé mentale communautaires). Selon le SCC, pour être admissible à une planification clinique de la continuité des soins améliorée et à des services de santé mentale communautaires, une personne doit atteindre le seuil de « considérable » à « aiguë/grave » sur l’EBSM.
Lors d’entrevues avec le personnel de la santé et de la gestion de cas, tant dans les établissements que dans la collectivité, nous avons appris que l’EBSM est insuffisante à bien des égards. Premièrement, le personnel de l’établissement a expliqué qu’il est difficile d’atteindre le seuil d’amélioration de la planification clinique de la continuité des soins, ce que les données confirment. Seulement 5,8 % de toutes les libérations sous responsabilité fédérale ont atteint le seuil de 2023-2024 (voir l’annexe B)84. De ce nombre, 13,5 % n’avaient pas de planification clinique de la continuité des soins améliorée, ce qui signifie que tous ceux qui sont admissibles à la planification améliorée et en santé mentale communautaire ne reçoivent pas ces services.
Dans l’ensemble, ces chiffres sont incongrus avec le niveau de besoins en matière de santé mentale rencontrés par le personnel, et cela est corroboré par les propres données du SCC. Par exemple, 45 % des personnes aiguillées vers des soins de santé mentale intermédiaires85 en établissement « ne répondaient pas aux critères de besoins en matière de santé mentale considérables ou plus élevés » de l’EBSM, qui, selon la politique, sont requis pour l’aiguillage vers ce niveau de soins86. Cela suggère que le personnel effectue sa propre évaluation des besoins, distincte de la EBSM, pour déterminer le niveau de soins dans une grande proportion de cas. De plus, la recherche sur la prévalence du SCC estime que 12,4 % des hommes87 et 16,3 % des femmes88 sont admis avec une « maladie mentale majeure » (c.-à-d. un trouble dépressif majeur, un trouble bipolaire ou tout autre trouble psychotique). Ensemble, ces données suggèrent fortement que l’EBSM est mal calibré pour évaluer le besoin d’une personne en matière d’interventions en santé mentale89, en particulier dans la collectivité. Comme l’a indiqué un membre du personnel chargé de la santé mentale communautaire : « L’EBSM est utilisée incorrectement. […] Cela ne reflète pas le nombre réel de personnes qui ont besoin d’une planification clinique de la continuité des soins améliorée. »
Étant donné qu’il est difficile d’atteindre le seuil d’amélioration de la planification clinique de la continuité des soins et des services de santé mentale communautaires, il n’est pas surprenant d’apprendre que certains employés bien intentionnés ont eu recours au « massage » de l’EBSM pour obtenir des services pour leurs clients/patients. Ce qui était surprenant, cependant, c’est la facilité avec laquelle la balance peut être manipulée pour augmenter (ou diminuer) le niveau de besoin.
Cela nous amène à la deuxième lacune de l’EBSM : elle ne se concentre que sur les besoins immédiats et aigus. Le personnel a souvent expliqué comment les interventions en santé mentale sont signalées pour les personnes en crise ou dont les comportements posent des problèmes pour le personnel et les autres. Nous avons souvent entendu l’adage : « Qui ne demande rien n’a rien. » Si la personne reste discrète, elle pourrait ne pas être repérée pour une évaluation ou une intervention en santé mentale, et il est peu probable qu’elle soit dirigée vers une planification clinique de la continuité des soins améliorée. Les personnes interrogées ont également soutenu que, même lorsqu’elles ont lieu, les évaluations de la santé mentale ne sont pas opportunes. Bien que l’exigence d’évaluation de la santé mentale à l’admission ait été adoptée dans le cadre de la politique le 30 novembre 2019 avec le Bulletin politique provisoire 651, la conformité demeure un problème. Par conséquent, les personnes ayant des besoins en matière de santé mentale sont libérées de la prison fédérale sans être correctement évaluées et sans plans adaptés, laissant les partenaires communautaires se démener pour trouver des solutions de dernière minute.
Le troisième problème, sans doute le plus important, avec l’EBSM est qu’elle n’a pas été conçue en pensant à la collectivité. L’alinéa 87 b) de la LSCMLC exige que le SCC « doive tenir compte de [l’] état de santé [du délinquant] et des soins qu’il requiert » en vue de sa mise en liberté et de sa surveillance dans la collectivité. Plusieurs membres expérimentés en santé mentale communautaire ont expliqué que l’EBSM ne se concentre que sur les besoins en matière de santé mentale dans le contexte carcéral et ignore les répercussions des déterminants sociaux de la santé, ce qui peut mener à une décompensation de la santé mentale dans la collectivité. Comme l’a indiqué un travailleur en santé mentale communautaire : « La personne peut être très stable en établissement parce qu’elle a accès à un logement, à un revenu, à une source d’ordonnances, mais elle n’en a pas dans la collectivité. [L’EBSM] est une échelle qui mesure si la personne peut faire partie de la population générale [en détention] pour recevoir des soins primaires ou a besoin d’un autre niveau de soins. Mais dans la collectivité, les besoins sont différents. »
Pour ces raisons – c’est-à-dire son seuil arbitraire, son application subjective, l’accent mis uniquement sur les besoins aigus et le mépris des réalités de la collectivité – l’EBSM semble problématique en tant qu’outil pour évaluer les besoins en matière de santé mentale dans la collectivité.
Une faible mobilisation et un échange d’information insuffisant entre les établissements et la collectivité
Dans une note de service datée du 4 mai 201590, le SCC a reconnu « les défis relatifs au processus d’échange d’information entre le personnel des soins de santé et les agents de libération conditionnelle ». La note rappelait au personnel l’importance de l’échange d’information pendant la préparation des cas et la mise en liberté, « car cela contribue directement à la transition sécuritaire des délinquants dans la collectivité ». Afin de mieux définir les rôles et les responsabilités, d’accroître les efforts de communication et de coordonner l’échange d’information, la note de service présentait la Matrice (outil) pour la planification de la continuité des soins comme solution à utiliser en combinaison avec les Rapports sur l’essentiel de l’état de santé à la mise en liberté. Dans la pratique, cependant, cette enquête a révélé que la communication entre les pénitenciers et les partenaires communautaires (personnel du SCC et autres) était incohérente et inadéquate.
Nous avons entendu dire que le niveau de détail fourni au membre du personnel du SCC qui travaille dans la collectivité dans les documents relatifs à la continuité des soins, comme les Rapports sur l’essentiel de l’état de santé à la mise en liberté, est insuffisant pour assurer une continuité efficace des soins. Comme l’a indiqué un membre du personnel du SCC qui travaille dans la collectivité, « les Rapports sur l’essentiel de l’état de santé à la mise en liberté de l’établissement revêtent un objectif limité, car ils n’incluent souvent pas l’information dont nous [dans la collectivité] avons besoin », comme des détails sur les médicaments, les diagnostics, les rendez-vous et l’aiguillage vers les services communautaires. Notre enquête a révélé que les facteurs suivants étaient les principaux obstacles à l’échange d’information entre les secteurs :
- Les renseignements sur la santé sont fortement protégés, même lorsqu’ils sont clairement liés au risque (par exemple, diagnostics de santé mentale, renseignements sur les ordonnances, participation à des programmes de réduction des méfaits) et que les normes éthiques sont respectées (par exemple, « le besoin de savoir », le consentement éclairé et volontaire)91. Cette situation est exacerbée lorsque le personnel de gestion des cas et les Services de santé travaillent en silos, ce qui est pourtant courant92.
- Les rôles, les responsabilités et les attentes correspondant à la planification clinique de la continuité des soins améliorée ne sont pas clairs ou mal renforcés, ce qui fait en sorte que les tâches essentielles ne sont pas accomplies.
- La planification clinique de la continuité des soins améliorée en temps opportun et proactive en l’établissement est rare, ce qui laisse peu de temps aux partenaires communautaires pour se préparer avant la libération ou pour participer de manière significative.
Un membre du personnel du SCC qui travaille dans la collectivité a exprimé sa frustration face au manque de planification proactive et d’échange d’information de l’établissement : « En tant que membre du personnel de SCC travaillant au sein de la collectivité et œuvrant dans un établissement, j’ai vu combien [d’employés] ne voient pas au-delà des murs de l’établissement. C’est comme un match de tennis où la balle est envoyée sur le terrain de la collectivité pour qu’elle s’en occupe. Il y a une hypothèse institutionnelle selon laquelle la collectivité peut tout gérer, qu’elle s’en sortira, et qu’elle a des ressources. Pourtant, ils n’ont pas le temps de planifier ou de faire des plans – ils réagissent face au manque de planification. »
Le personnel de SCC travaillant au sein de la collectivité nous a appris que la qualité de l’information et de la planification clinique de la continuité des soins s’améliore considérablement lorsqu’il y a une relation de travail solide entre l’établissement de libération, la libération conditionnelle communautaire et les services de santé mentale communautaires, en particulier lorsqu’un planificateur clinique de la continuité des soins et un infirmier ou une infirmière en santé mentale communautaire participent. Les planificateurs cliniques de la continuité des soins doivent maintenir des liens actifs avec les ressources communautaires et posséder une bonne compréhension des déterminants de la santé. La circulation de l’information entre le personnel de l’établissement et de la collectivité dépend, dans une certaine mesure, de l’obtention du consentement éclairé et volontaire des personnes incarcérées avant leur mise en liberté. Nous avons également observé que lorsqu’il existe des mécanismes de planification avancée des cas au moyen de conférences de cas (par exemple, réunions mensuelles ou trimestrielles pour discuter des personnes ayant des besoins élevés en matière de santé mentale), les possibilités d’un meilleur échange d’information et d’une réinsertion sociale réussie sont améliorées. Cela est particulièrement vrai lorsque des intervenants autres que les services de libération conditionnelle et de santé mentale communautaire sont inclus dans la planification. Par exemple, les organismes sans but lucratif qui gèrent des établissements résidentiels communautaires (ERC) sont plus disposés à accepter des libérés conditionnels s’ils participent plus tôt à la planification de la mise en liberté. Certains organismes à but non lucratif ont pris l’initiative de créer leurs propres postes d’intervenants-accompagnateurs, chargés de rencontrer les personnes incarcérées et de planifier la mise en liberté. Les personnes interrogées ont également souligné l’importance d’inclure la personne libérée sous conditions, le personnel des centres correctionnels communautaires (CCC) et le personnel des établissements qui connaissent bien la personne libérée sous conditions. Ensemble, ces stratégies aident à limiter au minimum les points de friction, à faciliter la circulation de l’information essentielle et à assurer la continuité des soins.
Des obstacles à l’accès aux services de santé mentale à lors de la mise en liberté
Comme nous l’avons mentionné précédemment, lorsqu’une personne est condamnée à une détention fédérale, elle n’est plus admissible aux prestations provinciales de soins de santé ou à l’aide sociale pendant la période de son incarcération. Cette inadmissibilité est fondée sur le principe que le gouvernement fédéral couvre leurs besoins essentiels pendant qu’ils sont sous la garde du SCC. L’alinéa 87b) de la LSCMLC exige que le SCC tienne compte des facteurs de santé dans sa préparation à la mise en liberté et à la surveillance. De plus, les lignes directrices du SCC prévoient certaines indemnités relatives à la prestation de services de santé « sur une base provisoire » dans les CCC et les bureaux de libération conditionnelle93. Cependant, dans la pratique, les personnes interrogées ont souvent noté que le service de santé mentale du SCC se termine brusquement aux portes de la prison. Voici comment une personne sous surveillance communautaire a décrit son expérience : « Je ne suis au courant d’aucun plan de santé mentale ou de libération. On m’a dit que j’irais à la maison de transition et c’est tout. Je souffre de schizophrénie, qui est contrôlée par des médicaments. Lorsque j’ai été libéré, mes médicaments n’étaient pas configurés. […] Je n’avais personne à qui parler quand j’ai été libéré. Je me sentais tout seul. J’ai eu des conditions de libération conditionnelle pour des raisons de santé mentale. J’ai vu la psychologie en prison et une travailleuse sociale. Lorsque j’ai été libéré, ces services ont été interrompus […] lorsque le SCC n’établit pas de services, cela a une incidence énorme sur notre libération La collectivité ne peut pas nous donner la priorité, et le SCC semble simplement cesser de se responsabiliser à notre égard. »
L’accès aux soins de santé communautaires dépend de ressources qui ne sont pas toujours disponibles pour les libérés conditionnels, car les programmes et les prestations gouvernementales exigent un numéro d’assurance sociale et une preuve d’identité. De plus, l’admissibilité d’un libéré conditionnel à l’aide sociale ou à l’aide au revenu varie grandement selon la province et selon qu’il vit dans un établissement résidentiel communautaire (ERC) ou un centre correctionnel communautaire (CCC)94. De même, les médicaments sont inclus dans tous les programmes de soins de santé, mais la couverture est limitée et les programmes d’assurance-médicaments prolongés sont principalement fondés sur le revenu. Par conséquent, les déclarations de revenus doivent être remplies et tenues à jour.
Il est déjà suffisamment difficile de s’y retrouver dans ces mécanismes complexes. À tout le moins, pour avoir accès aux soins de santé et de santé mentale financés par le gouvernement dans la collectivité – y compris les services psychiatriques et psychologiques, les médicaments et d’autres soutiens – une carte d’assurance maladie est requise, mais pas disponible pour les personnes détenues par le gouvernement fédéral. Pour obtenir une carte d’assurance maladie à la libération, le SCC doit s’assurer que les personnes ont une preuve d’identité avant la date de libération. Cela simplifierait le processus et allégerait le fardeau du personnel communautaire et des partenaires.
La question des cartes d’identité et des cartes d’assurance maladie manquantes a fait l’objet de délibérations ad nauseam par le SCC et ses intervenants depuis des décennies Elle a été soulevée par l’évaluation du SCC en 201795 et de nouveau dans le rapport de l’automne 2018 de la vérificatrice générale, où elle disait que le SCC « … a souvent libéré des délinquants sans carte d’assurance maladie ». En réponse, le SCC s’est engagé à aider « les délinquants à obtenir une pièce d’identité avant leur mise en liberté » et « à améliorer la collaboration avec les autorités sanitaires provinciales et territoriales dans le but d’éliminer les obstacles à l’accès aux cartes de soins de santé. » Cependant, les progrès réalisés dans les partenariats de collaboration ont été minimes, et le SCC continue de libérer des personnes sans pièces d’identité appropriées, un problème qui a été confirmé par toutes les personnes interrogées. Par exemple, sur les 761 mises en liberté entre 2022 et 2024 où la personne a atteint le seuil des besoins en matière de santé mentale « considérables » à « aigus/graves », plus de la moitié (52,4 %) n’avaient pas de carte d’assurance maladie, un statut de carte d’assurance maladie inconnu ou en avaient demandé une, mais n’en ont pas reçu au moment de leur mise en liberté (voir l’annexe B)96. Un tiers (33,5 %) du total des mises en liberté n’avait aucune carte d’assurance maladie97. Le SCC ne devrait pas être surpris d’apprendre que les personnes aux prises avec l’instabilité financière, l’insécurité du logement98 et les personnes ayant des besoins en matière de santé mentale ont de la difficulté à obtenir une pièce d’identité personnelle et ont besoin de beaucoup plus de soutien pour le faire. Comme l’a expliqué un membre du personnel du SCC qui travaille dans la collectivité du SCC : « Faire porter le fardeau sur le client est injuste. Il y a tellement d’obstacles à la réceptivité qui les empêchent de préparer et de soumettre des demandes. »
Dans la région du Pacifique, le personnel a fait l’éloge des efforts d’un « coordonnateur régional de la carte d’identité » qui a fait ce travail pour toutes les mises en liberté dans la région, mais au cours de cette enquête, ce programme a été interrompu par l’administration centrale. L’absence de documents médicaux appropriés et de couverture des soins de santé dans la collectivité a des répercussions négatives évidentes sur les personnes condamnées. Sans couverture, le personnel communautaire du SCC se retrouve dans la malheureuse position de devoir demander à des partenaires externes de travailler gratuitement, à de rares exceptions près. « Nous leur avons demandé d’envoyer des personnes avec des pièces d’identité et des certificats de naissance », a indiqué un membre du personnel d’un établissement résidentiel communautaire, « Cela prend un certain temps pour le faire dans la collectivité et c’est coûteux. Les agences assument les coûts. »
Nous avons souvent observé que le personnel communautaire formait des partenariats proactifs avec des organismes qui aident à la détermination, au renouvellement des cartes d’assurance maladie et aux impôts. Des partenaires communautaires, y compris la libération conditionnelle, ont offert un « accompagnement » à ceux qui ont besoin d’aide pour se rendre à leurs rendez-vous pour des raisons physiques, mentales ou financières. Une organisation dépense plus de 100 $ par mois en coûts de kilométrage pour offrir ce service. Ces dépenses ne sont toutefois ni remboursées ni couvertes par le SCC.
Ces efforts sont essentiels, car les libérés conditionnels ayant des problèmes de santé mentale doivent faire face à des dépenses imprévues lorsqu’ils n’ont pas de couverture de soins de santé ou d’invalidité et d’aide à l’emploi. Cependant, même si la personne obtient une pièce d’identité et une carte d’assurance maladie à sa libération, cela ne garantit pas qu’elle recevra des prestations à temps ou que les fournisseurs de services les accepteront. Comme l’a indiqué un membre du personnel : « Beaucoup de nos partenaires communautaires sont épuisés par nos clients Ils refuseront simplement de prendre nos clients si cela ne fonctionne pas bien. ». À titre provisoire, le SCC doit fournir un soutien transitoire pour assurer la continuité des services de santé mentale. Ce soutien comprend la prise en charge du coût des laissez-passer d’autobus, de l’accompagnement, des frais de traitement et de rendez-vous, ainsi que de la nourriture. Bien qu’un certain soutien financier soit offert aux femmes par le Secteur des délinquantes, le SCC offre une rémunération minimale au personnel communautaire et aux partenaires pour les hommes purgeant une peine de ressort fédéral.
S’assurer que les pièces d’identité sont obtenues avant la mise en liberté et offrir des services de transition aideraient à éliminer les obstacles aux soins de santé et aux services sociaux communautaires. Cela réduirait également le fardeau financier du personnel communautaire du SCC et des partenaires externes qui sont déjà surchargés et sous-financés.
Des obstacles importants à l’accès au logement.
« Attendu qu’il est essentiel de prévoir des objectifs, des échéanciers et des initiatives nationaux en matière de logement et de lutte contre l’itinérance pour améliorer la qualité de vie de la population du Canada, plus particulièrement celle des personnes dont les besoins sont les plus criants […]. »
Loi concernant la stratégie nationale sur le logement (2019)
Les effets néfastes de l’instabilité du logement sur la santé mentale et le bien-être ont été bien documentés99. Combinée aux pressions auxquelles font face les personnes ayant des démêlés avec la justice, en particulier celles qui sont sous surveillance communautaire et qui ont de la difficulté à trouver un emploi, à accéder aux services de santé et à surmonter les stigmates associés à un casier judiciaire, l’instabilité du logement peut sérieusement aggraver les problèmes de santé mentale, ce qui augmente le risque de suspension. Comme l’a indiqué un membre du personnel du SCC dans la collectivité : « Si j’étais une personne ayant des problèmes de santé mentale et que je n’avais pas de logement, je ne sais pas comment je réussirais dans la collectivité ou comment je me conformerais à mes conditions. »
Le Canada est aux prises avec la hausse des coûts du logement et l’augmentation des taux d’itinérance. Un gestionnaire d’un ERC a expliqué qu’avant la pandémie, les résidents séjournaient dans des maisons de transition entre 60 et 80 jours, « mais maintenant ils restent plus de 200 jours en moyenne à cause de la crise du logement – ils ont besoin d’un endroit où rester! ». Si la personne a dépassé la semi-liberté et est en liberté d’office sans condition d’assignation à résidence, le SCC peut payer temporairement la résidence volontaire dans des délais serrés. Par conséquent, les ERC reçoivent plus d’admissions volontaires. Cependant, certains ERC peuvent refuser des personnes ayant des problèmes de santé mentale, c’est pourquoi beaucoup se retrouvent dans les CCC, car ils ne peuvent refuser quiconque a légalement besoin d’un lit. Par conséquent, leurs clients sont souvent des personnes présentant des profils de risque et de besoins plus élevés, et les CCC fonctionnent souvent au maximum de leur capacité, avec de longues listes d’attente. Pour l’exercice financier 2024-2025, le taux d’occupation des CCC était de 103 %100.
Des chambres occupées dans les centres correctionnels communautaires
Compte tenu de cette situation, le personnel n’a de plus en plus d’autres options que d’aiguiller les personnes vers des refuges, bien qu’ils soient réticents à placer des personnes sous leur surveillance dans des situations d’hébergement qui aggravent la maladie mentale ou les exposent à un risque de préjudice ou de récidive. Un bureau de district a mis sur pied un « comité du logement », une cohorte d’employés qui donnent de leur temps pour communiquer avec les propriétaires fonciers afin d’organiser des options de logement au moyen de programmes d’aide sociale. Un autre organisme a obtenu deux lits financés par la province qui peuvent être utilisés comme mesure provisoire pour la résidence ou pour prévenir l’itinérance à la fin de la peine d’une personne. Malgré tous les efforts de nombreux employés du SCC, les libérés conditionnels purgeant une peine d’une durée déterminée finissent par atteindre la date d’expiration de leur mandat, ce qui laisse certains d’entre eux aux prises avec des refuges ou l’itinérance. Comme l’a indiqué un membre du personnel du CCC : « Nous les relâchons dans la rue à la date d’expiration de leur mandat dans une tente! Nous essayons de les aider à trouver un logement, mais il y a plus de 2 000 personnes sur la liste d’attente de la collectivité et nos clients sont tout en bas compte tenu de leurs antécédents criminels et de leurs problèmes de toxicomanie – ce ne sont pas des candidats idéaux. Si nous faisons le plein ici [au CCC], nous ne pouvons plus garder les personnes bénévoles et nos personnes qui ont des besoins médicaux… eh bien, nous ne voulons pas les mettre dans la rue. »
Bien que le Bureau soit encouragé par le « Plan de mise en œuvre du Cadre fédéral visant à réduire la récidive » (2023) de Sécurité publique Canada, qui comprend des initiatives visant à prévenir et à réduire l’itinérance « pour les individus qui sont impliqués dans le secteur de la justice pénale », on ne saurait trop insister sur l’urgence de cette question.
Conclusion
Un soutien inadéquat en santé mentale pour les personnes incarcérées sous le gouvernement fédéral nuit non seulement à leur réinsertion sociale, mais aussi à la sécurité publique. Le sous-financement et le dysfonctionnement des politiques nationales, combinés à des outils d’évaluation inadéquats et à une mauvaise coordination entre les établissements et la collectivité, laissent les personnes sans soins essentiels en santé mentale et en toxicomanie à leur libération. Les obstacles financiers et administratifs, ainsi qu’une grave pénurie de logements, déstabilisent davantage les personnes déjà à risque de récidive. C’est un moment décisif qui provoque une situation de crise. Plutôt que de faciliter la réadaptation, les défaillances du système exacerbent les conditions mêmes qui motivent la récidive, en particulier chez les personnes ayant des besoins en matière de santé mentale. Il existe cependant des pratiques prometteuses qui démontrent la persévérance, l’initiative et la prévenance des nombreux employés communautaires que nous avons interviewés, comme le souligne le présent rapport. En réaffectant des ressources à la collectivité, le SCC sera en mesure de recommander une mise en liberté anticipée à un plus grand nombre de personnes tout en améliorant leurs perspectives de réinsertion sociale, ce qui se traduira par un transfert des ressources qui, en fin de compte, sera neutre en matière de coûts pour le gouvernement.
Le Bureau a déjà recommandé des augmentations du budget des services correctionnels communautaires de nombreuses fois, sans changement notable. Compte tenu du manque de traction à ce jour, en tant que mesure visant à obtenir des ressources adéquates, je recommande au SCC :
- Doubler l’affectation budgétaire aux établissements résidentiels communautaires, aux CCC et aux services de santé communautaire (y compris l’ISMC), au cours des cinq prochains exercices, afin de répondre à l’évolution du profil de santé mentale des libérés conditionnels; rémunérer adéquatement les partenaires et les fournisseurs de services externes; et veiller à ce que les services communautaires de santé mentale et de transition disposent de ressources adéquates.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE EN PARTIE
Au chapitre du financement, les fonds accordés aux établissements résidentiels communautaires ont augmenté de 17,2 % au cours de l’exercice 2023 à 2024, et de 6,8 % au cours de l’exercice 2024 à 2025. Les fonds alloués par le SCC aux services correctionnels communautaires pour l’exercice 2024 à 2025 représentent 12,4 % de son budget de fonctionnement pour cet exercice, ce qui dépasse l’allocation recommandée. De plus, les établissements résidentiels communautaires peuvent offrir des services supplémentaires, comme des repas, du transport et de la formation. Les coûts connexes sont inclus dans les dépenses de fonctionnement de l’établissement et servant à déterminer le tarif journalier que paye le SCC.
Le SCC continue de travailler avec ses partenaires en vue d’étendre et d’adapter les services destinés aux personnes sous surveillance dans la collectivité, en particulier à celles ayant des besoins complexes en santé, et de fournir du financement destiné aux interventions résidentielles accrues aux établissements résidentiels communautaires pour les aider à soutenir les personnes qui présentent un risque ou des besoins plus élevés.
Le Secteur des services de santé du SCC élabore également des plans de soins postlibératoires pour améliorer l’accès aux soins de santé provinciaux.Il mène un projet pilote de planification de la continuité des soins reposant sur une approche d’équipe pour soutenir les détenus ayant des besoins complexes en santé. Les résultats de ce projet serviront à orienter les futures politiques, évaluations et formations.
Prochaine étape : Lancement du projet de démonstration de la planification améliorée de la continuité des soins dans des unités opérationnelles désignées
Échéancier : Été 2026
-
Mettre en œuvre des changements à la planification clinique de la continuité
des soins et à la santé mentale communautaire d’ici la fin de l’exercice
financier 2025-2026, y compris les améliorations suivantes :
- mettre à jour et simplifier les politiques et les outils nationaux, y compris des normes de service claires et des exigences en matière de rapports;
- mettre en œuvre une évaluation des besoins en matière de santé mentale qui permet de planifier la réinsertion sociale;
- améliorer la formation, l’éducation, les politiques et les procédures relatives à l’échange d’information;
- assurer le respect des politiques concernant la libération des personnes avec des pièces d’identité gouvernementales (de préférence des certificats de naissance);
- éliminer les obstacles à l’accès aux soins de santé et de santé mentale financés par le gouvernement à la libération en mettant l’accent sur l’amélioration de la collaboration avec les autorités sanitaires provinciales et territoriales ainsi qu’avec les partenaires communautaires.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE
Considérant la planification de la continuité des soins comme un élément essentiel pour aider les personnes incarcérées dans le cadre de leur transition vers la collectivité, le SCC s’est doté d’un processus de planification de la continuité des soins et est déterminé à l’améliorer.
La planification de la continuité des soins est une responsabilité clé du SCC pour assurer une réinsertion sociale sans heurts. Une fois que les délinquants sont mis en liberté dans la collectivité, les autorités provinciales se chargent de leur fournir des soins de santé. À l’heure actuelle, le SCC assure la planification clinique de la continuité des soins et la prestation de services de santé ciblés pour soutenir les personnes ayant des besoins élevés en santé pendant leur transition.
Le SCC offre des services de santé dans la collectivité dans le but d’assurer la continuité des soins de l’établissement à la collectivité. Ces services comprennent la planification clinique de la continuité des soins ainsi que les services de santé fournis aux personnes résidant dans la collectivité, y compris dans les centres correctionnels communautaires, les établissements résidentiels communautaires et les logements privés.
Le SCC s’efforce de renforcer son approche à l’égard des services de santé dans la collectivité pour assurer un soutien uniforme, équitable et efficace aux personnes mises en liberté des établissements vers la collectivité.
Le SCC s’affaire à élaborer des normes nationales relatives aux services de santé dans la collectivité à l’appui de la cohérence des services, incluant aux fins de la planification de la continuité des soins. Ces normes serviront à établir une référence en matière de services en conformité avec les politiques du SCC, les pratiques axées sur des données probantes et les principes d’équipe en matière de santé pour favoriser le mieux-être des détenus.
Pour ameliorer davantage la continuité des soins, le SCC mènera aussi un projet de démonstration de la planification améliorée de la continuité des soins pour les personnes ayant des besoins complexes en santé. Le projet reposera sur une approche interdisciplinaire et des ressources y seront dédiées. Les résultats de ce projet serviront à orienter les changements aux politiques, les améliorations aux évaluations ainsi que la formation destinée au personnel.
De plus, conformément aux modifications qu’il a apportées à sa politique en 2019, le SCC demeure déterminé à aider les personnes qui purgent une peine à obtenir leurs pièces d’identité gouvernementales Cela facilitera l’accès aux services après la mise en liberté.
Dans le cadre du plan d’établissement de partenariats du Secteur des services de santé, le SCC continuera de collaborer avec ses partenaires, y compris les provinces et les territoires, pour offrir davantage de services postlibératoires et éliminer les obstacles à l’accès aux soins de santé provinciaux.
Prochaines étapes :
- Lancement du projet de démonstrations de la planification
améliorée de la continuité des soins dans des unités opérationnelles désignées
Échéancier : Été 2026 - Le SCC continuera de peaufiner le plan d’établissement de
partenariats du Secteur des services de santé pour accroître la mobilisation des
services de santé dans la collectivité.
Échéancier : En cours
Annexe B : Renseignements supplémentaires portant sur la planification clinique de la continuité des soins
Tableau 1. Aperçu des libérations sous responsabilité fédérale qui ont atteint le seuil de renvoi pour raisons de santé mentale
| 2022-2023 | 2023-2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nbre | % | Nbre | % | |
| Total des libérations sous responsabilité fédérale* | 6 426 | 6 625 | ||
| Nombre de libérations pour lesquelles les critères de la planification clinique de la continuité des soins ont été respectés** | 377 | 5,9 | 384 | 5,8 |
| Aucun plan de continuité des soins | 69 | 18,3 | 52 | 13,5 |
| Pas de carte d’assurance maladie lors de la libération | 155 | 41,1 | 100 | 26.0 |
| Statut de la carte d’assurance maladie « Inconnu » ou « Carte demandée, mais non reçue » | 69 | 18,3 | 75 | 19,5 |
| Aucun médicament à la libération | 19 | 5,0 | 20 | 5,2 |
| Médicament inconnu à la libération | 78 | 20,7 | 54 | 14,1 |
| ombre de personnes qui répondaient aux critères de la planification clinique de la continuité des soins | 328 | 330 | ||
| Données démographiques | ||||
| Homme | 266 | 81,1 | 268 | 81,2 |
| Femme | 62 | 18,9 | 62 | 18,8 |
| Autochtone | 151 | 46,0 | 146 | 44,2 |
| Blanc | 143 | 43,6 | 144 | 43,6 |
| Noir | 22 | 6,7 | 19 | 5,8 |
| Personnes par région | ||||
| Atlantique | 35 | 10,7 | 34 | 10,3 |
| Québec | 68 | 20,7 | 73 | 22,1 |
| Ontario | 105 | 32,0 | 109 | 33,0 |
| Prairies | 97 | 29,6 | 99 | 30,0 |
| Pacifique | 23 | 7,0 | 15 | 4,6 |
*Source. Données extraites du Système intégré de rapports – Modernisé (SIR-M), le 25 octobre 2024. Toutes les autres données du tableau ont été reçues le 24 octobre 2024 au moyen d’une demande de documentation officielle au SCC.
** Cette section représente les libérations, et non les individus. Une personne peut avoir plus d’une libération au cours d’un exercice financier.
Mise à jour sur les rangées de suivi thérapeutique et les valeurs intermédiaries
Selon les Lignes directrices intégrées en santé mentale de 2023 du Service correctionnel du Canada (SCC), les soins de santé mentale intermédiaires (SSMI) ont pour but de fournir un soutien et un traitement en santé mentale aux personnes incarcérées qui ont des besoins supérieurs à ceux qui peuvent être satisfaits dans les soins primaires, mais qui ne répondent pas aux critères ou qui n’y consentent pas dans un centre régional de traitement (CRT). Bien qu’il soit couramment offert dans une unité désignée, le SSMI est un niveau de service qui peut être offert n’importe où dans l’établissement. Les services de SSMI ont été lancés pour la première fois dans les établissements pour femmes en 2001 avec la création des Milieux de vie structurés (MVS). En 2016, ils ont été introduits dans un établissement à sécurité maximale pour hommes et ont depuis été déployés dans plusieurs établissements à sécurité maximale et moyenne dans toutes les régions.
En 2019-2020, le BEC a mené une enquête systémique nationale sur les SSMI dans des établissements autonomes à sécurité maximale, plus communément appelés « rangées de suivi thérapeutique » (RST). L’enquête a permis de cerner de nombreuses lacunes, notamment les suivantes :
- Sous-utilisation des rangées de suivi thérapeutique et placement des personnes n’ayant pas besoin de SSMI dans les rangées de suivi thérapeutique, souvent comme mesure de gestion de la population.
- Lacunes dans l’apparence thérapeutique des rangées de suivi thérapeutique, qui ne semblaient souvent pas différentes des unités d’isolement traditionnelles.
- Des effectifs qui ne reflétaient pas les besoins de l’établissement, une forte présence de sécurité et un roulement élevé du personnel supérieur en santé mentale.
À la suite de ces constatations, le Bureau a recommandé que le SCC procède à un « examen externe de son modèle de dotation des rangées de suivi thérapeutique et s’assure que la capacité en lits et le personnel reflètent les besoins réels des services de santé mentale ». Le Bureau a également recommandé que le SCC envisage plusieurs améliorations, notamment l’apparence thérapeutique, la sécurité dynamique et l’affectation d’un effectif adéquat de personnel correctionnel et de santé mentale.
Examen des SSMI par le SCC
De septembre 2020 à décembre 2022, le SCC a effectué un examen interne des SSMI dans tous les établissements (à l’exception des CRT) et a communiqué le rapport final et les constatations au Bureau en janvier 2023101. Cet examen a été effectué par un groupe de travail dirigé par le psychiatre principal national du SCC et en consultation avec douze experts externes, avec l’intention explicite de respecter son engagement à l’égard de la recommandation 13 du rapport annuel 2019-2020 du BEC. Bien qu’il ne soit pas externe, l’examen a donné suite à une partie de notre recommandation précédente. Le groupe de travail s’est non seulement penché sur les SSMI dans les unités autonomes à sécurité maximale, mais a également inclus les SSMI dans les établissements à sécurité moyenne pour hommes et les établissements pour femmes. Les constatations et les 38 recommandations reflètent ce que le Bureau a rapporté en 2019-2020, et elles vont même au-delà de cela. Voici quelques points saillants des recommandations présentées au SCC par le groupe de travail :
- Promouvoir l’uniformité nationale dans l’application des critères d’admission et de la planification clinique de la continuité des soins.
- Examiner l’infrastructure et l’environnement physique actuels des unités de SSMI afin de favoriser un environnement thérapeutique et de faciliter les interventions de traitement, le rétablissement, l’amélioration du fonctionnement et la qualité de vie.
- Mettre en œuvre des services d’évaluation et de traitement de la santé mentale individuels et collectifs fondés sur des données probantes qui sont disponibles dans tous les sites de SSMI pour couvrir les besoins en matière de santé mentale les plus courants.
- Affecter des agents correctionnels dédiés aux unités de SSMI pour hommes dans le rôle d’agent thérapeutique afin de faciliter les interactions et d’atteindre les objectifs de traitement et de programmation.
Enquête en cours
Cinq ans se sont écoulés depuis que le Bureau a publié ses constatations et ses recommandations sur les rangées de suivi thérapeutique. Compte tenu de l’accent thématique que nous avons mis sur les soins de santé mentale dans les services correctionnels pour le rapport annuel de cette année, il serait négligent de la part du Bureau de ne pas effectuer un examen de suivi des rangées de suivi thérapeutique et d’enquêter sur les SSMI de manière plus générale. Par conséquent, nous avons examiné les progrès réalisés à l’égard des recommandations antérieures concernant les rangées de suivi thérapeutique – tant du BEC que du groupe de travail du SCC – et effectué un examen sommaire de la prestation des SSMI dans les établissements à sécurité moyenne pour hommes, étant donné que nous n’avions pas encore évalué la mise en œuvre des SSMI à sécurité moyenne. Cela s’est fait au moyen de demandes de documentation, de questionnaires aux six établissements à sécurité maximale102, de correspondance et de visites sur place, ainsi que d’entrevues avec 15 membres du personnel et huit personnes incarcérées. L’objectif de l’enquête était de fournir un aperçu des SSMI dans les établissements de taille maximale et moyenne pour hommes et de rendre compte de l’état et des progrès des SSMI, y compris les lacunes et les défis. D’après les résultats de notre enquête, nos constatations sont les suivantes :
- Les progrès généraux dans les rangées de suivi thérapeutique stagnent.
- L’absence d’une approche normalisée entraîne des soins incohérents et des demandes concurrentes.
- Une infrastructure inadéquate nuit à un environnement thérapeutique.
- La sécurité dynamique et le personnel formé font défaut.
- La discontinuité des soins entraîne un effet de « porte tournante ».
Nos observations antérieures portant sur les rangées de suivi thérapeutique et les unités de soins intermédiaires indiquaient qu’ils n’offraient pas le niveau et la qualité des soins de santé mentale nécessaires pour répondre aux besoins de leurs patients. En fait, nous avons déjà indiqué que ces unités ne sont thérapeutiques que de nom. L’examen interne du SCC a aussi appuyé nos observations. Avec la mise en œuvre des nouvelles dispositions des unités d’intervention structurée (UIS) de 2019, les ressources ont été réaffectées aux UIS et l’orientation ministérielle du SCC s’est délaissée des soins intermédiaires en santé mentale. Notre évaluation initiale selon laquelle ces unités thérapeutiques « ne fonctionnent que de nom » est aussi vraie aujourd’hui qu’elle l’était il y a cinq ans.
Constatations
Profil des SSMI dans les établissements autonomes à sécurité maximale (rangées de suivi thérapeutique)
Comme le montre le tableau 1, sur les six établissements autonomes à sécurité maximale, quatre ont actuellement une unité résidentielle dédiée aux SSMI (c.-à-d. rangées de suivi thérapeutique), comprenant 92 lits financés, avec un effectif budgété d’environ 27 employés et une allocation annuelle de 1,8 million de dollars103. En mars 2025, il n’y avait pas de rangées de suivi thérapeutique dans la région du Québec. Selon le rapport d’examen des SSMI, cela était disponible à l’Établissement de Port-Cartier, au Québec, pendant la période d’examen, mais cela ne semble plus être le cas, d’après notre correspondance avec le site.
À l’Établissement de Donnacona, il était prévu de convertir une partie de l’unité de 96 lits en rangées de suivi thérapeutique (l’unité n’est pas utilisée depuis environ cinq ans), mais les plans ont été retardés en raison de problèmes non résolus avec l’infrastructure, ainsi que de problèmes de personnel et de sécurité. Avec l’ouverture prévue de ses rangées de suivi thérapeutique le 15 avril 2025, le personnel de Donnacona a indiqué que des mesures provisoires sont en place pour gérer les personnes ayant des besoins en matière de santé mentale. Ces mesures comprennent des rendez-vous avec des psychiatres au besoin et des suivis périodiques; une surveillance et des soins continus par une équipe de professionnels de la santé mentale; et les transferts au Centre régional de santé mentale (CRSM) en cas de besoin grave ou de détresse aiguë. Bien que ces mesures provisoires soient nécessaires, le fait d’avoir une région entière sans SSMI au niveau de sécurité maximale pendant une période prolongée a inévitablement exercé des pressions sur les soins primaires et a entraîné un soutien en santé mentale incohérent et inadéquat pour les personnes.
Tableau 1. Dotation pour les SSMI dans les établissements autonomes à sécurité maximale pour hommes
| ÉTABLISSEMENT | RÉGION |
UNITÉ DE RANGÉE DE SUIVI THÉRAPEUTIQUE DÉSIGNÉE |
PERSONNEL BUDGÉTISÉ | PERSONNEL ACTUEL* | LITS FINANCÉS | LITS NON FINANCÉS* | ALLOCATION DE SSMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | Atlantique | Oui | 7 | 0 | 30 | 0 | 560 983 $ |
| Millhaven | Ontario | Oui | 5 | 5 | 20 | 3 | 548 234 $ |
| Edmonton | Prairie | Oui | 5 | 2 | 18 | 6 | 244 054 $ |
| Kent | Pacifique | Oui | 5 | n/a | 24 | n/a | 437 470 $ |
| Port-Cartier | Québec | Non | -- | -- | -- | -- | -- |
| Donnacona | Québec | Non | 5 | -- | -- | -- | 25 469 $ |
| Total | 4 sur 6 | 27 | 7 | 92 | 9 | 1 816 210 $ |
Source: Données reçues du SCC le 23 avril 2025.
* Les données sur le personnel réel et les lits non financés sont fondées sur les réponses reçues dans le cadre de questionnaires institutionnels menés à l’automne 2024.
Profil des SSMI dans les établissements à sécurité moyenne pour hommes
Selon la documentation fournie par le SCC, les SSMI sont actuellement offerts dans sept établissements104 à sécurité moyenne pour hommes (voir le tableau 2) qui comprennent 136 lits financés, avec un effectif budgété d’environ 39 employés et une allocation annuelle de plus de 3 millions de dollars105. La prestation de services et d’une unité désignée ne semble toutefois pas être uniforme ni soutenue. Par exemple, certains sites qui offraient auparavant des services de SSMI ont signalé qu’ils n’existaient plus en raison d’un manque de ressources et de personnel. La capacité et l’utilisation des lits variaient d’un site à l’autre, certains étant gérables et d’autres rencontrant des difficultés avec les listes d’attente, en particulier dans les régions où les SSMI n’étaient disponibles que dans un seul établissement.
Tableau 2. Resourcing for IMHC at Men’s Medium-Security Institutions
| ÉTABLISSEMENT | RÉGION | UNITÉ DÉSIGNÉE DE SSMI | PERSONNEL BUDGÉTISÉ | LITS FINANCÉS | ALLOCATION DE SSMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorchester | Atlantique | Oui | 5 | 20 | 508 266 $ |
| Centre fédéral de formation | Québec | Oui | 5 | 20 | 611 114 $ |
| Archambault* | Québec | Non | 5 | N/A | 332 791 $ |
| Bath | Ontario | Oui | 7 | 38 | 589 304 $ |
| Warkworth | Ontario | Oui | 5 | 20 | 482 193 $ |
| Stony Mountain | Prairies | Oui | 7 | 22 | 264 842 $ |
| Matsqui | Pacifique | Oui | 5 | 16 | 428 297 $ |
| Total | 6 sur 7 | 39 | 136 | 3 216 807 $ |
Source: Données reçues du SCC le 23 avril 2025.
* Archambault n’a pas d’unité désignée de SSMI ni de nombre désigné de lits, car les soins sont fournis sur une base ambulatoire.
Les progrès généraux dans les rangées de suivi thérapeutique stagnent
Ce que nous avons trouvé dans les rangées de suivi thérapeutique était décourageant et montrait des signes clairs d’inertie, avec peu d’indications de changements importants au cours des cinq dernières années. Interrogé sur les progrès généraux et les efforts déployés pour améliorer les rangées de suivi thérapeutique, un site a noté que rien n’avait changé depuis que le Bureau a fait rapport sur les unités en 2019-2020. Un autre site a énuméré plusieurs efforts qu’ils avaient tentés en vue d’améliorer l’unité (par exemple, programmes dans l’unité, programmes de jardinage, zoothérapie), mais a exprimé des frustrations concernant les obstacles, car la plupart des demandes avaient été refusées par la direction en raison de « ressources opérationnelles ».
Comparativement aux rangées de suivi thérapeutique maximales, il semble que des progrès aient été réalisés dans la prestation de SSMI dans les établissements à sécurité moyenne. Le personnel a souligné l’importance d’offrir un soutien individuel en santé mentale dans ces unités. Les approches de traitement actuelles comprennent des plans de traitement individualisés, des interactions plus fréquentes et périodiques avec le personnel de santé mentale, une supervision plus directe, la gestion des médicaments ainsi que des interventions individuelles et de groupe. La plupart des centres de SSMI de moyenne taille offrent également des activités thérapeutiques en dehors des interventions (par exemple, accès à des salles sensorielles, à un jardin, à des clubs de marche et de lecture). Le personnel a toutefois noté que la mise en œuvre de ces améliorations n’était pas sans difficulté, de nombreuses demandes ayant été refusées ou prenant exceptionnellement de temps pour être approuvées, en raison de prétendus problèmes de « sécurité et de ressources opérationnelles ». Comme l’a indiqué un résident des SSMI, « le personnel [de la santé mentale] fait de son mieux et se creuse la tête, mais [la direction] va continuer à mettre des obstacles sur son chemin ». Malgré certains signes de progrès en matière de sécurité moyenne, dans l’ensemble, des défis et des lacunes importantes demeurent.
L’absence d’approche normalisée entraîne des soins incohérents et des demandes concurrentes
Un problème fondamental des SSMI dans son ensemble et qui a été soulevé dans les établissements à sécurité maximale et moyenne est le manque de soins et de lignes directrices normalisés. Cela a été signalé comme une lacune dans le rapport d’examen des SSMI, où on a noté que, bien que les établissements pour hommes aient des besoins uniformes en matière de personnel et les mêmes critères d’admission et de congé, « ils n’ont pas d’exigences communes en matière d’infrastructure ou de programmes de santé mentale ». Pour cette raison, le rapport recommandait au SCC de prendre les mesures suivantes :
« Mettre sur pied un groupe consultatif national pour les SSMI afin de superviser le Service et de promouvoir l’uniformité, la qualité des soins et l’amélioration de la qualité à l’échelle nationale, notamment en établissant des normes nationales pour les SSMI […] Créer une communauté de pratique pour le personnel travaillant avec la population des SSMI. »
Examen des services intermédiaires de soins de santé mentale dans les établissements ordinaires du Service correctionnel du Canada et recommandations connexes : aperçu, objectif, principes et processus (Rapport du SCC, janvier 2023).
Bien que ces recommandations aient été formulées en 2023, les sites nous ont indiqué que les directives normalisées sont « inexistantes » et que le rôle et l’objectif des SSMI, en particulier de la part de la direction, sont peu compris. Le personnel a noté que l’absence d’une vision normalisée a entraîné des approches variables d’un site à l’autre, sans mécanisme centralisé d’échange d’information ou de ressources. Le personnel a également indiqué que lorsque le modèle des SSMI a été mis en œuvre, on leur a dit d’établir de nouvelles unités et de concevoir de nouvelles approches en matière de soins de santé mentale, tout en recevant peu de conseils de l’administration centrale, aucune recommandation, aucun outil ou soutien fondé sur des données probantes. Par conséquent, les personnes incarcérées qui ont besoin de soins intermédiaires reçoivent probablement des soutiens et des interventions différents, incohérents ou inadéquats d’un établissement à l’autre et d’une région à l’autre.
En plus des soins incohérents, sans une vision claire et une approche normalisée, les SSMI se perdent dans le monde en évolution des services de santé mentale et des demandes concurrentes dans les services correctionnels. Par exemple, le personnel des maximums autonomes a signalé de multiples défis pour répondre aux besoins des patients des SSMI, car le personnel est souvent préoccupé par des demandes en dehors des rangées de suivi thérapeutique, comme les unités d’intervention structurée (UIS). Comme l’a signalé le Bureau, les UIS sont connues pour détourner les ressources en santé mentale dans les établissements à sécurité maximale, comme l’explique la personne interrogée suivante : « Il n’y a pas de norme. Le système a très bien fonctionné jusqu’à l’ouverture des UIS, puis soudainement, cela [les SSMI] a été mis en veilleuse. Nous avons toujours les mêmes personnes, mais maintenant nous n’avons plus de ressources, rien pour nous occuper d’eux, et il n’y a pas de lignes directrices pour quoi que ce soit. Honnêtement, la seule chose dans les lignes directrices est l’effectif du personnel. [Et] nous ne l’avons pas. »
Utilisation inappropriée des lits des SSMI
Dans le même ordre d’idées, des normes insuffisantes et des demandes concurrentes ont également été soulevées au sujet des points de vue divergents sur les critères d’admission et les pouvoirs décisionnels. Certains sites ont signalé des désaccords continus avec le personnel des opérations qui insiste pour utiliser des lits non financés dans les rangées de suivi thérapeutique pour « soulager les pressions opérationnelles ». Un membre du personnel a indiqué que même si les décisions de placement des SSMI sont « censées être prises stratégiquement », le personnel opérationnel utilisait les rangées de suivi thérapeutique comme « un dépotoir ». Un autre membre du personnel l’a indiqué comme suit : « C’est la même chose que l’UIS maintenant, ils laissent tomber ici des personnes qui ont des conflits interpersonnels ailleurs, ou qui ont simplement peur d’être en prison. Ce n’est pas de la santé mentale. »
Bien que moins fréquent dans les établissements à sécurité moyenne, ce problème a été soulevé. Le personnel a indiqué que cette pratique peut avoir des répercussions importantes sur les résidents des SSMI, interférant avec leurs soins de santé mentale et la stabilité de l’unité. Cette préoccupation est directement liée à l’une des recommandations de l’examen des SSMI selon laquelle « l’admission clinique et le congé de ces unités devraient être une décision en matière de soins de santé fondée sur des critères cliniques »; une recommandation que le BEC appuie pleinement.
Une infrastructure inadéquate nuit à un environnement thérapeutique
La question de l’environnement thérapeutique a été soulevée à plusieurs reprises dans nos rapports précédents et dans le rapport d’examen des SSMI du SCC. Dans la plupart des cas, les rangées de suivi thérapeutique maximales demeurent très semblables à celles des anciennes unités d’isolement, malgré certains efforts du personnel bien intentionné. Lorsqu’on a demandé quelles mesures avaient été prises pour améliorer l’environnement, un site a répondu qu’il avait peint des zones des rangées de suivi thérapeutique pour donner une apparence plus thérapeutique, mais qu’ils ont dû repeindre la section puisqu’ils n’avaient pas obtenu les approbations appropriées. Un autre site n’a pu offrir que ce qui suit : « Les rangées de suivi thérapeutique n’ont pas un accès habituel au [gymnase ou à la grande cour]. Nos patients refusent souvent de se rendre dans une petite cour parce qu’ils sont exposés à d’autres unités par leurs fenêtres et le personnel [des rangées de suivi thérapeutique] a reçu des rapports de violence verbale entre délinquants. […] Les rangées de suivi thérapeutique n’ont pas de cellules accessibles, d’utilisation courante d’un ascenseur ou d’une douche accessible, ce qui limite notre capacité à admettre des délinquants ayant des problèmes de mobilité particuliers. »
Dans les établissements à sécurité moyenne, les personnes à qui nous avons parlé ont noté des problèmes relatifs à l’infrastructure physique, invoquant un espace insuffisant pour les personnes incarcérées et le personnel, et un environnement thérapeutique limité. Certains sites ont également soulevé des préoccupations concernant la visibilité de l’unité, soulignant que le manque d’intimité peut accroître la stigmatisation et la victimisation vécues par les résidents des SSMI. Lorsque les unités de soins de santé mentale ne se distinguent pas des autres secteurs de la prison, il n’est pas raisonnable de s’attendre à une amélioration quant aux patients ou à un changement de culture au sein du personnel. À l’heure actuelle, l’environnement physique des unités des SSMI n’est ni propice ni compatible avec des soins de santé mentale appropriés.
La sécurité dynamique et le personnel formé font défaut
Bien que tous les sites semblent être d’accord avec la nécessité d’embaucher du personnel opérationnel spécialement formé (par exemple, les agents de l’unité thérapeutique)106 qui a des intérêts particuliers à mobiliser les patients, à assurer la sécurité dynamique et à collaborer avec le personnel des Services de santé mentale, cela n’a pas toujours été le cas dans la pratique. Par exemple, le poste d’agent de l’unité thérapeutique, recommandé par le BEC et l’examen des SSMI, a été, la plupart du temps, mal mis en œuvre dans les unités maximales. Voici comment un membre du personnel a décrit le problème : « Nous avions un agent thérapeutique dédié à l’unité [rangées de suivi thérapeutique], mais aucun poste de ce genre n’existe actuellement pour prêter assistance avec les programmes. De plus, cela a créé des tensions entre les services, car les opérations ont été en conflit à ce sujet et le personnel de la santé mentale est pris au milieu. » Un autre membre du personnel a indiqué : « Il y a un agent [des rangées de suivi thérapeutique] à chaque quart de jour, mais il n’a pas de formation particulière sur la maladie mentale ou la prestation de services de santé mentale Les agents font également des rotations en tant que travailleurs de quarts, ce qui diminue leur capacité à établir des relations avec nos patients et à bien comprendre le fonctionnement des rangées de suivi thérapeutique. »
Le personnel a reconnu que certains membres du personnel opérationnel travaillent volontairement dans les unités des SSMI et ont vraiment un intérêt à travailler avec ce type de population; cependant, d’autres ne sont pas adaptés à travailler avec des personnes ayant des besoins en matière de santé mentale. Une formation et une mise en œuvre adéquates du rôle d’agent de l’unité thérapeutique pourraient aider à atténuer bon nombre de ces problèmes.
Au-delà du poste d’agent, des problèmes relatifs aux postes vacants ont également été signalés, en particulier avec le personnel en psychologie. Le recrutement et le maintien en poste continuent d’être des problèmes qui entraînent des conséquences négatives, comme la réduction des possibilités de soutien psychologique et la capacité limitée d’effectuer des évaluations diagnostiques. L’importance de l’embauche, de la formation et du maintien d’un personnel constant, expérimenté et spécialisé pour la stabilité des patients a souvent été soulignée par le personnel et est une préoccupation partagée par le Bureau. Avec les postes vacants, le fardeau du travail incombe inévitablement à d’autres personnes à qui l’on demande de faire plus avec moins. Sans un soutien adéquat, l’épuisement du personnel et les répercussions négatives sur la population des SSMI sont inévitables.
La discontinuité des soins entraîne un effet de « porte tournante »
Le personnel et les personnes incarcérées ont soulevé des préoccupations quant à la continuité des soins de santé mentale; plus précisément, la transition des SSMI à la population générale et la libération dans la collectivité. Entre autres préoccupations, ils ont souligné une lacune notable dans la disponibilité et l’accès aux soutiens en santé mentale une fois qu’une personne quitte les SSMI. Dans certains cas, les personnes ont reçu leur congé des SSMI et ont rencontré des difficultés dans la population générale et sont retournées à l’unité à plusieurs reprises. De même, il y a eu des cas où des personnes ont été libérées, puis rapidement révoquées alors qu’elles étaient sous surveillance au sein de la collectivité. Un site a même révélé qu’il avait mis en œuvre une pratique consistant à garder le lit d’une personne disponible pendant un certain temps après sa libération dans la collectivité, en prévision qu’elle puisse bientôt revenir. Naturellement, le personnel nous a indiqué que le soutien des SSMI à plusieurs reprises tout au long de son parcours en matière de santé mentale n’est pas nécessairement négatif. Cependant, si des personnes reviennent aux SSMI par une porte tournante puisqu’elles ne peuvent pas accéder à des services adéquats, alors le système les a laissées tomber.
Conclusion
Près de dix ans se sont écoulés depuis l’introduction des services des SSMI dans les établissements pour hommes, cinq ans depuis que le BEC a publié son enquête portant sur les rangées de suivi thérapeutique et plus de deux ans depuis l’examen des services des SSMI par le SCC. Au cours de cette période, des millions de dollars ont été investis dans le cadre de ce service. Dans le cadre de cette enquête, nous avons demandé au Service de répondre aux données probantes inhérentes aux progrès réalisés par rapport aux recommandations qui lui ont été présentées au sujet des SSMI. Conformément à ce que nous avons observé lors de nos visites sur place et de nos entrevues, les réponses du SCC étaient vagues et manquaient de données probantes inhérentes aux progrès substantiels et concrets.
Dans les derniers paragraphes de son rapport de 2023, le groupe de travail a indiqué que « l’examen plus approfondi des recommandations sera important dans l’examen de stratégies de mise en œuvre efficaces pour soutenir l’amélioration continue des services de soins intermédiaires de santé mentale du SCC ». Bien que nous soyons largement d’accord avec les constatations du rapport, cette déclaration est décevante et en deçà de ce qui est requis à ce stade-ci. Aucun autre examen n’est nécessaire Les entrevues avec le personnel du SCC et des intervenants externes suggèrent fortement une prévalence croissante des besoins en matière de santé mentale et des troubles relatifs à la consommation de substances concomitantes chez les personnes purgeant une peine de ressort fédéral. Le besoin d’interventions efficaces en santé mentale ne fera que croître. L’action, par voie de mise en œuvre des recommandations formulées par le Bureau et le groupe de travail du SCC, est la prochaine étape.
Je recommande que le Service correctionnel du Canada réalise ce qui suit :
- Répondre immédiatement à la recommandation et aux enjeux soulevés précédemment par le BEC concernant les rangées de suivi thérapeutique et la prestation de soins intermédiaires de santé mentale.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE
Reconnaissant que le Bureau de l’enquêteur correctionnel a déjà formulé des recommandations à ce sujet, le SCC se servira de cette recommandation pour orienter l’apport d’améliorations à son continuum de soins.
Le SCC a chargé le psychiatre principal national de mener un examen approfondi des soins intermédiaires de santé mentale, y compris des soins offerts dans les rangées thérapeutiques (soins intermédiaires de santé mentale dans les établissements à sécurité maximale), en consultation avec des experts externes en réponse aux recommandations du Bureau de l’enquêteur correctionnel. L’objectif primaire de cet examen consistait à améliorer la qualité, particulièrement à améliorer les résultats en matière de santé mentale, le fonctionnement et la qualité de vie des détenus souffrant de troubles mentaux. Les recommandations ont relevé plusieurs domaines prioritaires, dont les suivants : la normalisation des processus; la composition ainsi que les rôles et les responsabilités du personnel; la planification de la continuité des soins et la transition des soins; et les approches de collaboration accrue avec les partenaires intersectoriels.
À la lumière des conclusions du rapport, le SCC a établi quatre objectifs clés pour l’exercice 2025 à 2026 :
- Fournir des traitements individuels et de groupe dans toutes les unités de soins intermédiaires de santé mentale.
- Fournir des soins intermédiaires de santé mentale en milieu ambulatoire dans tous les établissements.
- Fournir des évaluations diagnostiques normalisées dans toutes les unités de soins intermédiaires de santé mentale.
- S’assurer que des activités de la vie quotidienne sent offertes dans toutes les unités de soins intermédiaires de santé mentale.
Le SCC apportera des améliorations au modèle de soins intermédiaires de santé mentale pour normaliser la prestation de services en réponse aux recommandations issues de l’examen et à celles du Bureau de l’enquêteur correctionnel.
Prochaine étape : Le SCC réalisera un examen des services de soins intermédiaires de santé mentale a l’appui de la normalisation des services.
Échéancier : Exercice 2025 à 2026
-
Répondre immédiatement à chacune des 38 recommandations énoncées
dans le rapport du Groupe de travail des SSMI intitulé « Examen des services
intermédiaires de soins de santé mentale dans les établissements ordinaires du
Service correctionnel du Canada et recommandations connexes : aperçu, objectif,
principes et processus » (11 janvier 2023). Plus précisément, je recommande que
le SCC réalise ce qui suit :
- Élaborer et rendre compte publiquement d’un plan traitant de chacune des 38 recommandations et y répondant individuellement avec des mesures concrètes et des échéanciers d’ici la fin de l’exercice financier 2025-2026.
- Assurer la mise en œuvre complète de chacune des 38 recommandations d’ici 2026-2027.
Réponse du SCC : REJETÉ
Le SCC apporte des améliorations au modèle de soins intermédiaires de santé mentale pour donner suite aux recommandations du Bureau de l’enquêteur correctionnel et à celles énoncées dans le rapport « Examen des services de soins intermédiaires de santé mentale dans les établissements réguliers du Service correctionnel du Canada et recommandations connexes » publié le 11 janvier 2023 par le SCC. Le SCC s’attaquera en priorité à la normalisation des évaluations et des interventions dans l’ensemble des unités de soins intermédiaires de santé mentale, à la prestation de soins intermédiaires de santé mentale en tant que services ambulatoires et offerts en unité pour mieux répondre aux besoins en santé des détenus, et à l’amélioration des données et de la surveillance. Les recommandations supplémentaires du rapport seront évaluées en vue de leur mise en œuvre éventuelle.
De plus, le SCC commencera à publier un document renfermant un aperçu du système de santé et une fiche d’évaluation de la qualité dès l’été 2025. Ce document offrira une vue d’ensemble des besoins en santé des détenus et du rendement du système de santé du SCC du point de vue des détenus et de l’amélioration de la qualité. De plus, il contribuera à la communication continue de données pour comprendre les besoins et les résultats en matière de santé de la population et favoriser une culture axée sur l’amélioration de la qualité au SCC. Le SCC publiera ce document à caractère évolutif sur le Web et le transmettra aux intervenants clés sur une base annuelle.
Prochaine étape : Le SCC réalisera un examen des services de soins intermédiaires de santé mentale à l’appui de la normalisation des services.
Échéancier : Exercice 2025 à 2026
Évaluation et traitement des traumatismes chez les femmes purgeant une peine de ressort fédéral
Bien que cela soit difficile de quantifier, il est largement reconnu que la plupart des femmes107 qui ont des démêlés avec le système de justice pénale ont des antécédents de traumatisme et de victimisation. Leurs expériences de vie sont profondément associées à leur implication dans le système de justice et ne peuvent être facilement séparées des circonstances qui ont mené à leur incarcération. Dans le cadre de cette enquête, le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC) a collaboré avec le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC). Ce partenariat unique a apporté une dimension supplémentaire de rigueur et de compassion à l’enquête. Il a également fourni un contexte sûr et favorable aux femmes incarcérées pour qu’elles puissent partager comment elles ont géré leur peine de ressort fédéral tout en portant le fardeau des traumatismes et de la victimisation passés. La collaboration a permis une approche qui tient véritablement compte des traumatismes.
Je remercie sincèrement Benjamin Roebuck, Ph. D., ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, et son équipe pour leur perspicacité et leur soutien. Leur professionnalisme et leur expertise en la matière ont grandement enrichi cette enquête et nous ont permis de mieux comprendre les défis complexes auxquels font face les femmes incarcérées sous responsabilité fédérale.
Le traumatisme représente la réaction émotionnelle durable qui résulte souvent de vivre un événement pénible ou perturbant. Ces expériences peuvent miner considérablement le sentiment de sécurité, l’identité et la capacité d’une personne à réguler ses émotions. Longtemps après l’événement, les personnes peuvent continuer à ressentir de la honte, de l’impuissance, de la peur et une dérégulation émotionnelle108.
La recherche, y compris les données du SCC, a démontré que les femmes purgeant une peine de ressort fédéral sont touchées de manière disproportionnée par les traumatismes, y compris les taux élevés de traumatismes interpersonnels, de victimisation, de trouble de stress post-traumatique (TSPT) et d’exposition à la violence109. Pour les femmes autochtones, les répercussions des traumatismes sont souvent intergénérationnelles, historiques et collectives. Bien que les traumatismes ne soient pas officiellement reconnus comme un besoin criminogène par les outils d’évaluation du risque du SCC, il existe un lien fort et bien documenté entre les traumatismes et la criminalisation des femmes110. Par conséquent, le SCC a la responsabilité unique de comprendre et d’aborder les répercussions des traumatismes. Cette enquête explore la façon dont les traumatismes sont évalués et traités dans le système correctionnel fédéral, et si les approches actuelles sont adaptées au genre, sont culturellement pertinentes et tiennent compte des traumatismes.
Enquête en cours
Dans le cadre de cette enquête, les méthodes suivantes ont été utilisées :
-
des visites ont été effectuées dans les établissements suivants :
- Établissement de la vallée du Fraser (EVF)
- Établissement d’Edmonton pour femmes (EEPF)
- Établissement Joliette pour femmes (EJPF)
- Centre psychiatrique régional (CPR) – Unité Assiniboine
- Des entrevues qualitatives ont été menées auprès d’un total de 36 femmes incarcérées. Les questions portaient sur la façon dont leurs antécédents de traumatisme sont reconnus et traités en milieu carcéral, les interactions avec le personnel, l’exposition à des événements déclencheurs et l’accès aux services de santé mentale ou aux programmes pertinents.
- Des entrevues qualitatives ont également été menées auprès de 34 employés et gestionnaires des établissements. Ces questions portaient sur la formation et les outils disponibles relatifs aux traumatismes et aux pratiques tenant compte des traumatismes, au personnel et aux ressources, ainsi qu’aux défis opérationnels.
- Examen de la littérature pertinente portant sur les traumatismes et les femmes incarcérées.
- Examen et évaluation de la recherche, des programmes, du matériel de formation, des services et des interventions du SCC.
Approche tenant compte des traumatismes et traitement propre aux traumatismes
Bien qu’ils soient souvent utilisés de manière interchangeable, ces termes font référence à des concepts différents, mais connexes :
- Une approche tenant compte des traumatismes nécessite une compréhension de l’effet du traumatisme sur les personnes et de son lien avec les problèmes de santé mentale et physique, la toxicomanie, les problèmes de comportement et le développement du cerveau. Il s’agit alors d’intégrer ces connaissances dans les politiques et les pratiques afin de minimiser les dommages ou les traumatismes renouvelés.
- Le traitement propre aux traumatismes fait quant à lui référence à la fourniture d’approches thérapeutiques précisément conçues pour traiter les traumatismes et les symptômes connexes, dans le but de faciliter la guérison et le rétablissement.
Constatations
L’environnement carcéral comme source ou déclencheur de traumatisme
« J’estime honnêtement que cela ajoute plus de traumatisme à ma vie. Je suis arrivée ici avec beaucoup de traumatismes et j’ai l’impression que je vais repartir avec plus de traumatismes que je n’en ai eu au départ (…) Je m’isole beaucoup parce que je n’ai personne avec qui me connecter (…) Je reste assise là. Je souffre de dépression, d’anxiété, de TSPT et d’un trouble panique, et je commence à être plus déprimée. Je remarque aussi que je me retire des activités que j’aimais auparavant. »
Personne interrogée incarcérée
L’incarcération elle-même peut constituer une expérience traumatisante. De nombreuses femmes ont dit au Bureau que l’environnement carcéral – hostile, souvent violent et marqué par un manque d’autonomie – a détérioré leur santé mentale, déclenché des traumatismes passés ou donné lieu à de nouvelles expériences traumatisantes. Certaines ont dit se sentir constamment sur les nerfs ou encore émotionnellement fatiguées. Les pratiques institutionnelles courantes, y compris les fouilles à nu, les fouilles cellulaires, les dénombrements institutionnels, les confinements, et le récit de son histoire aux nouveaux employés, ont toujours été déterminées comme des éléments déclencheurs. Les femmes ont indiqué que ces pratiques mènent souvent à des comportements relatifs à des traumatismes comme l’agressivité, le repli sur soi et l’impulsivité111. Ces comportements sont rarement compris comme des réactions traumatiques et se traduisent souvent par des réponses fondées sur la sécurité, comme le recours à la force, la perte de privilèges ou dans certains cas, le placement dans l’unité d’intervention structurée (UIS).
En même temps, de nombreuses femmes ont exprimé un fort désir de travailler à l’égard de leur traumatisme durant leur incarcération. Elles ont reconnu que, malgré les obstacles institutionnels, c’est peut-être la seule période de leur vie où elles peuvent réfléchir, faire une pause et commencer le processus de guérison. Comme l’a expliqué une femme : « C’est le meilleur endroit pour cela. J’ai commis un homicide à cause de mon chagrin et de mon traumatisme (…). C’est donc ce sur quoi nous devons travailler. C’est le seul endroit où le faire C’est bien à ce moment-là que nous avons le temps de le faire. Dès que nous sortons, nous n’avons plus le temps de le faire. Mais alors, quand allons-nous le faire? Quand vous êtes dans la maison de transition et que vous devez travailler? »
Les programmes du SCC comme la thérapie comportementale dialectique (TCD) visent à aider les femmes à faire face à la dérégulation émotionnelle et à l’impulsivité. Ces approches sont utiles, mais elles ne sont pas les mêmes que les thérapies pour le traitement du traumatisme. De nombreuses femmes nous ont indiqué que les programmes axés sur les capacités d’adaptation ne font « qu’effleurer la surface ». Elles veulent aussi avoir l’occasion d’explorer et d’aborder le traumatisme sous-jacent.
En l’absence de counseling officiel en matière de traumatisme, de nombreuses femmes ont indiqué qu’elles faisaient de leur mieux pour s’autoréguler et faire face à l’incarcération grâce à l’exercice physique, à la spiritualité, à l’art et au soutien par les pairs. Bien qu’elles soient louables, ces stratégies nécessitent souvent le soutien de professionnels qualifiés pour être efficaces et sécuritaires. Une femme décrit sa volonté et sa réticence à demander de l’aide en ces termes : « Il n’y a pas d’espace commun sûr ici. Si cela existait, je l’aurais fait et je serais en train de le faire. Je suis prête à faire tout et n’importe quoi. »
Bien qu’il y ait des défis connexes, il existe des données probantes scientifiques suggérant que les thérapies de traitement des traumatismes et les interventions individuelles axées sur les traumatismes peuvent être efficaces et offertes avec succès en prison112.
Cependant, les options existantes, comme le Centre psychiatrique régional (Prairies) ou les pavillons de ressourcement, ne sont pas structurées ou dotées de ressources pour répondre aux besoins des femmes ayant subi un traumatisme complexe.
Absence d’évaluation et de dépistage des traumatismes
Un dépistage et une évaluation efficaces sont essentiels pour assurer un traitement et une intervention appropriés. Dans le système correctionnel fédéral, le Système informatisé de dépistage des troubles mentaux à l’évaluation initiale (SIDTMEI) est l’outil normalisé principal utilisé pour déterminer les personnes ayant besoin de services de santé mentale. Il se compose de cinq outils de dépistage distincts qui évaluent divers symptômes psychologiques et risques. Cependant, le SIDTMEI n’inclut pas de dépistage particulier de l’exposition aux traumatismes et n’est ni adapté au genre ou aux contextes culturels.
Un outil largement reconnu pour le dépistage des traumatismes est le Questionnaire sur les expériences négatives de l’enfance (QENE). Les expériences négatives de l’enfance comme la maltraitance, la négligence et le dysfonctionnement des ménages sont fortement associées à un risque accru de problèmes de santé chroniques, de maladie mentale, de consommation de substances et même de décès prématuré113. Bien que le SCC ne dépiste pas systématiquement les expériences négatives de l’enfance, une étude du SCC de 2023 a exploré leur prévalence et leur incidence sur les résultats en établissement et dans la collectivité. L’étude a révélé que les expériences négatives de l’enfance sont courantes au sein de la population carcérale sous responsabilité fédérale, en particulier chez les femmes et les femmes autochtones. Les expériences négatives de l’enfance étaient associées à des résultats correctionnels négatifs, et l’étude recommandait d’utiliser ces connaissances pour éclairer des stratégies et des interventions de gestion de cas plus réactives114. Malgré ces constatations, le SCC n’a pas mis en œuvre d’outil de dépistage particulier aux traumatismes ou aux expériences négatives de l’enfance. Par conséquent, le Service demeure mal outillé pour évaluer adéquatement le traumatisme afin d’offrir des interventions complètes tenant compte des traumatismes ou propres aux traumatismes.
En l’absence d’un dépistage officiel, les femmes incarcérées et le personnel du SCC ont dit à mon Bureau que des expériences de vie traumatisantes sont généralement abordées lors de l’admission ou des programmes. Cependant, ces discussions sont principalement axées sur le lien avec le comportement criminel et utilisées pour évaluer le risque et les besoins et non à des fins thérapeutiques. Par conséquent, de nombreuses femmes ont indiqué être réticentes à divulguer leur traumatisme par crainte que l’information apparaisse dans les rapports officiels ou ne soit utilisée contre elles. Elles ont aussi indiqué que discuter d’expériences profondément douloureuses les laisse souvent honteuses, dépassées et sans soutien. Une femme a raconté à quel point elle se sentait en perte de pouvoir en lisant cet extrait de son plan correctionnel, après avoir révélé son traumatisme : « Les renseignements sur les dossiers et les entrevues indiquaient qu’elle avait un problème de comportement lorsqu’elle était enfant. Elle a indiqué être sexuellement active depuis l’âge de huit ans. Elle a été en mesure de développer des compétences en communication comme moyen de survie personnelle qui ont notamment contribué à sa capacité bien établie à frauder à l’âge adulte. ». Ce type d’évaluation et de rapport fondé sur les risques n’est pas fondé sur les traumatismes. Cela peut notamment causer des dommages importants et miner les efforts de réadaptation.
Formation inadéquate associée aux traumatismes et approches tenant compte des traumatismes
La création d’une organisation tenant compte des traumatismes nécessite plus qu’une prise de conscience Cela exige une compréhension approfondie de la façon dont les individus perçoivent, s’adaptent et réagissent aux traumatismes, ainsi qu’un engagement à réviser les pratiques qui peuvent déclencher par inadvertance des expériences passées ou des sentiments d’impuissance115. Concrètement, le personnel du SCC doit non seulement reconnaître les répercussions généralisées des traumatismes, mais aussi comprendre comment ils peuvent se manifester sur le plan comportemental et émotionnel dans un environnement correctionnel. Cet engagement doit être intégré à tous les échelons des opérations.
Cependant, de nombreux membres du personnel du SCC interrogés par mon Bureau ont indiqué que la formation actuelle – principalement les Normes nationales de formation du Service correctionnel du Canada et la Trousse d’approche tenant compte des traumatismes disponibles sur le Hub du SCC – est estimée comme élémentaire, répétitive et inadéquate pour préparer le personnel à gérer la complexité des traumatismes ou à travailler efficacement avec des personnes ayant des besoins complexes. En décrivant cette lacune, un agent de libération conditionnelle a dit à mon personnel : « J’en profite souvent et je cherche une formation supplémentaire; il y en a dans la formation centrée sur les femmes, mais c’est rudimentaire. »
Bien que la plupart des membres du personnel puissent formuler une compréhension générale de ce qu’implique une approche tenant compte des traumatismes, beaucoup ne comprenaient pas de façon plus approfondie comment les antécédents de traumatisme peuvent influencer le comportement en détention ou comment les pratiques correctionnelles courantes peuvent être des éléments déclencheurs. Bien que certaines pratiques, comme les fouilles à nu, aient été facilement reconnues comme potentiellement nuisibles, d’autres (par exemple, les bruits forts, les communications agressives, les contacts physiques et l’utilisation de lampes de poche pendant les dénombrements nocturnes) n’ont pas été déterminées comme des éléments déclencheurs et ont été estimées comme des aspects normalisés et inévitables du milieu correctionnel.
Plus inquiétant encore, plusieurs membres du personnel ont reconnu que même s’il est important de tenir compte des traumatismes en théorie, en pratique, tout incident comportemental entraîne une intervention de sécurité par défaut, souvent au détriment d’une intervention de soutien ou thérapeutique. Un membre du personnel du SCC, interrogé sur les approches tenant compte des traumatismes, l’a mieux décrit lorsqu’il a répondu : « C’est bien, jusqu’à ce que cela se transforme en incident de sécurité. »
Ressources psychologiques insuffisantes
Le Bureau a soulevé à maintes reprises des préoccupations au sujet de la planification et de la prestation des services de santé mentale au sein des établissements fédéraux. Sans surprise, la raison la plus fréquemment invoquée pour expliquer l’incapacité du SCC à fournir un traitement propre aux traumatismes est le manque de ressources. Compte tenu de la population ayant des besoins élevés et de la disponibilité limitée des services psychologiques, la majorité des ressources sont dirigées vers les personnes ayant les besoins les plus aigus ou les plus urgents. Par conséquent, le counseling individuel pour les enjeux non urgents est difficile d’accès, souvent avec des temps d’attente importants.
Le personnel du SCC et les femmes incarcérées ont dit à mon Bureau qu’en l’absence d’un traitement psychologique uniforme et accessible, les interventions pharmaceutiques sont couramment utilisées pour gérer les symptômes et les comportements associés aux traumatismes. Une femme a décrit un scénario typique comme suit : « Vous obtenez des produits pharmaceutiques ici jusqu’à ce que vous soyez bleu au visage (…). Ce n’est pas une solution à long terme. Mettons plutôt en place des solutions à long terme. Sinon, vous avez des gens traumatisés et dépendants. » Une autre femme a fait remarquer : « Ce sont les conseillers bon marché. Une détenue médicamentée est plus facile à gérer. »
En réponse à cette lacune, les psychologues de certains établissements pour femmes ont pris l’initiative d’offrir des séances de counseling de groupe adaptées axées sur les traumatismes. Bien que ces efforts reflètent les pratiques exemplaires, ils ne sont pas officiellement soutenus ou financés et dépendent entièrement d’initiatives individuelles.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, d’autres membres du personnel, comme les Aînés, les intervenants comportementaux, les agents de libération conditionnelle et les intervenants de première ligne, sont souvent laissés à soutenir les femmes qui surmontent un traumatisme. Malgré leur désir sincère d’aider, ils manquent souvent de formation, d’outils et d’expertise clinique pour le faire de manière sécuritaire et efficace. Cela augmente non seulement le risque de préjudice pour les femmes en détention, mais expose également le personnel à un risque élevé de subir un traumatisme indirect.
Il est essentiel que les interventions propres aux traumatismes soient réalisées par des professionnels correctement formés et qualifiés. Le récent changement de titre de conseiller comportemental à intervenant comportemental reflète la reconnaissance du fait que ce personnel n’est pas un professionnel de la santé mentale autorisé et ne devrait pas fournir de counseling. Néanmoins, pratiquement tous les intervenants comportementaux interrogés par mon Bureau ont indiqué que l’on comptait sur eux pour le soutien et le counseling relatifs aux traumatismes, en particulier pour les femmes qui participent à la thérapie comportementale dialectique (TCD), un programme dans lequel les expériences traumatisantes sont fréquemment explorées.
Nécessité d’interventions adaptées aux traumatismes et à la culture
Les femmes autochtones font face à des défis uniques et complexes relatifs aux traumatismes, découlant de l’intersection des traumatismes historiques et intergénérationnels, de l’oppression systémique et de la violence fondée sur le genre. Leurs besoins sont complexes et profondément ancrés dans les expériences vécues de colonisation, de déplacement et de marginalisation. Un traitement efficace de la guérison et des traumatismes pour les femmes autochtones nécessite des approches culturellement ancrées qui respectent les pratiques traditionnelles et reflètent les visions du monde autochtones. Un membre du personnel du SCC a résumé la question comme suit : « Ce que certaines personnes ne comprennent pas, c’est qu’on ne peut pas séparer la santé mentale de la race et de la culture – les deux vont de pair. Si vous essayez de le voir à travers un type d’objectif, vous ne comprendrez pas. Et une autre chose que l’on oublie souvent, c’est le traumatisme générationnel, en plus de ce que les femmes vivent dans leur vie (…) Nous essayons de le détecter à l’admission avec le formulaire de santé mentale, mais cela va bien au-delà. »
Malheureusement, les entrevues menées par mon Bureau ont révélé un manque généralisé de compréhension parmi le personnel du SCC de l’histoire, de la culture et du traumatisme des femmes autochtones et de la façon dont ces expériences peuvent se manifester en milieu correctionnel. De plus, il y avait peu de données probantes d’efforts soutenus pour promouvoir, soutenir ou faciliter les rôles des Aînés et du personnel autochtone dans la prestation d’un soutien adapté à la culture. Les obstacles à la tenue périodique de cérémonies traditionnelles et d’activités culturelles nuisent davantage aux efforts visant à favoriser un environnement de guérison, tenant compte des traumatismes et adapté à la culture.
Conclusion
Il existe un besoin critique et non satisfait pour les femmes incarcérées de traiter et de guérir de leur traumatisme. Sans ce travail fondamental, leur capacité à participer de manière importante à d’autres programmes correctionnels est gravement compromise. Les traumatismes non traités peuvent aggraver les résultats en matière de santé physique et mentale et nuire considérablement à la réussite de la réinsertion sociale. Comme l’a bien décrit un psychologue du SCC : « C’est comme si elles essayaient de réorganiser les meubles dans leur tête, alors que leur maison brûle. »
Le SCC a la possibilité et la responsabilité de mettre en œuvre des pratiques de dépistage et d’évaluation des traumatismes qui éclairent une planification correctionnelle plus complète, individualisée et efficace dans un environnement qui tient vraiment compte des traumatismes.
-
Je recommande que le SCC travaille en étroite collaboration avec un organisme
externe spécialisé en santé mentale pour élaborer une stratégie complète
fondée sur des données probantes pour des services tenant compte des
traumatismes et des traitements propres aux traumatismes pour les femmes
purgeant une peine de ressort fédéral. Cette stratégie devrait comprendre
les éléments suivants :
- le dépistage normalisé des traumatismes, de la victimisation et des expériences négatives de l’enfance;
- la mise en œuvre de pratiques tenant compte des traumatismes dans l’ensemble des politiques et procédures du SCC, appuyées par une formation spécialisée du personnel;
- l’accès à une thérapie et à des conseils pour le traitement du traumatisme à la fois adaptés au genre et à la culture;
- des environnements sûrs et favorables afin que les femmes commencent le processus de guérison.
La nouvelle stratégie devrait être entièrement mise en œuvre d’ici juin 2026 Le nouveau modèle devrait ensuite être évalué par le SCC, et une approche semblable devrait être étendue aux établissements pour hommes à l’échelle nationale.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE EN PARTIE
Reconnaissant l’incidence des traumatismes chez les détenus, le SCC a mis en place un modèle de soins de santé primaires intégrés conforme au modèle de centre de médecine de famille élaboré par le Collège des médecins de famille du Canada. Ce modèle est fondé sur une approche globale et centrée sur la personne qui consiste en une prestation de soins fondée sur le travail d’équipe et tenant compte des traumatismes à l’intérieur des paramètres d’un cadre d’amélioration de la qualité. Ce modèle met l’accent sur la collaboration, la participation des détenus et une approche claire et structurée pour la prestation de soins intégrés de santé physique et mentale qui répondent aux besoins uniques des personnes incarcérées.
La prestation de soins tenant compte des traumatismes repose sur la compréhension et la prise en compte de l’incidence des traumatismes. Compte tenu de la prévalence des traumatismes subis et de l’incidence de ces traumatismes sur la santé mentale et les risques criminogènes des détenus, l’adoption d’une approche tenant compte des traumatismes pour répondre aux besoins en santé mentale des personnes peut favoriser une meilleure relation thérapeutique et l’obtention de meilleurs résultats de traitement. La nécessite d’obtenir du counseling en cas de traumatisme est évaluée au cas par cas et le counseling est fourni par des professionnels en santé mentale formés. De plus, la thérapie comportementale dialectique et le traitement modulaire intégré sont des interventions thérapeutiques complètes qui supposent l’apprentissage et l’élaboration de stratégies pour favoriser la maîtrise des émotions, et ces interventions peuvent offrir un traitement efficace aux détenus ayant des antécédents de traumatismes.
Le SCC a fourni à ses professionnels de la santé de la formation sur les approches tenant compte des traumatismes comportant un volet théorique et un volet pratique en milieu correctionnel. En 2022 à 2023, le SCC a aussi fourni de la formation sur les traumatismes des délinquants à tous les agents de libération conditionnelle.
Le SCC a mobilisé et financé ses partenaires communautaires qui offrent des services axés sur les traumatismes et du counseling en dynamique de la vie à l’appui de la santé mentale et du bien-être des femmes. Le SCC continuera de chercher à conclure d’importants partenariats internes et externes à l’appui de la prestation d’interventions tenant compte des traumatismes.
Une plus grande proportion d’Autochtones sous garde fait état d’antécédents de traumatismes complexes, ce qui est d’abord et avant tout attribuable aux effets des traumatismes intergénérationnels qu’ils ont subis. Dans le cadre de la prestation de services de santé, des efforts sont consentis pour tenir compte des antécédents sociaux des Autochtones pertinents et adopter une approche holistique comprenant la participation d’Aînés, de conseillers spirituals, d’assistants d’Aînés et d’aumôniers.
En 2025, le SCC a actualisé le matériel de la Formation axée sur les femmes, qui présente des approches tenant compte des traumatismes. Le public cible a été élargi pour inclure tous les employés travaillant dans un établissement pour femmes, ce qui contribuera à favoriser des environnements de travail sûrs et positifs.
Prochaine étape : Le SCC continuera de peaufiner le plan d’établissement de partenariats pour accroître la mobilisation des services de santé dans la collectivité.
Échéancier : En cours
Besoins et services en matière de santé mentale pour les peuples autochtones dans les services correctionnels fédéraux
« Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit. »
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA)
Les disparités en matière de santé mentale et d’accès à des soins de qualité pour les peuples autochtones au Canada sont bien documentées. Ces disparités sont fermement enracinées dans le long héritage du colonialisme, des traumatismes intergénérationnels et des obstacles aux services pour la population autochtone en général. En 2024, Statistique Canada a signalé que parmi les Autochtones ayant besoin de soins de santé mentale, environ les trois quarts ont indiqué que leurs besoins n’étaient pas satisfaits116. De plus, environ un Autochtone sur cinq a indiqué avoir subi un traitement injuste, du racisme ou de la discrimination de la part d’un professionnel de la santé. De nombreux facteurs, comme les principaux déterminants sociaux de la santé mentale et physique, y compris la pauvreté, le chômage, l’insécurité alimentaire et du logement, sont plus élevés chez les peuples et les communautés autochtones. Les répercussions de ces facteurs sur la santé mentale sont exacerbées par les effets uniques des traumatismes intergénérationnels (par exemple, le système des pensionnats, la Rafle des années soixante, les politiques de protection de l’enfance), la discrimination et l’exclusion sociale. Par conséquent, dans de nombreux cas, ces facteurs sociohistoriques se matérialisent chez les individus par des taux plus élevés de problèmes de santé mentale importants, y compris les symptômes et les troubles dépressifs, les tendances suicidaires et l’automutilation, les troubles de stress post-traumatique et les troubles concomitants relatifs à la santé mentale et à l’abus de substances.
En raison de la criminalisation des personnes ayant des problèmes de santé mentale et de la surreprésentation des Autochtones dans l’ensemble des prisonniers (qui représentent environ le tiers de toutes les personnes sous responsabilité fédérale), le système carcéral est maintenant plus que jamais rempli d’Autochtones ayant des besoins de santé complexes. En fait, de nombreuses études ont examiné précisément la prévalence des besoins en matière de santé mentale des Autochtones purgeant des peines de ressort fédéral, constatant que les hommes et les femmes autochtones ont constamment des taux plus élevés de problèmes de santé mentale que leurs homologues non autochtones117 Par exemple, des études employant des entrevues cliniques auprès de personnes à l’admission ont révélé que 94 % des hommes et 97 % des femmes autochtones ont indiqué avoir eu un problème de santé mentale au moins une fois dans leur vie118. Pour les femmes autochtones en particulier, la recherche a révélé que jusqu’à 100 % des femmes autochtones dans les échantillons de l’étude répondaient aux critères d’un diagnostic à vie d’un trouble mental et plus de 96 % répondaient aux critères d’un trouble mental actuel. Les diagnostics les plus courants chez les femmes autochtones étaient les troubles antisociaux et les troubles de la personnalité limite, et parmi les plus fréquemment diagnostiqués se trouvait le TSPT, touchant près du tiers des femmes répondant aux critères de ce groupe de troubles119. Dans le même ordre d’idées, l’incidence élevée des comportements d’automutilation chez les hommes et les femmes autochtones est inextricablement liée aux taux élevés de problèmes de santé mentale au sein de cette population. Plus précisément, plus de la moitié des incidents d’automutilation dans les services correctionnels fédéraux au cours des dernières années ont impliqué une personne autochtone120.
Dans l’ensemble, ces constatations de recherche ont été corroborées par les points de vue et les expériences partagés par les personnes à qui nous avons parlé au cours de cette enquête. Beaucoup ont exprimé des préoccupations non seulement quant au nombre d’Autochtones vivant avec des besoins importants en matière de santé mentale dans le système carcéral, mais ont également décrit les diverses difficultés à répondre à leurs besoins. Certaines personnes ont mentionné un changement notable dans la gravité des problèmes de santé mentale au cours des dernières années, y compris des problèmes comme la complexité des troubles de santé mentale concomitants, les symptômes et les troubles de santé mentale induits par les drogues, y compris les lésions cérébrales et les complications neurologiques causées par une consommation prolongée de drogues, ainsi que les traumatismes émotionnels multidimensionnels et de longue date.
Enquête en cours
Dans le cadre du présent rapport annuel axé sur la santé mentale dans les services correctionnels, le Bureau a entrepris un examen des besoins en matière de santé mentale, des approches actuelles en matière de services offerts, ainsi que des lacunes et des obstacles à la prise en charge de la santé mentale des détenus autochtones. Au cours de cet examen, nous avons consulté la littérature et parlé à douze personnes, dont des Aînés, du personnel de la santé mentale et des praticiens, entre autres, qui travaillent de différents points de vue dans les services correctionnels fédéraux, y compris dans les pavillons de ressourcement fédéraux et les organismes communautaires autochtones. Nous avons également examiné de multiples entrevues menées dans le cadre d’autres enquêtes systémiques incluses dans le présent rapport où des enjeux relatifs à la prestation de services de santé mentale par le SCC aux Autochtones incarcérés ont été soulevés. Ensemble, ils ont tous partagé avec nous certains des principaux défis auxquels se heurtent les Autochtones purgeant une peine de ressort fédéral et ceux qui travaillent dans le système pour accéder à des services et des soins efficaces et le leur fournir. À la suite de cet examen, les thèmes suivants ont été déterminés :
- La discrimination et les préjugés inconscients dans les soins de santé mentale créent des défis uniques pour les prisonniers autochtones.
- La disponibilité et l’accès à des services de santé mentale adaptés à la culture et aux traumatismes pour les peuples autochtones sont insuffisants.
- La continuité des soins de santé mentale pour les peuples autochtones à leur libération dans la collectivité est faible.
- La décolonisation des soins de santé mentale dans le système carcéral est nécessaire pour assurer l’équité pour les peuples autochtones purgeant une peine de ressort fédéral.
Constatations
La discrimination et les préjugés inconscients dans les soins de santé mentale créent des défis uniques pour les prisonniers autochtones
La discrimination et les préjugés contre les Autochtones existent dans la société en général et dans le système de soins de santé, et par conséquent, dans le système correctionnel. De nombreuses études ont révélé que les personnes victimes de racisme ont de moins bons résultats en matière de santé mentale et physique121. Comme de nombreux rapports, commissions et enquêtes l’ont démontré et documenté, la discrimination systémique se produit à tous les stades du système de justice pénale, y compris dans les services correctionnels122. Par exemple, il est bien connu que les peuples autochtones sont plus souvent ciblés par la police, ont plus de contacts avec les tribunaux, sont souvent estimés comme des victimes moins dignes par la police, voient plus souvent leur crédibilité remise en question et leurs demandes d’aide ignorées. Comme le Bureau l’a déjà signalé, la discrimination dans les établissements correctionnels fédéraux peut prendre de nombreuses formes et se matérialise par la surreprésentation des hommes et des femmes autochtones, dans les milieux de détention en général, les milieux à sécurité maximale, les placements dans les unités d’intervention structurée (UIS) et les incidents de recours à la force, pour n’en nommer que quelques-uns. On peut le voir dans le fait que les peuples autochtones sont évalués en grande majorité comme étant plus à risque et à plus haute sécurité que leurs homologues non autochtones, qu’ils purgent une plus longue partie de leur peine et qu’ils ont des taux plus élevés de révocation et de récidive, entre autres indicateurs et résultats. Les Autochtones ont moins accès aux services, aux programmes et aux sources de soutien pour leurs besoins en matière de santé mentale et purgent leur peine dans des conditions qui sont non seulement incompatibles avec le bien-être et la guérison, mais qui peuvent également exacerber les symptômes et les maladies (par exemple, isolement, environnements instables).
La discrimination et les préjugés, en ce qui concerne les soins de santé mentale pour les détenus autochtones, se manifestent de diverses façons et peuvent être observés aux niveaux micro et macro des soins de santé mentale en milieu carcéral. On peut le voir dans la façon dont les besoins en matière de santé mentale sont examinés et évalués à l’admission, dans les interactions quotidiennes avec le personnel, dans les décisions cliniques rendues par les fournisseurs de soins de santé, dans la façon dont les soins de santé mentale sont définis, légiférés, régis et mis en œuvre à l’échelle des systèmes. Lors de notre examen de la littérature et de nos conversations avec des personnes travaillant dans le système correctionnel, nous avons observé que la discrimination et les préjugés (conscients et inconscients) constituent un obstacle important aux soins appropriés et humains aux patients et ont des répercussions majeures sur la santé des patients autochtones. Reconnaissant qu’il existe des préjugés dans le système de soins de santé général, les sources de discrimination sont profondes, structurelles et intersectionnelles entre la race et le statut de « détenu » des patients dans le système carcéral. Bien qu’il soit important de noter que de nombreux fournisseurs de soins de santé mentale au sein du système correctionnel fédéral travaillent sans relâche, de manière créative et collaborative pour fournir des soins de qualité aux patients autochtones, il est également dévastateur qu’il existe encore de nombreuses sources puissantes de discrimination et de préjugés qui ont des répercussions négatives sur les prisonniers autochtones et leur bien-être. Il s’agit d’une source de frustration pour les patients et les fournisseurs de soins de santé. Voici des exemples de ces formes et sources de discrimination ou de préjugés dans le système carcéral :
Stéréotypes et stigmatisation
Les stéréotypes et la stigmatisation associés aux peuples autochtones créent un environnement peu accueillant et parfois hostile pour les prisonniers autochtones, ce qui les rend moins susceptibles de demander des soins de santé mentale. Les stéréotypes peuvent comprendre des préjugés perpétués plus largement dans la société, qui sont partagés par les fournisseurs de soins de santé, ce qui a une incidence sur la façon dont ils interagissent avec les patients autochtones. Nous avons entendu dire que les stéréotypes et la stigmatisation peuvent comprendre l’expression de fausses croyances selon lesquelles les peuples autochtones ne savent pas comment prendre soin de leur propre santé, prennent de mauvaises décisions en matière de mode de vie ou utilisent la détresse émotionnelle et les traumatismes comme ruse pour obtenir des drogues et des médicaments. Comme nous l’a indiqué un Aîné : « Pour que les Autochtones aient accès à des services d’aide mentale ou en fassent la demande, ils doivent avoir confiance qu’ils seront traités de la même manière, comme tout le monde, et qu’ils ne seront pas perçus comme cherchant des médicaments pour se défoncer. » Ces formes de préjugés, parmi tant d’autres, ont des répercussions négatives importantes sur la prise de décisions cliniques et, de plus, découragent les peuples autochtones à chercher du soutien, par crainte légitime d’être jugés, humiliés, maltraités ou refusés. Par conséquent, cela sert à exacerber les problèmes de santé mentale existants des personnes et à renforcer le manque de confiance envers les fournisseurs de soins de santé. Étant donné que la santé mentale est étroitement liée aux expériences de racisme, d’exclusion et d’isolement, ces obstacles contribuent également à l’apparition de nouveaux problèmes de santé mentale ou de sources de détresse ou de maladie.
Recours excessif à l’égard d’approches occidentales en matière de soins de santé mentale
Les approches organisationnelles en matière de soins de santé mentale ont été trop rigides et trop dépendantes des approches occidentales en matière de diagnostic, de traitement et de modèle médical en santé mentale. Ces modèles ignorent souvent les approches dirigées par les Autochtones et conceptualisées à l’aide d’une compréhension plus holistique de la santé mentale et du bien-être. Dans certains cas où les approches occidentales ont été adaptées pour inclure des composantes ou des caractéristiques autochtones, il s’agit souvent d’ajouts ou de modifications aux approches existantes, ajoutant simplement un vernis culturellement informé. Nous avons également entendu dire qu’une mauvaise compréhension des conceptualisations holistiques du traitement et des programmes de santé mentale a entraîné, par exemple, la perte de financement des programmes autochtones qui servent à soutenir la santé mentale et le bien-être en dehors des approches traditionnelles. Un membre du personnel a décrit la situation suivante : « En tant qu’Autochtones, nous ne regardons pas seulement le mental, nous regardons les aspects émotionnels, spirituels et physiques… donc, lorsque les Aînés travaillent avec eux, ils peuvent s’occuper de ces éléments. Nous organisons des cérémonies du calumet, des bains spirituels et nous essayons d’impliquer les femmes à l’égard de leur culture. … Nous avons construit un canot de mer traditionnel… Ce que nous avons vu avec la guérison terrestre – il y a beaucoup de changements et de guérison qui se produisent. C’est une retraite de quatre jours. Après les enseignements, les personnes montaient en canot. Ensuite, elles allaient dans une hutte de sudation et un cercle de partage, puis un festin et un cercle de fermeture. Malheureusement, lorsque les coupures sont arrivées, il s’agissait de l’une des premières à être supprimée. Pourquoi couperiez-vous d’abord les programmes autochtones compte tenu de leur surreprésentation? Si vous essayez de réduire le nombre d’Autochtones à l’intérieur, couper dans les services culturels n’aidera pas. J’ai l’impression que nous mendions de l’argent pour nos œuvres culturelles et spirituelles. »
Préjugés dans le dépistage et les évaluations
Comme le Bureau l’a déjà signalé, les évaluations et les outils qui permettent de dépister les besoins individuels, y compris la santé mentale, ne tiennent pas correctement compte des déterminants sociaux de la santé et des causes profondes des problèmes de santé mentale chez les peuples autochtones. Ces outils renforcent souvent les stéréotypes, blâmant les individus pour les conséquences des forces coloniales d’oppression qui ont créé le contexte dans lequel les soins de santé mentale et le bien-être sont touchés de manière négative. Les préjugés inhérents à ces outils entraînent une mauvaise détermination des besoins et l’exclusion de besoins plus pertinents, ce qui entraîne un diagnostic inadéquat et des soins de qualité inférieure. Bien que le SCC recueille et consigne des renseignements sur les facteurs relatifs aux antécédents sociaux des Autochtones (ASA) et sur la santé mentale, aucune de ces sources d’information ne semble être utilisée dans la pratique uniforme pour éclairer la prise de décisions concernant la gestion de cas et les soins d’une personne. Nous avons entendu le fait de consigner des renseignements sur les antécédents sociaux des Autochtones comme un exercice de « copier-coller », où les renseignements sont consignés, mais non utilisés. Un récent rapport produit par le Service note ce qui suit concernant les renseignements sur l’ASA et la santé mentale : « … des facteurs ont été fréquemment mentionnés, mais non relatifs à la décision ou à la recommandation, y compris la santé mentale, les antécédents familiaux et communautaires de suicide123 […] ». Le personnel n’a pas la formation adéquate pour comprendre comment utiliser les renseignements sur les antécédents sociaux des Autochtones dans la pratique pour éclairer la prise de décisions et l’action. Les déterminants sociaux de la santé, y compris les facteurs relatifs aux antécédents sociaux des Autochtones, constituent de puissantes sources d’information sur les causes sous-jacentes des symptômes mesurés par les outils d’évaluation. Se concentrer uniquement sur l’évaluation et le traitement des symptômes et ignorer les causes profondes sert non seulement à perpétuer la discrimination des peuples autochtones, mais il en résulte des soins inappropriés et inefficaces.
Le manque de représentation autochtone au sein du personnel de la santé se traduit par une faible compétence culturelle du système
Comme le Bureau l’a déjà signalé, le manque de représentation autochtone parmi le personnel de la santé et les fournisseurs de services au sein du système carcéral entraîne un faible niveau de compétence culturelle et de sensibilisation chez les personnes qui interagissent quotidiennement avec les détenus autochtones. De plus, la formation du personnel sur la « sensibilisation » culturelle a été décrite comme inadéquate, faisant peu pour accroître une compréhension souvent superficielle de l’histoire, de la culture et des modes de connaissance autochtones par le personnel. Le manque de représentation autochtone parmi les fournisseurs de soins de santé mentale et de bien-être, y compris la disponibilité insuffisante des Aînés, fait en sorte que peu de personnes ont l’expérience vécue et la connaissance des besoins des peuples autochtones. Une représentation et des titres de compétences culturels inadéquats au sein du personnel entraînent une mauvaise compréhension des besoins des peuples autochtones et des moyens les plus efficaces et les plus pertinents de soutenir le bien-être holistique. Cela impose un fardeau écrasant aux patients autochtones d’éduquer le personnel, de passer outre leur manque de connaissances ou d’éviter complètement les interactions avec le personnel de la santé. Une personne que nous avons interviewée a décrit les conséquences comme suit : « Le manque de connaissances [chez le personnel] perpétue le traumatisme subi par la population autochtone. »
La disponibilité et l’accès à des services de santé mentale adaptés à la culture et aux traumatismes pour les peuples autochtones sont insuffisants
Comme l’ont montré les diverses enquêtes menées dans le présent rapport, il est clair que bon nombre des lacunes et des défis du système de santé canadien en général se reflètent dans le système carcéral. Parmi ces lacunes, mentionnons les services, les soutiens, les praticiens et les pratiques adaptés aux traumatismes et à la culture. Comme nous l’avons décrit, les Autochtones entrent dans le système correctionnel avec des besoins en matière de santé mentale disproportionnés, entre autres déterminants sociaux de la santé. Cela nécessite des soins spécialisés fondés sur la connaissance, le contexte et la conscience des traumatismes sociohistoriques vécus par les individus et les groupes, ainsi que sur les réalités culturelles qui ont des répercussions sur la façon dont la santé mentale et le bien-être peuvent être conceptualisés, incarnés et traités de manière différente. Conformément à un manque plus large de services de traumatologie, il y a peu de praticiens autochtones (par exemple, psychologues, psychiatres, infirmières et infirmiers, travailleurs sociaux, Aînés, aidants spirituels, fournisseurs de programmes) disponibles pour les Autochtones purgeant une peine de ressort fédéral. De plus, les divers obstacles auxquels se heurtent les peuples autochtones pendant qu’ils sont derrière les barreaux rendent très difficile l’accès aux quelques options de soins tenant compte des traumatismes et de la culture. Par exemple, comme l’a signalé l’enquête de notre Bureau, Dix ans depuis Une question de spiritualité : Une feuille de route pour la réforme du système correctionnel canadien pour Autochtones, l’accès aux pavillons de ressourcement, qui ont été créés pour être des centres de traumatologie et culturellement informés où les services correctionnels pourraient être administrés par et pour les peuples autochtones, n’est accessible qu’à une petite fraction (environ 6 %) de la population autochtone, et en grande partie seulement à ceux qui approchent de la fin de leur peine. L’accès à des Aînés et à des fournisseurs de services qui ont l’expérience vécue et les connaissances nécessaires pour comprendre et traiter les besoins des personnes est rare.
En plus du manque de disponibilité, un autre obstacle important est les critères d’accès aux services. Comme l’a indiqué un membre du personnel : « Une partie du problème est le manque de counseling tenant compte des traumatismes. Vous devez répondre à des critères élevés pour obtenir des conseils psychologiques. Le counseling de groupe n’est pas idéal pour les traumatismes. ». Le manque et l’inaccessibilité de services de santé mentale efficaces pour les prisonniers autochtones signifient souvent que les problèmes existants ne sont pas diagnostiqués, traités et, dans de nombreux cas, s’aggravent et prolifèrent en raison de l’expérience traumatisante de l’incarcération. Cela signifie que bon nombre de ces personnes atteindront la fin de leur peine ou seront libérées sans les outils, les ressources et le soutien nécessaires pour réussir leur transition vers un milieu communautaire.
La continuité des soins de santé mentale pour les peuples autochtones à leur libération dans la collectivité est faible
Comme cela a été décrit précédemment dans le présent rapport dans le cadre de l’enquête portant sur la planification clinique de la continuité des soins dans la collectivité, le manque de services de santé mentale dans le système carcéral est une lacune qui persiste lorsque les personnes sont libérées dans la collectivité. Les défis découlant de cette discontinuité sont exacerbés pour les personnes autochtones De nombreux Autochtones se heurtent à la difficulté de composer avec les pressions de la réinsertion sociale, de répondre aux exigences de surveillance communautaire et, dans de nombreux cas, de lutter contre les problèmes de santé mentale. Une petite proportion de personnes autochtones ayant des besoins en matière de santé mentale sont libérées dans la collectivité avec une planification clinique de la continuité des soins, ce qui signifie que peu d’entre elles reçoivent un plan de libération qui tient compte adéquatement de la façon dont les besoins en matière de santé mentale peuvent amplifier les défis relatifs au respect des conditions de libération, à l’obtention d’un logement et d’un emploi, et à la satisfaction de leurs besoins quotidiens de base.
Pour les Autochtones en particulier, il y a très peu d’options pour les établissements résidentiels communautaires autochtones spécialisés (c.-à-d. les maisons de transition) qui offrent un environnement plus propice à la culture, et encore moins qui acceptent les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Cela crée des difficultés non seulement pour les Autochtones qui cherchent un meilleur environnement après leur libération, mais exerce également des pressions sur les CRC autochtones existants pour qu’ils acceptent une plus grande variété et complexité de résidents. Comme l’a expliqué un membre du personnel autochtone d’un établissement résidentiel communautaire (ERC) : « Nous prenons parfois des gens qui ne sont pas acceptés ailleurs, à haut risque, ayant des besoins élevés. Mais je trouve que « ce qu’ils sont sur papier » n’est pas ce qu’ils sont ici. Quand ils arrivent ici, c’est plus comme une vie familiale et leurs défenses s’effondrent et leurs comportements s’améliorent. » Un membre du personnel du SCC qui travaille dans la collectivité à qui nous avons parlé a décrit les défis uniques auxquels font face les femmes autochtones à leur libération, en particulier celles qui sont libérées en milieu urbain loin de leur collectivité d’origine : « Il y a beaucoup de troubles de la personnalité limite, de TDAH, beaucoup de dépression. Chez les femmes, il y a beaucoup plus d’automutilation, parfois assez importante. De plus en plus de femmes ayant des idées suicidaires et beaucoup de ces femmes sont en même temps des soignantes. Beaucoup de femmes autochtones ayant des problèmes de santé mentale qui sont loin de leur soutien. » Les personnes que nous avons interviewées ont également souligné le besoin croissant de services de désintoxication spécialisés pour les peuples autochtones qui se rendent dans la collectivité comme un défi majeur pour la réinsertion sociale, où il n’y a tout simplement pas assez de services coordonnés pour soutenir ces personnes et leurs besoins en matière de santé.
Bien que la loi prévoie un mécanisme de planification clinique de la continuité des soins qui se fait en collaboration avec les collectivités ou les organisations autochtones pour mieux répondre aux besoins de réinsertion sociale des peuples autochtones (c.-à-d. les libérations en vertu de l’article 84), en réalité, très peu de mises en liberté en vertu de l’article 84 sont faites124. Une personne à qui nous avons parlé, qui a reçu un plan de libération en vertu de l’article 84, s’est dite préoccupée par celles qui n’ont pas pu bénéficier de cette option : « Ces autres personnes [elle fait une pause], je me sens mal. Elles n’ont pas ce genre de mesure de soutien. Elles n’ont personne auprès de qui faire un suivi, elles n’ont pas d’ordonnance du tribunal pour prendre leurs médicaments ou consulter un psychiatre. Les lacunes dans la planification des libérations, le manque de disponibilité des services autochtones dans la collectivité et l’utilisation inadéquate des mécanismes offerts au Service par la loi (par exemple, les pavillons de ressourcement et les libérations en vertu de l’article 84) contribuent tous à l’insuffisance des soins de santé mentale pour les peuples autochtones qui ont besoin de ces soutiens pour réussir leur retour dans la collectivité.
La décolonisation des soins de santé mentale dans le système carcéral est nécessaire afin d’assurer l’équité pour les peuples autochtones purgeant une peine de ressort fédéral
En 2015, la Commission de vérité et réconciliation (CVR) a déterminé des lacunes fondamentales et structurelles dans le système de santé canadien, y compris les soins de santé mentale pour les personnes purgeant une peine de ressort fédéral, comme des domaines nécessitant des changements importants pour faire progresser la réconciliation. Bon nombre de ces lacunes, sinon toutes, en ce qui concerne le système carcéral fédéral, subsistent aujourd’hui. À la suite des constatations de la CVR, la commission a mis de l’avant des appels à l’action pour améliorer la prestation des soins de santé aux peuples autochtones, notamment les suivantes :
- combler l’écart dans les résultats en matière de santé des peuples autochtones;
- soutenir les pratiques de guérison traditionnelles;
- augmenter le nombre d’Autochtones dans les professions de la santé;
- intégrer la sécurité culturelle dans les systèmes de santé;
- améliorer le soutien aux patients autochtones.
L’année suivante, en 2016, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) a été entièrement ratifiée par le Canada. La Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Loi sur la Déclaration des Nations Unies) a ensuite été présentée au Parlement et a reçu la sanction royale en 2021. La Loi sur la Déclaration des Nations Unies exige que le gouvernement consulte et coopère avec les peuples autochtones pour s’assurer que les lois fédérales sont conformes à la DNUDPA. L’un des engagements du gouvernement du Canada semble être d’assurer une participation importante des peuples autochtones aux décisions qui les concernent, eux et leurs communautés. Il est raisonnable de supposer que cela comprend la participation active au développement d’institutions sociales comme la santé et la justice, les médecines traditionnelles et les pratiques de soins de santé, ainsi que l’accès à une santé mentale125 de la plus haute qualité. Plus récemment, le 11 mars 2025, le gouvernement fédéral a publié sa très attendue Stratégie en matière de justice autochtone. Parmi les nombreux autres domaines notables déterminés, la santé mentale des peuples autochtones dans le système de justice pénale est incluse comme un domaine prioritaire nécessitant une action (par exemple, la mesure de suivi no 17 et les sections 2.1 et 2.6 sur le bien-être des Inuits), tout comme c’était le cas lorsqu’elle était une décennie plus tôt dans les appels à l’action de la CVR.
Comme le Bureau l’a déjà signalé, les problèmes sont bien connus et documentés et les plans d’action ont été élaborés. Comme l’indique le rapport de la CVR, entre autres rapports, la DNUDPA et maintenant le rapport sur la Stratégie en matière de justice autochtone, les services correctionnels ont beaucoup de travail à faire pour répondre aux besoins en matière de soins de santé des peuples autochtones dont ils ont la charge. Et bien que les services correctionnels fédéraux aient élaboré leur propre ensemble de plans, dont le plus récent est un plan d’action pour le mieux-être des Autochtones, il est clair que des changements pratiques et fondamentaux considérables sont encore nécessaires pour résoudre les problèmes au sein du système de soins de santé mentale correctionnel. Le système carcéral représente une forme d’établissement intrinsèquement colonial. Compte tenu de cette réalité, l’injection de nouveaux programmes et services ne peut pas aller jusqu’à un certain point pour changer les normes, la culture et l’éthique qui sous-tendent les politiques et les pratiques actuelles. Pour changer la façon dont le système carcéral reconnaît et répond aux besoins des personnes autochtones sous leur garde et leurs soins, il faut redoubler d’efforts pour une décolonisation systémique du système de soins de santé carcéral, de haut en bas. Le SCC est mal outillé pour répondre aux nombreuses préoccupations soulevées dans cette enquête, et davantage de ressources pour améliorer la capacité du SCC à mieux répondre aux besoins des peuples autochtones en matière de santé mentale et de bien- être continueront d’échouer ou n’auront que des résultats positifs marginalisés. Il est clair que la façon la plus efficace pour le SCC d’aller de l’avant est de réaffecter une partie importante de son budget au financement de nouveaux pavillons de ressourcement gérés par la collectivité, d’appuyer un plus grand nombre de libérations en vertu de l’article 84 et d’investir dans les collectivités et les organisations autochtones pour offrir des services de santé mentale et de bien-être holistiques et adaptés à la culture. Cette réaffectation équitable appuiera les nombreux engagements du SCC et du gouvernement du Canada à assurer la mise en œuvre de la réconciliation, de l’autonomie gouvernementale et de l’autodétermination des peuples autochtones.
- Je recommande que le SCC réaffecte une partie importante de ses ressources au financement de pavillons de ressourcement supplémentaires en vertu de l’article 81 et augmente le financement des pavillons de ressourcement existants en vertu de l’article 81 au cours de l’exercice financier 2025-2026, afin de leur permettre d’offrir des services de santé mentale et de bien-être authentiques, holistiques et dirigés par des Autochtones, qui répondent mieux aux besoins des personnes autochtones ayant des problèmes de santé mentale d’une manière qui tient compte de la culture et des traumatismes, et exempte de discrimination et de préjugés inconscients.
Réponse du SCC : ACCEPTÉE EN PRINCIPE
Le SCC finance les pavillons de ressourcement visés par l’article 81 dans le cadre d’un processus de négociation axé sur les besoins propres aux différentes collectivités. Bien que les fonds soient attribués en fonction de la demande et de l’utilisation, des ressources additionnelles peuvent être allouées au besoin à l’appui de priorités précises.
Afin d’améliorer l’efficacité et le caractère durable des ententes conclues en vertu de l’article 81, le SCC prend des mesures concrètes pour accroître la souplesse du financement, soutenir les projets d’innovation dirigés par des Autochtones et assurer l’harmonisation avec les besoins des collectivités. Les prochaines étapes présentées ci-dessous visent à renforcer les partenariats, à favoriser des services adaptés à la culture et à moderniser les approches en matière de financement.
Prochaines étapes :
- Envisager des options pour accorder des fonds additionnels dans le cadre d’ententes existantes et de nouvelles ententes, et veiller à ce que des ressources internes soient prêtes à soutenir la mise en œuvre en cas de besoin.
- Encourager l’adoption d’approches novatrices qui font progresser la justice dirigée par les collectivités et renforcent l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones.
- Officialiser les possibilités d’attribution de fonds additionnels pour élargir les services et le soutien en santé et en santé mentale offerts par des Autochtones durant le renouvellement des ententes conclues en vertu de l’article 81.
- Veiller à ce que les demandes de fonds additionnels présentées par des partenaires signataires d’une entente en vertu de l’article 81 en vigueur soient examinées comma il se doit.
- Moderniser les modèles de financement offerts aux partenaires signataires d’une entente en vertu de l’article 81 pour veiller à la satisfaction des besoins opérationnels. (Achevé)
Échéancier : En cours, étant donné que tous les résultats attendus sont en cours d’obtention ou dépendent de l’intérêt manifesté par les partenaires signataires d’une entente en vertu de l’article 81 ou désireux de conclure une telle entente ainsi que des négociations menées avec ces derniers.
Perspectives de l’enquêteur correctionnel pour 2025-2026
Alors que mon mandat d’enquêteur correctionnel du Canada tire à sa fin en 2026, je me surprends à réfléchir avec fierté à neuf années de progrès et de transformation importants en tant qu’enquêteur correctionnel. Ce fut un grand honneur de diriger le Bureau à travers une période d’évolution importante, marquée par un engagement accru envers la rigueur, la responsabilisation et la surveillance fondée sur des principes.
Au cours des neuf dernières années, nous avons fondamentalement renforcé la façon dont le Bureau de l’enquêteur correctionnel mène son travail. Grâce à de nouveaux financements obtenus en 2018 et en 2023, nous avons pu accroître notre capacité et aussi affiner notre orientation. Ces investissements nous ont permis de rationaliser et d’améliorer notre fonction de règlement préventif, de stabiliser notre équipe chargée des enquêtes et de passer à des visites plus proactives, de type inspection, en harmonisant nos pratiques avec les normes internationales en matière de surveillance efficace des prisons.
Ces améliorations ont non seulement amélioré la qualité et la portée de nos enquêtes systémiques, mais nous ont également permis de nous harmoniser plus étroitement avec nos priorités organisationnelles. En mettant sur pied des équipes diversifiées et multidisciplinaires d’enquêteurs et d’analystes, nous avons favorisé une plus grande sécurité du personnel, approfondi l’expertise en la matière et veillé à ce que les répondants aux plaintes reflètent la diversité des populations que nous servons.
Grâce au dévouement inlassable de notre personnel, le Bureau a acquis et consolidé sa réputation, tant au pays qu’à l’étranger, en tant que modèle d’excellence en matière de surveillance correctionnelle. J’ai eu le privilège d’être président du Réseau d’experts sur la surveillance externe des prisons et les droits de la personne, sous la gouvernance de l’Association internationale des affaires correctionnelles et pénitentiaires (International Corrections and Prisons Association; ICPA), un forum mondial pour le partage des pratiques exemplaires et la promotion de la transparence dans les services correctionnels. J’ai été profondément honoré de recevoir le prix du chef de service 2023 de l’ICPA, une reconnaissance qui confirme les répercussions de notre travail et la force de notre engagement envers des services correctionnels humains et professionnels.
Pour l’avenir, le Bureau est exceptionnellement bien placé. Il est doté de ressources suffisantes, respecté à l’échelle internationale et également ancré dans une culture d’amélioration continue. Alors que nous nous préparons à une transition à la direction, l’organisation est prête à saisir de nouvelles occasions tout en restant inébranlable dans sa mission. L’année à venir sera à la fois réfléchie et tournée vers l’avenir, alors que nous reviendrons sur les recommandations antérieures qui ont été formulées par le Bureau au cours de la dernière décennie et identifierons des recommandations qui demeurent urgentes mais toujours pas mises en œuvre.
En terminant, ce fut le privilège de toute une vie que d’occuper ce rôle. Je laisse derrière moi un Bureau solide, fondé sur des principes et préparé pour l’avenir, un héritage fondé sur un solide rôle d’ombudsman et un engagement profond envers la justice sociale et les droits de la personne. Je suis convaincu que, sous sa nouvelle direction, le Bureau de l’enquêteur correctionnel continuera de prospérer et de diriger avec intégrité, compassion et détermination.
Le Prix Ed McIsaac pour la promotion des droits de la personne dans le système correctionnel
Le Prix Ed McIsaac pour la promotion des droits de la personne dans le système correctionnel a été créé en décembre 2008 en l’honneur de M. Ed McIsaac, directeur exécutif de longue date du Bureau de l’enquêteur correctionnel et ardent promoteur et défenseur des droits de la personne dans les services correctionnels fédéraux. Il commémore les réalisations et les engagements exceptionnels à l’égard de l’amélioration des services correctionnels au Canada et de la protection des droits de la personne des personnes incarcérées.
Le lauréat du Prix Ed McIsaac 2024 est Michel Gagnon. Pendant plus de 30 ans, M. Gagnon a été directeur exécutif de Maison Cross Roads à Montréal, au Québec, un organisme communautaire sans but lucratif qui offre des programmes et des services de réinsertion sociale et communautaire aux gens qui ont des démêlés avec la justice. M. Gagnon a consacré une grande partie de sa carrière à diriger des services de soutien pour répondre aux besoins croissants et uniques des personnes purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ainsi que de la population carcérale vieillissante. Il s’agit notamment de Service Oxygène au Québec et du programme LifeLine.
ANNEXE A : Résumé des recommandations
- Je recommande que les CRT du SCC soient redéfinis et officiellement reconnus comme des établissements de soins de santé mentale intermédiaires, avec une capacité limitée de gérer les cas psychiatriques d’urgence. Les personnes atteintes d’une maladie mentale grave, c’est-à-dire celles qui vivent des crises psychiatriques aiguës, des idées suicidaires persistantes ou des comportements d’automutilation chronique nécessitant des soins psychiatriques de longue durée, devraient être transférées dans des hôpitaux psychiatriques communautaires mieux adaptés à leurs besoins.
- Je recommande que le gouvernement du Canada/ministre de la Sécurité publique reconsidère son récent investissement de 1,3 milliard de dollars dans une installation de remplacement pour le CRT – Atlantique (Centre de rétablissement Shepody). Il faudrait plutôt réaffecter les efforts et le financement pour aider le SCC à réaffecter ses ressources actuelles pour faciliter le transfert des personnes atteintes de maladies mentales graves vers les hôpitaux psychiatriques provinciaux. Cela comprend le soutien à la création ou à l’expansion de lits dans les provinces faisant face à des contraintes en matière de capacité.
Je recommande qu’une fois que les CRT seront redéfinis en établissements de soins intermédiaires en santé mentale :
Le SCC travaille avec des professionnels de la santé mentale pour voir comment l’infrastructure actuelle du CRT pourrait être considérablement améliorée et devenir plus thérapeutique, y compris l’utilisation de peinture, de plantes, d’herbe dans les cours, de bancs, de tapis, d’affiches et de canapés où les problèmes de sécurité pourraient être atténués.
Le ministre de la Sécurité publique examine et évalue immédiatement les options de mise en liberté (par exemple, libération conditionnelle pour raisons médicales et/ou gériatriques) pour les patients âgés et purgeant une longue sentence qui ne posent pas de risque indu pour la sécurité publique, et propose des modifications législatives à la LSCMLC. Le SCC devrait investir activement dans les services correctionnels communautaires afin de créer des lits dans les établissements de soins de longue durée, de soins palliatifs, et les maisons de retraite, et ce, avec un objectif de 200 lits d’ici cinq ans.
Le SCC élabore une politique particulière à la gouvernance et au fonctionnement des CRT, en consultation avec des professionnels externes expérimentés en santé mentale dès sa création.
Le SCC examine la mise en œuvre du Modèle d’engagement et d’intervention en mettant l’accent sur son application auprès des personnes souffrant de troubles de santé mentale. Le SCC devrait également cesser d’utiliser des agents pulvérisateurs déclenchant une réaction inflammatoire comme première intervention en cas d’automutilation, en faveur d’interventions et de techniques axées sur les soins de santé, le désamorçage et les techniques thérapeutiques.
Le SCC élabore un modèle de gouvernance pour les CRT, semblable à celui des établissements psychiatriques médico-légaux communautaires externes, y compris une structure autonome de rapports et de gouvernance afin que toutes les questions relatives à la santé, des listes de dotation distinctes à la formation du personnel, en passant par le contrôle complet et sans entrave des budgets et des ressources, soient décidées par les cliniciens, et non par les directeurs d’établissement ou le personnel opérationnel.
Le SCC élabore de la formation, des processus d’intégration, des politiques, des procédures et des directives propres à la fonction et à l’objectif des CRT et au bien-être des patients.
Le SCC élabore un mandat et un énoncé de mission précis qui reflètent le but, les objectifs et la méthodologie autour desquels le personnel de toutes les disciplines peut unir collectivement ses efforts pour atteindre un objectif commun.
Le SCC élabore des pratiques pour s’assurer que le processus du CNE permette de trouver un juste équilibre entre l’enquête portant sur la conformité avec les enjeux relatifs aux questions de qualité, de nature et de fréquence des interventions offertes aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, y compris le traitement de ces rapports comme des outils d’apprentissage et de mobilisation des connaissances cohérents à l’échelle du service, afin de prévenir d’autres décès et blessures graves.
Le SCC désigne immédiatement, au minimum, un défenseur des droits des patients dans chaque CRT pour soutenir les soins centrés sur le patient et fournir une défense légitimement indépendante des patients dans leur navigation dans le système médical dans un contexte correctionnel.
Je recommande que le SCC, en étroite collaboration avec des organismes communautaires externes spécialisés dans les déficits cognitifs, mette en œuvre les mesures suivantes :
Examiner et mettre à jour les Lignes directrices 800-10 : Déficience intellectuelle et les Lignes directrices en santé mentale afin de fournir des politiques et des lignes directrices plus complètes pour la prise en charge et la supervision des personnes ayant des déficits cognitifs d’ici la fin de l’exercice financier 2025- 2026. Cela doit se faire en consultation avec le personnel de l’établissement qui s’occupe quotidiennement de ces enjeux.
Déterminer et mettre en œuvre une approche cohérente, exhaustive, opportune et normalisée pour le dépistage et l’évaluation des personnes ayant des déficits cognitifs.
Veiller à ce que des programmes correctionnels adaptés soient offerts à tous les sites, à ce que les animateurs de programmes reçoivent la formation appropriée pour offrir des programmes adaptés et à ce que le seuil d’admission aux programmes adaptés soit ajusté pour permettre un plus grand nombre de participants.
Élaborer et mettre en œuvre une nouvelle formation obligatoire portant sur le travail avec les personnes ayant des déficits cognitifs en milieu correctionnel pour tout le personnel d’ici 2026-2027. Cela devrait notamment comprendre des documents plus complets et appliqués pour la formation des agents correctionnels.
Doubler l’affectation budgétaire aux établissements résidentiels communautaires, aux CCC et aux services de santé communautaire (y compris l’ISMC), au cours des cinq prochains exercices, afin de répondre à l’évolution du profil de santé mentale des libérés conditionnels; rémunérer adéquatement les partenaires et les fournisseurs de services externes; et veiller à ce que les services communautaires de santé mentale et de transition disposent de ressources adéquates.
Je recommande que le SCC mette en œuvre des changements à la planification clinique de la continuité des soins et à la santé mentale dans la collectivité d’ici la fin de l’exercice financier 2025-2026, y compris les améliorations suivantes :
mettre à jour et simplifier les politiques et les outils nationaux, y compris des normes de service claires et des exigences en matière de rapports;
mettre en œuvre une évaluation des besoins en matière de santé mentale qui permet de planifier la réinsertion sociale;
améliorer la formation, l’éducation, les politiques et les procédures relatives à l’échange d’information;
assurer le respect des politiques concernant la libération des personnes avec des pièces d’identité gouvernementales (de préférence des certificats de naissance);
éliminer les obstacles à l’accès aux soins de santé et de santé mentale financés par le gouvernement à la libération en mettant l’accent sur l’amélioration de la collaboration avec les autorités sanitaires provinciales et territoriales ainsi qu’avec les partenaires communautaires.
Je recommande que le SCC réponde immédiatement à la recommandation et aux enjeux soulevés précédemment par le BEC concernant les rangées de suivi thérapeutique et la prestation de soins intermédiaires de santé mentale.
Je recommande que le SCC réponde immédiatement à chacune des 38 recommandations énoncées dans le rapport du Groupe de travail des SSMI intitulé « Examen des services intermédiaires de soins de santé mentale dans les établissements ordinaires du Service correctionnel du Canada et recommandations connexes » (11 janvier 2023). Plus précisément, je recommande que le SCC réalise ce qui suit :
Élaborer et rendre compte publiquement d’un plan traitant de chacune des 38 recommandations et y répondant individuellement avec des mesures concrètes et des échéanciers d’ici la fin de l’exercice financier 2025-2026.
Assurer la mise en œuvre complète de chacune des 38 recommandations d’ici 2026-2027.
Je recommande que le SCC travaille en étroite collaboration avec un organisme externe spécialisé en santé mentale pour élaborer une stratégie complète fondée sur des données probantes pour des services tenant compte des traumatismes et des traitements propres aux traumatismes pour les femmes purgeant une peine de ressort fédéral. Cette stratégie devrait comprendre les éléments suivants :
le dépistage normalisé des traumatismes, de la victimisation et des expériences négatives de l’enfance;
la mise en œuvre de pratiques tenant compte des traumatismes dans l’ensemble des politiques et procédures du SCC, appuyées par une formation spécialisée du personnel;
l’accès à une thérapie et à des conseils pour le traitement du traumatisme à la fois adaptés au genre et à la culture;
des environnements sûrs et favorables afin que les femmes commencent le processus de guérison.
La nouvelle stratégie devrait être entièrement mise en œuvre d’ici juin 2026 Le nouveau modèle devrait ensuite être évalué par le SCC, et une approche semblable devrait être étendue aux établissements pour hommes à l’échelle nationale.
Je recommande que le SCC réaffecte une partie importante de ses ressources au financement de pavillons de ressourcement supplémentaires en vertu de l’article 81 et augmente le financement des pavillons de ressourcement existants en vertu de l’article 81 au cours de l’exercice financier 2025-2026, afin de leur permettre d’offrir des services de santé mentale et de bien-être authentiques, holistiques et dirigés par des Autochtones, qui répondent mieux aux besoins des personnes autochtones ayant des problèmes de santé mentale d’une manière qui tient compte de la culture et des traumatismes, et exempte de discrimination et de préjugés inconscients.
ANNEXE B : Statistiques annuelles
PLAINTES
Tableau A. Total des plaintes
| ACTIVE | RÉSOLUE | TOTAL GÉNÉRAL | |
|---|---|---|---|
| Total des plaintes126 | 346 | 4 006 | 4 352 |
Les cinq catégories de plaintes les plus fréquemment déterminées dans l’ensemble et selon les populations prioritaires
| POPULATION ET CATÉGORIE DE PLAINTES | Nbre | % |
|---|---|---|
| GÉNÉRAL | 4 352 | |
| Catégorie de plainte | ||
| Conditions de détention | 480 | 11,0 % |
| Soins de santé | 458 | 10,5 % |
| Personnel | 440 | 10,1 % |
| Effets gardés en cellules | 317 | 7,3 % |
| Transfert | 273 | 6,3 % |
| AUTOCHTONES | 1 200 | |
| Catégorie de plainte | ||
| Soins de santé | 137 | 11,4 % |
| Personnel | 117 | 9,8 % |
| Conditions de détention | 112 | 9,3 % |
| Effets gardés en cellules | 89 | 7,4 % |
| Transfert | 82 | 6,8 % |
| FEMMES | 472 | |
| Catégorie de plainte | ||
| Conditions de détention | 85 | 18,0 % |
| Soins de santé | 58 | 12,3 % |
| Personnel | 52 | 11,0 % |
| Mise en liberté sous condition | 21 | 4,4 % |
| Effets gardés en cellules | 19 | 4,0 % |
Tableau B. Plaintes, plaignants individuels et population carcérale par région
| RÉGION | PLAINTES | INDIVIDUS127 | POPULATION CARCÉRALE128 |
|---|---|---|---|
| Atlantique | 442 | 211 | 1 326 |
| Québec | 1 065 | 525 | 3 244 |
| Ontario | 819 | 433 | 4 138 |
| Prairies | 930 | 535 | 4 272 |
| Pacifique | 621 | 300 | 1 857 |
| Total129 | 3 877 | 2 004 | 14 837 |
Tableau C. Plaignants individuels et plaintes par type d’établissement
| TYPE D’INSTALLATION | PLAINTES | INDIVIDUS |
|---|---|---|
| Établissements pour hommes | 3 253 | 1 687 |
| À niveaux multiples de sécurité | 1 136 | 648 |
| Sécurité maximale130 | 957 | 382 |
| Sécurité moyenne | 1 147 | 647 |
| Sécurité minimale | 13 | 10 |
| Établissements pour femmes | 442 | 231 |
| Centres régionaux de traitement | 147 | 65 |
| Pavillons de ressourcement | 35 | 21 |
| CCC-ERC131 | 161 | 108 |
| Communauté | 71 | 51 |
| Total général132 | 4 109 | 2 163 |
Tableau D. Plaintes du BEC par catégorie et état de résolution133
| CATÉGORIE DE PLAINTE | ACTIVE | RÉSOLUE | TOTAL GÉNÉRAL |
|---|---|---|---|
| Préparation du dossier | 1 | 27 | 28 |
| Effets gardés en cellules | 17 | 300 | 317 |
| Placement en cellule | 3 | 94 | 97 |
| Réclamations contre la Couronne | 1 | 27 | 28 |
| Surveillance communautaire | 2 | 5 | 7 |
| Mise en liberté sous condition | 4 | 130 | 134 |
| Conditions de détention | 47 | 433 | 480 |
| Décès d’un détenu | 3 | 6 | 9 |
| Régimes alimentaires | 4 | 42 | 46 |
| Discipline | 4 | 40 | 44 |
| Discrimination | 5 | 36 | 41 |
| Emploi | 6 | 59 | 65 |
| Renseignements sur le dossier | 9 | 93 | 102 |
| Questions financières | 7 | 112 | 119 |
| Services d’alimentation | 6 | 46 | 52 |
| Grief | 4 | 85 | 89 |
| Harcèlement par un détenu | 7 | 22 | 29 |
| Réduction des méfaits | 0 | 6 | 6 |
| Santé et sécurité (des conditions de travail) | 3 | 18 | 21 |
| Soins de santé | 33 | 425 | 458 |
| Décideur externe indépendant | 0 | 3 | 3 |
| Processus de demande du détenu | 11 | 111 | 122 |
| Accès légal | 5 | 70 | 75 |
| Courrier | 7 | 51 | 58 |
| Santé mentale | 5 | 64 | 69 |
| Programme mère-enfant | 1 | 3 | 4 |
| Bureau de l’enquêteur correctionnel134. | 6 | 100 | 106 |
| Langues officielles | 1 | 4 | 5 |
| À l’extérieur du secteur de compétence | 4 | 144 | 148 |
| Programmes | 8 | 41 | 49 |
| Procédures de libération | 2 | 16 | 18 |
| Sécurité et sûreté | 12 | 104 | 116 |
| Fouilles | 3 | 36 | 39 |
| Classification de sécurité | 19 | 96 | 115 |
| Administration de la peine | 2 | 18 | 20 |
| Blessure grave d’un détenu | 0 | 3 | 3 |
| Unités spéciales de détention – Examens consultatifs nationaux | 0 | 1 | 1 |
| Observance spirituelle ou religieuse | 3 | 15 | 18 |
| Personnel | 21 | 419 | 440 |
| Unité d’intervention structurée (UIS) | 7 | 55 | 62 |
| Téléphone | 5 | 74 | 79 |
| Permission de sortir | 5 | 60 | 65 |
| Transfert | 22 | 251 | 273 |
| Analyse d’urine | 0 | 17 | 17 |
| Recours à la force | 10 | 45 | 55 |
| Visites | 17 | 146 | 163 |
| Pas assez d’information pour catégoriser | 4 | 53 | 57 |
| Total | 346 | 4006 | 4352 |
Tableau E. Plaignants et plaintes selon l’origine ethnique autodéclarée
| FEMMES | HOMMES | |||
|---|---|---|---|---|
| ORIGINE ETHNIQUE | PLAINTES | INDIVIDUS | PLAINTES | INDIVIDUS |
| Blanc | 237 | 129 | 1 629 | 891 |
| Autochtone | 172 | 96 | 1 028 | 569 |
| Noir | 28 | 12 | 570 | 237 |
| Autre minorité visible, multiethnique ou non précisée | 35 | 22 | 411 | 208 |
| Total135 | 472 | 259 | 3 638 | 1 905 |
Tableau F. Traitement des plaintes
| MESURE136 | Nbre |
|---|---|
| Résolution interne | 2 349 |
| Enquête | 2 621 |
| Total | 4 970137 |
EXAMENS
Tableau G : Examens obligatoires138 par type d’incident (2024-2025)
| TYPE D’INCIDENT | EXAMENS |
|---|---|
| Agression | 98 |
| Surdose interrompue | 20 |
| Tentative de suicide | 15 |
| Suicide | 14 |
| Homicide | 11 |
| Surdoses | 9 |
| Décès (cause naturelle)139 | 5 |
| Automutilation | 5 |
| Recours à la force | 3 |
| Blessures accidentelles | 1 |
| Total | 181 |
Examens du recours à la force effectués par le BEC en 2024-2025
Le Service correctionnel du Canada fournit au Bureau une trousse de recours à la force pour chaque cas, qui comprend généralement : un rapport sur le recours à la force; la vidéo de l’incident; la liste de contrôle du recours à la force des Services de santé; une liste de vérification après l’incident; la déclaration ou le rapport d’observation de l’agent; et un plan d’action pour corriger les lacunes. Les analystes de l’examen du recours à la force du BEC trient ensuite chaque trousse de recours à la force pour déterminer si un examen sommaire ou complet est nécessaire140. En 2024-2025, il y avait un total de :
- 2 367 cas uniques de recours à la force.
-
578 cas de recours à la force traités par les analystes de l’examen du recours
à la force du BEC.
- 338 cas ont été triés par le BEC, mais n’ont nécessité qu’un examen sommaire.
- 240 cas ont fait l’objet d’un examen complet par les analystes du recours à la force du BEC.
Tableau H. Examens du recours à la force effectués par le BEC en 2024-2025
| RÉGION | EXAMEN SOMMAIRE | EXAMEN COMPLET | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Atlantique | 32 | 30 | 62 |
| Québec | 104 | 54 | 158 |
| Ontario | 81 | 58 | 139 |
| Prairies | 86 | 83 | 169 |
| Pacifique | 35 | 15 | 50 |
| Total | 338 | 240 | 578 |
VISITES
Tableau I. Interactions, entrevues et visites menées par le BEC par région et installation (2024-2025)
| RÉGION/INSTALLATION | INTERACTIONS141 | ENTREVUES142 |
JOURS DU
BEC ANS LES ÉTABLISSEMENTS143 |
JOURS-PERSONNES DANS LES ÉTABLISSEMENTS144 |
|---|---|---|---|---|
| Atlantique | 394 | 145 | 27 | 39 |
| Atlantique | 164 | 61 | 9 | 12 |
| Dorchester | 74 | 22 | 5 | 5 |
| Établissement Nova pour femmes | 72 | 49 | 6 | 9 |
| Centre de rétablissement Shepody | 10 | 0 | 3 | 9 |
| Springhill | 47 | 13 | 4 | 4 |
| CCC-ERC | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Communauté | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 1 046 | 432 | 81 | 123 |
| Archambault | 168 | 29145 | 8 | 13 |
| Cowansville | 63 | 45 | 8 | 16 |
| Centre régional de réception | 136 | 45 | 10 | 11 |
| Donnacona | 82 | 60 | 12 | 21 |
| Drummond | 71 | 63 | 8 | 9 |
| Centre fédéral de formation | 129 | 53 | 9 | 17 |
| Joliette | 69 | 41 | 6 | 9 |
| La Macaza | 78 | 36 | 6 | 6 |
| Port-Cartier | 117 | 60 | 10 | 13 |
| Unité spéciale de détention (USD) | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Institut national de psychiatrie légale PhilippePinel (INPLPP) de Montréal | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CCC-ERC | 52 | 0 | 3 | 6 |
| Communauté | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 871 | 287 | 54 | 92 |
| Bath | 95 | 17146 | 5 | 6 |
| Beaver Creek | 90 | 39 | 6 | 12 |
| Collins Bay | 60 | 35 | 6 | 9 |
| Établissement Grand Valley pour femmes | 95 | 59 | 6 | 9 |
| Joyceville | 73 | 45147 | 6 | 6 |
| Millhaven | 228 | 52148 | 11 | 26 |
| Warkworth | 122 | 40 | 7 | 11 |
| CCC-ERC | 65 | 0 | 4 | 7 |
| Communauté | 43 | 0 | 3 | 6 |
| Prairies | 886 | 305 | 52 | 95 |
| Bowden | 117 | 35 | 6 | 12 |
| Maison de ressourcement Buffalo Sage | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Drumheller | 123 | 55 | 6 | 12 |
| Pavillon de ressourcement pour femmes Eagle | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edmonton | 97 | 46 | 9 | 12 |
|
Établissement pour femmes d’Edmonton |
51 | 37 | 6 | 9 |
| Grande Cache | 77 | 47 | 6 | 9 |
| Grierson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Centre Pê Sâkâstêw | 7 | 6 | 1 | 2 |
| Centre psychiatrique régional | 60 | 0 | 3 | 12 |
| Saskatchewan | 201 | 55 | 6 | 12 |
| Centre de guérison Stan Daniels | 8 | 2 | 1 | 2 |
| Stony Mountain | 87 | 20 | 4 | 5 |
| Pavillon de ressourcement Willow Cree | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CCC-ERC | 27 | 0 | 2 | 4 |
| Communauté | 13 | 0 | 1 | 2 |
| Pacifique | 561 | 214 | 40 | 84 |
|
Établissement de la vallée du Fraser pour femmes |
43 | 50 | 8 | 16 |
| Kent | 147 | 40 | 6 | 12 |
|
Village de guérison de Kwìkwèxwelhp |
6 | 0 | 0 | 0 |
| Matsqui | 53 | 39 | 5 | 10 |
| Mission | 134 | 33 | 6 | 9 |
| Mountain | 69 | 45 | 3 | 6 |
| Pacifique | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Centre régional de réception | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Centre régional de traitement | 30 | 7 | 6 | 19 |
| William Head | 10 | 0 | 0 | 0 |
| CCC-ERC | 23 | 0 | 4 | 8 |
| Communauté | 9 | 0 | 2 | 4 |
| Établissement non précisé149 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| Total général | 3 866 | 1 383 | 254 | 433 |
Appels reçus à la ligne sans frais en 2024-2025
Les personnes purgeant une peine de ressort fédéral et les membres du public peuvent communiquer avec le BEC en composant notre numéro sans frais (1-877-885-8848) partout au Canada. Toutes les communications entre les personnes purgeant une peine de ressort fédéral et le BEC sont confidentielles.
Nombre de communications reçues au moyen de la ligne sans frais au cours de la période visée par le rapport : 16 739.
Nombre de minutes enregistrées pour les appels reçus sur la ligne sans frais : 95 997.
Notes
-
Note 1
-
L’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus mentionnés est #109(1) : Les personnes qui ne sont pas tenues pénalement responsables, ou chez lesquelles un handicap mental ou une autre affection grave est détectée ultérieurement, et dont l’état serait aggravé par le séjour en prison, ne doivent pas être détenues dans une prison et des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans un service de santé mentale.
-
Note 2
-
Selon le SCC, ce chiffre englobe toutes les dépenses prévues, y compris les éventualités, les indemnités, les indexations et les frais et salaires internes du gouvernement du Canada, ainsi que les impôts. Il ne reflète pas uniquement le coût de construction.
-
Note 3
-
Au-delà des 38 lits au Centre de rétablissement Shepody, il y a 15 lits au Pénitencier de Dorchester qui sont utilisés par Shepody.
-
Note 4
-
En Ontario, un établissement de l’annexe 1 est un établissement psychiatrique désigné en vertu de la Loi sur la santé mentale.
-
Note 5
-
Organisation de normes en santé (2024). Norme Services de santé des établissements correctionnels. Document de HSO/SCC fourni au BEC en février 2025.
-
Note 6
-
SCC (2024). Profil des patients en santé mentale. Document de SCC fourni au BEC en octobre 2024.
-
Note 7
-
Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC, 2009). Rapport annuel de 2008-2009; La santé mentale et la toxicomanie dans le système correctionnel fédéral, comparution du BEC devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU, décembre 2010).
-
Note 8
-
Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC, 2018). Rapport annuel de 2017-2018; Bradford, J. (décembre 2017). The regional treatment centres, rapport inédit.
-
Note 9
-
L’Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent à Brockville, en Ontario; Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel à Montréal, au Québec; l’hôpital psychiatrique médicolégal de Coquitlam, en Colombie-Britannique; l’Association canadienne des unités médico-légales en milieu fermé en santé mentale à Toronto (Ont.).
-
Note 10
-
Service correctionnel du Canada (s.d.). Centre d’excellence en santé du Service correctionnel du Canada, gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/service-correctionnel/organisation/installations-securite/centre-excellence-sante.html.
-
Note 11
-
L’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus mentionnés est #109(1) : Les personnes qui ne sont pas tenues pénalement responsables, ou chez lesquelles un handicap mental ou une autre affection grave est détectée ultérieurement, et dont l’état serait aggravé par le séjour en prison, ne doivent pas être détenues dans une prison et des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans un service de santé mentale.
-
Note 12
-
Données extraites du Système intégré de rapports – Modernisé (SIR-M) le 9 mars 2025.
-
Note 13
-
Données extraites de l’Entrepôt de données du SCC, le 9 mars 2024. Remarque : Les données saisies pour l’exercice financier 2024-2025 ne représentent pas l’année entière, compte tenu de la date à laquelle elles ont été obtenues.
-
Note 14
-
Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC, 2024). Rapport annuel de 2023-2024.
-
Note 15
-
Commissariat à l’intégrité du secteur public (2020). Conclusions du commissaire à l’intégrité du secteur public dans le cadre d’une enquête concernant une divulgation d’actes répréhensibles : Service correctionnel Canada – Rapport sur le cas, Ottawa (Canada), Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada.
-
Note 16
-
Ibid.
-
Note 17
-
Service correctionnel du Canada (2025). Évaluation du Modèle d’engagement et d’intervention : sommaire, gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/service-correctionnel/organisation/transparence/rapports-evaluation-scc/modele-engagement-intervention/modele-engagement-intervention-sommaire.html
-
Note 18
-
Toutes les données de cette section concernent la période entre le 1er avril 2024 et le 16 janvier 2025.
-
Note 19
-
Un ordre permanent est un document créé pour mettre en œuvre une directive ou des lignes directrices du commissaire lorsqu’il est nécessaire de préciser des règles et des processus propres à l’unité opérationnelle.
-
Note 20
-
Syndicat des agents correctionnels du Canada (2025). Ententes, Syndicat des agents correctionnels du Canada-Union of Canadian Correctional Officers-Confédération des syndicats nationaux. https://ucco-sacc-csn.ca/fr/ententes.
-
Note 21
-
Remarque : Le kimisinaw (mot cri pour sœur aînée) est propre au Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci.
-
Note 22
-
Service correctionnel du Canada (2025). Test emplois de première ligne, gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/service-correctionnel/services/scc-vous/travailler-scc/test-emplois-premiere-ligne.html.
-
Note 23
-
Les délinquants incompatibles sont déterminés lorsque le SCC estime qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un délinquant constitue une menace pour la sécurité et le bien-être d’un autre.
-
Note 24
-
BEC (2011). Rapport annuel de 2010-2011.
-
Note 25
-
Données extraites de l’Entrepôt de données du SCC, le 9 mars 2025.
-
Note 26
-
Données extraites de l’Entrepôt de données du SCC, le 9 mars 2025.
-
Note 27
-
BEC (2023). Rapport annuel de 2022-2023.
-
Note 28
-
Voir l’étude de cas d’un décès au CRT Millhaven dans le rapport annuel de 2023-2024.
-
Note 29
-
Le BEC reconnaît que la terminologie dans le domaine de la neurodiversité et des troubles cognitifs évolue et qu’il n’y a pas de consensus sur un seul terme qui reflète l’hétérogénéité des besoins cognitifs et intellectuels. À moins d’indication contraire, le terme plus large de « déficits cognitifs » et de langage centré sur la personne (p. ex. personnes autistes) sera utilisé tout au long du présent rapport. La documentation du SCC utilise principalement le terme « déficience cognitive ».
-
Note 30
-
Dodd, S., C. Doyle, H. Dickinson et coll. (2022). « The forgotten prisoners : Exploring the impact of imprisonment on people with disability in Australia », Criminology and Criminal Justice, vol. 24, no 2, p. 395- 412; García-Largo, L.M., G. Martí-Agustí, C. Martin-Fumadó et coll. (2020). « Intellectual disability rates among male prison inmates », International Journal of Law and Psychiatry, vol. 70; Hellenbach, M., T. Karatzias et M. Brown (2017). « Intellectual Disabilities Among Prisoners : Prevalence and Mental and Physical Health Comorbidities », Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, p. 230-241; Lin, E., et coll. (2017). « Intellectual and developmental disabilities and Ontario’s forensic inpatient system : a population-based cohort study », Psychology, Crime and Law, vol. 23, no 9, p. 914-926.
-
Note 31
-
Billstedt, E., H. Anckarsäter, M. Wallinius et B. Hofvander (2017). « Neurodevelopmental disorders in young violent offenders : Overlap and background characteristics », Psychiatry Research, vol. 252, p. 234-241; Hofvander, B., S. Bering, A. Tärnhäll, M. Wallinius et E. Billstedt (2019). « Few differences in the externalizing and criminal history of young violent offenders with and without autism spectrum disorders », Frontiers in Psychiatry, vol. 10, article 911.
-
Note 32
-
Hunter, S., L.E. Kois, A.T. Peck et coll. (2023). « The prevalence of traumatic brain injury (TBI) among people impacted by the criminal legal system : An updated meta-analysis and subgroup analyses », Law and Human Behavior, vol. 47, no 5, p. 539-565.
-
Note 33
-
Popova, S., S. Lange, D. Bekmuradov et coll. (2011). « Fetal Alcohol Spectrum Disorder prevalence estimates in correctional systems : A systematic literature review », Revue canadienne de santé publique, vol. 102, no 5, p. 336-340.
-
Note 34
-
Hellenbach, M., et coll. (2017); Bureau de l’inspecteur des services de garde (BISG, 2021). Use of force against prisoners in Western Australia, BISG du gouvernement de l’Australie-Occidentale.
-
Note 35
-
Helverschou, S.B., K. Steindal, J.A. Nøttestad et coll. (2018). « Autistic individuals in the criminal justice system : An examination of support structures and recidivism », Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 48, no 5, p. 1820-1833; de Geus, E.Q., et coll. (2021). « Acquired brain injury and interventions in the offender population : A systematic review », Frontiers in Psychiatry, vol. 12; Hellenbach, M., et coll. (2017).
-
Note 36
-
Bureau de l’inspecteur des services de garde (BISG, 2024). People in custody with an intellectual disability, BISG du gouvernement de l’Australie-Occidentale.
-
Note 37
-
de Geus, E.Q., et coll. (2021); Hunter, S., et coll. (2023).
-
Note 38
-
Dodd, S., et coll. (2022).
-
Note 39
-
Bureau de l’inspecteur des services de garde (BISG, 2024). People in custody with an intellectual disability, BISG du gouvernement de l’Australie-Occidentale.
-
Note 40
-
Voir les lignes directrices d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) portant sur le Règlement canadien sur l’accessibilité pour obtenir de plus amples renseignements sur la distinction entre ce qu’ils définissent comme des troubles d’apprentissage et des troubles du développement (https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/directives-reglements-canadien-accessibilite/consultation/concepts-cles.html).
-
Note 41
-
Bureau de l’enquêteur correctionnel (2019). Vieillir et mourir en prison : enquête sur les expériences vécues par les personnes âgées sous garde fédérale.
-
Note 42
-
L’examen de la littérature a été effectué en collaboration avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH).
-
Note 43
-
Cette politique sera appelée CD-800-10 dans le reste du présent rapport.
-
Note 44
-
Les Lignes directrices intégrées en santé mentale du SCC (octobre 2023) décrivent la prestation de services de santé mentale aux délinquants dans les établissements ordinaires du SCC, les centres régionaux de traitement et dans la collectivité.
-
Note 45
-
La documentation du SCC utilise principalement le terme « déficience cognitive ». Selon les Lignes directrices intégrées en santé mentale du SCC (2023), l’indicateur de déficience du Système de gestion des délinquants (SGD) est activé lorsqu’un professionnel de la santé détermine qu’une personne a une déficience cognitive qui peut avoir une incidence sur le fonctionnement de l’établissement ou qui nécessite une approche adaptée pour la gestion de cas et la planification correctionnelle.
-
Note 46
-
Stewart, L.A., G. Wilton et J. Sapers (2016). « Offenders with cognitive deficits in a Canadian prison population : Prevalence, profile, and outcomes », International Journal of Law and Psychiatry, vol. 44, p. 7-14.
-
Note 47
-
La Mesure des capacités cognitives générales pour adultes (General Ability Measure for Adults [GAMA]) est conçue pour évaluer les capacités intellectuelles et les capacités générales globales d’une personne avec des éléments qui nécessitent l’application du raisonnement et de la logique pour résoudre des problèmes.
-
Note 48
-
Domaines de fonctionnement – Fonctionnement cognitif : impliquent les fonctions cérébrales qui comprennent le raisonnement, la mémoire, l’attention, le langage et mènent à l’acquisition de connaissances. Ce domaine peut être lié à la déficience intellectuelle, aux troubles d’apprentissage, à la démence et à d’autres déficiences cognitives connexes.
-
Note 49
-
L’établissement psychiatrique régional, situé à Saskatoon, en Saskatchewan, est le seul centre de traitement du SCC qui dispose d’une unité pour femmes.
-
Note 50
-
Bureau de l’enquêteur correctionnel (2024). Rapport annuel de 2023-2024.
-
Note 51
-
Kerodal, A.G., D. Akca, L. Jewell et coll. (2021). A Process Evaluation of the Regional Psychiatric Centre’s Fetal Alcohol Spectrum Disorder Pilot Project : Year 1 (July 2018-June 2019), Centre for Forensic Behavioural Science and Justice Studies, Université de la Saskatchewan.
-
Note 52
-
Voir Andrews et Bonta (2024). The Psychology of Criminal Conduct, 7e éd., New York (N.Y.), Routledge; Andrews, D.A., I. Zinger, R.D. Hoge, J. Bonta, P. Gendreau et F.T. Cullen (1990). « Does correctional treatment work? A clinically relevant and psychologically informed meta-analysis », Criminology, vol. 28, p. 369-404.
-
Note 53
-
Critères d’admission du Modèle de programme correctionnel intégré adapté (renseignements fournis par le SCC à partir d’une demande de documents en décembre 2024).
-
Note 54
-
Outil de dépistage – MPCI adapté (renseignements fournis par le SCC à partir d’une demande de documentation en décembre 2024).
-
Note 55
-
Stewart, L. A., Wilton, G., et Sapers, J. (2016). Offenders with cognitive deficits in a Canadian prison population : Prevalence, profile, and outcomes. International journal of law and psychiatry, 44, 7-14. L’étude a noté que 15,4% de l’échantillon présentait plus de deux déficits cognitifs ou au moins un déficit grave. D’après la population totale d’hommes en détention en 2023-2024 (13 119), le calcul de 3% est tiré du nombre d’inscriptions sur la population totale de personnes ayant des déficits cognitifs (c.-à-d. 60/2 020).
-
Note 56
-
« Module motivationnel – Volet soutien est une intervention structurée d’une durée limitée (quatre séances) destinée aux délinquants admissibles ayant des facteurs de réceptivité (alphabétisation, fonctionnement cognitif, etc.) qui font en sorte qu’ils ont besoin davantage de temps et d’aide soutien pour comprendre et appliquer mettre en application les compétences enseignées au cours du programme. Dans le cadre du volet de soutien, le personnel du programme travaille avec les délinquants afin de les aider à terminer le programme. » – Programmes correctionnels du SCC pour les hommes, consulté à partir du Hub du SCC (mars 2025).
-
Note 57
-
SCC (novembre 2020). Évaluation des programmes correctionnels de réinsertion sociale, Constatation 24.
-
Note 58
-
SCC (2023). Examen qualitatif des facteurs de réceptivité propres aux participants aux programmes correctionnels ayant des symptômes de troubles mentaux, une déficience cognitive ou des troubles d’apprentissage, rapport de recherche R-441, SCC
-
Note 59
-
Renseignements sur les programmes d’éducation accessibles à partir du Hub du SCC (mars 2025).
-
Note 60
-
Selon le SCC, le Projet d’éducation numérique (PEN) permet aux délinquants d’acquérir des compétences informatiques de base tout en améliorant leur éducation et en améliorant leur alphabétisation. Grâce à des partenariats avec des organismes d’apprentissage externes et des établissements d’enseignement, le PEN offre un environnement de classe mixte avec apprentissage en ligne à l’aide d’une plateforme numérique interne. La plateforme est conçue pour répondre aux besoins de réceptivité des délinquants ayant diverses incapacités et difficultés d’apprentissage.
-
Note 61
-
Logiciels et outils de technologie d’aide à la lecture et à la rédaction.
-
Note 62
-
Cet enjeu a été soulevé dans plusieurs rapports annuels du BEC (2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2011-2012); Woodward, J. (janvier 2025). « Thousands of cellphones are smuggled into Canadian prisons. Advocates are proposing an unusual solution », CTV News. https://www.ctvnews.ca/canada/article/could-supervised-internet-for-inmates-cut-down-on-thousands-of-cellphones-smuggled-into-prison/
-
Note 63
-
FASD Network de la Saskatchewan – Un organisme provincial communautaire ayant des bureaux en Saskatchewan qui travaille à « améliorer la vie des personnes touchées par l’ETCAF ». Au moyen de mesures de soutien, de formation et d’événements, le Réseau offre des services et de l’éducation dans toute la province. (https://www.saskfasdnetwork.ca/)
-
Note 64
-
SCC (2022). « Besoins essentiels pour une réinsertion sociale en toute sécurité : stabilité financière et du logement », Recherche en bref, 21-25.
-
Note 65
-
Babchishin, K.M., L.-A. Keown et K.P. Mularczyk (2021). Débouchés économiques des délinquants sous responsabilité fédérale au Canada, rapport de recherche 2021-R002, Sécurité publique Canada et Service correctionnel du Canada..
-
Note 66
-
Stewart, L., et coll. (2017). Fiabilité et validité de l’instrument de définition et d’analyse des facteurs dynamiques, révisé, rapport de recherche R-395, Service correctionnel du Canada.
-
Note 67
-
Bodkin, C., et coll. (2019). « History of childhood abuse in populations incarcerated in Canada : A systematic review and meta-analysis », American Journal of Public Health.
-
Note 68
-
Beaudette, J.N., et L.A. Stewart (2016). « National prevalence of mental disorders among incoming Canadian male offenders », Revue canadienne de psychiatrie; Brown et coll. (avril 2018). Prévalence nationale des troubles mentaux chez les délinquantes sous responsabilité fédérale : échantillon de la population carcérale, R-406, Service correctionnel du Canada.
-
Note 69
-
Article 86 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
-
Note 70
-
La LSCMLC fait une distinction entre les délinquants, qui sont définis comme toutes les personnes purgeant une peine fédérale, et les détenus qui ne comprennent que ceux détenus dans les pénitenciers fédéraux.
-
Note 71
-
Paragraphe 86(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
-
Note 72
-
SCC (janvier 2024). Lignes directrices sur la planification de l’admission, du transfèrement et de la continuité des soins des détenus.
-
Note 73
-
Voir la Matrice (outil) pour la planification de la continuité des soins du SCC (août 2023) pour connaître le calendrier de planification de la continuité des soins ainsi que les rôles et responsabilités des personnes concernées.
-
Note 74
-
SCC (2012). Stratégie sur la santé mentale en milieu correctionnel au Canada : un partenariat fédéral-provincial-territorial.
-
Note 75
-
BEC (2004). Rapport annuel de 2003-2004.
-
Note 76
-
SCC (novembre 2008). Rapport d’évaluation : Initiative sur la santé mentale dans la collectivité, dossier no 394-2-51, Direction de l’évaluation, Secteur de l’évaluation du rendement.
-
Note 77
-
Données reçues le 24 mars 2025 dans le cadre d’une demande de documentation officielle au SCC. Ajustement de l’inflation à l’aide du « Calculateur d’inflation » en ligne de la Banque du Canada, qui utilise les données mensuelles de l’indice des prix à la consommation pour montrer les variations du coût des biens. L’année 2007 a été utilisée comme année de référence pour la comparaison, car c’était la première année où la santé mentale communautaire (SMC) recevait le plein financement.
-
Note 78
-
Voir Aperçu statistique du système correctionnel et la mise en liberté sous condition (ASSCMLSC) de Sécurité publique Canada pour les dépenses corrigées en fonction de l’inflation des services correctionnels fédéraux.
-
Note 79
-
Extrait le 10 avril 2025 du Système intégré de rapports – Modernisé (SIR-M) du SCC.
-
Note 80
-
Pour l’affectation de la dotation, voir Sécurité publique Canada (2024). Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 2022. Pour les dépenses totales prévues du SCC pour 2024- 2025, voir le Plan ministériel du SCC pour 2024-2025. Les affectations totales aux services correctionnels communautaires en 2024-2025 (384,5 millions de dollars), y compris les agents de libération conditionnelle dans la collectivité, et toutes les dépenses du « Centre de responsabilité communautaire » du SCC ont été obtenues au moyen d’une demande d’informations le 20 juin 2025.
-
Note 81
-
Courriel des Politiques et programmes de santé du SCC daté du 9 décembre 2024.
-
Note 82
-
SCC (janvier 2024). Lignes directrices sur la planification de l’admission, du transfèrement et de la continuité des soins des détenus.
-
Note 83
-
Dernière mise à jour de l’échelle en novembre 2018. Pour en savoir plus, consultez l’Échelle des besoins en santé mentale (EBSM) – Guide d’instructions détaillé du SCC.
-
Note 84
-
Données reçues le 24 octobre 2024 dans le cadre d’une demande de documentation officielle au SCC.
-
Note 85
-
L’objectif des soins intermédiaires de santé mentale (SISM) est de fournir un soutien en santé mentale aux personnes incarcérées qui ont des besoins supérieurs à ceux qui peuvent être comblés dans les soins primaires, mais qui ne répondent pas aux critères de soins dans un centre régional de traitement.
-
Note 86
-
SCC (août 2024). Profil des patients en santé mentale. Reçu le 4 décembre 2024 dans le cadre d’une demande de documents officiels au SCC.
-
Note 87
-
Beaudette, Power et Stewart (2015). La prévalence nationale des troubles mentaux chez les délinquants de sexe masculin sous responsabilité fédérale nouvellement admis, rapport de recherche R-357, Ottawa (Ont.), Service correctionnel du Canada.
-
Note 88
-
Brown et coll. (2018). Prévalence des troubles mentaux chez les délinquantes sous responsabilité fédérale : échantillons de la population carcérale et à l’admission, rapport de recherche R-420, Ottawa (Ont.), Service correctionnel du Canada.
-
Note 89
-
De même, le rapport de 2017 du vérificateur général, Rapport du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada, intitulé « La préparation des détenues à la mise en liberté – Service correctionnel Canada », a également révélé que le SISM n’aidait pas le personnel de la santé mentale « à établir l’ordre de priorité des délinquantes en attente de services de santé mentale ».
-
Note 90
-
SCC (4 mai 2015). Planification de la continuité des soins : suite donnée à la note de service « Rapport sur l’essentiel de l’état de santé à la mise en liberté et Matrice (outil) », dossier no 276786.
-
Note 91
-
Pour en savoir plus sur les politiques du SCC concernant l’échange de renseignements, consultez les sections 19 et 20 de la Directive du commissaire 800-3 : Consentement relatif aux évaluations, aux traitements et à la communication de renseignements médicaux; et les sections 11 et 12 des Lignes directrices sur la communication de renseignements personnels sur la santé du SCC (mis à jour en mars 2018).
-
Note 92
-
Le BEC comprend et respecte les responsabilités professionnelles liées aux soins de santé mentale. Cependant, des efforts devraient être déployés pour clarifier comment les principes du consentement et du « besoin de savoir » s’appliquent dans ces circonstances.
-
Note 93
-
Voir le Cadre national des services de santé essentiels du SCC (septembre 2020), où la prestation de services de santé dans la collectivité et de services de santé « essentiels » conformément aux obligations du SCC en vertu de la LSCMLC est clarifiée et définie.
-
Note 94
-
Les établissements résidentiels communautaires (ERC) [plus communément appelés « maisons de transition »] sont exploités par des organismes privés, généralement par des organismes à but non lucratif comme la Société John Howard, la Société Elizabeth Fry, la Société St. Léonard et l’Armée du Salut. Les centres correctionnels communautaires (CCC) sont exploités par le SCC.
-
Note 95
-
SCC (mars 2017). Évaluation des Services de santé du Service correctionnel Canada, Division de l’évaluation, Secteur des politiques, site Web.
-
Note 96
-
Données reçues le 24 octobre 2024 dans le cadre d’une demande de documentation officielle au SCC.
-
Note 97
-
Il est important de noter qu’il y a eu une amélioration de 41 % sans carte santé en 2022-2023 à 26 % en 2023-2024. Bien qu’il y ait eu des améliorations, ces données ne nous disent pas si la carte santé a été obtenue avant ou pendant le processus de planification de la continuité des soins, ou si elle a été obtenue à l’initiative du personnel communautaire. De plus, il existe des différences régionales importantes, avec 83 % d’entre eux ayant une carte de santé à la libération dans la région du Québec en 2023-2024, comparativement à 22 % dans la région du Pacifique.
-
Note 98
-
Par exemple, voir SCC (2022). Besoins essentiels pour une réinsertion sociale en toute sécurité : stabilité financière et du logement, RIB-21-25
-
Note 99
-
Commission de la santé mentale du Canada (13 février 2024). La santé mentale et le coût élevé de la vie : Note de synthèse.
-
Note 100
-
Extrait du module « Population des CCC – Aperçu national » du Système intégré de rapports – Modernisé (SIR-M), le 10 avril 2025.
-
Note 101
-
SCC (11 janvier 2023). Examen des services intermédiaires de soins de santé mentale dans les établissements ordinaires du Service correctionnel du Canada et recommandations connexes : aperçu, objectif, principes et processus, rapport interne.
-
Note 102
-
Des questionnaires ont été envoyés aux six établissements à sécurité maximale. Cependant, aucune réponse n’a été reçue de l’Établissement Kent.
-
Note 103
-
D’après les données portant sur l’affectation budgétaire fournies par le SCC en avril 2025.
-
Note 104
-
Au moment de la rédaction du présent rapport, en janvier 2025.
-
Note 105
-
D’après les données portant sur l’affectation budgétaire fournies par le SCC en avril 2025.
-
Note 106
-
Voir l’enquête du BEC de 2019-2020 sur les rangées de suivi thérapeutique pour en savoir plus sur le projet pilote d’agent de l’unité thérapeutique des établissements de l’Atlantique.
-
Note 107
-
Le terme « femmes » est utilisé dans le présent rapport, mais il est important de noter que des personnes de diverses identités de genre ont également été interrogées et incluses dans l’enquête.
-
Note 108
-
Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). https://www.camh.ca/fr/health-info/mental-illness-and-addiction-index/trauma
-
Note 109
-
Tam, K., et D. Derkzen (2014). Exposition aux traumatismes chez les délinquantes : Examen de la littérature, rapport de recherche R-333, Ottawa (Ont.), Service correctionnel du Canada.
-
Note 110
-
Ibid.
-
Note 111
-
Covington, S.S. (2008). « Women and addiction : A trauma-informed approach », Journal of Psychoactive Drugs, vol. 40 (suppl. 5), p. 377-385.
-
Note 112
-
Malik, N., E. Facer-Irwin, H. Dickson, A. Bird et D. MacManus (2023). « The Effectiveness of Trauma-Focused Interventions in Prison Settings : A Systematic Review and Meta-Analysis », Trauma, Violence, & Abuse.
-
Note 113
-
Felitti, V.J., et R.F. Anda (2010). « The Relationship of Adverse Childhood Experiences to Adult Health, WellBeing, Social Function, and Health Care », dans R. Lanius, E. Vermetten et C. Pain, dir., The Impact of Early Life Trauma on Health and Disease. The Hidden Epidemic, p. 77-87, New York, Cambridge University Press.
-
Note 114
-
Sheahan, C., et K. Wardrop (2023). Les expériences négatives dans l’enfance des délinquants sous responsabilité fédérale : Informations disponibles et résultats correctionnels, rapport de recherche R-445, Ottawa (Ont.), Service correctionnel du Canada.
-
Note 115
-
Covington, S. (mai 2022). « Creating a Trauma-Informed Justice System for Women », dans L. Gelsthorpe et S. Brown, dir., The Wiley Handbook on What Works with Girls and Women in Conflict with the Law : A Critical Review of Theory, Practice, and Policy, Royaume-Uni, John Wiley & Sons Ltd.
-
Note 116
-
Statistique Canada (4 novembre 2024). « Accès aux soins de santé et expériences connexes des peuples autochtones », Le Quotidien.
-
Note 117
-
Par exemple, Brown, G.P., J. Barker, K. McMillan, R. Norman, D. Derkzen, L.A. Stewart et K. Wardrop (2018). Prévalence des troubles mentaux chez les délinquantes sous responsabilité fédérale : échantillons de la population carcérale et à l’admission (R-420), Ottawa (Ont.), SCC; Brown, G., J. Barker, K. McMillan, R. Norman, D. Derkzen et L. Stewart (2018). Prévalence nationale des troubles mentaux chez les délinquantes sous responsabilité fédérale échantillon de la population carcérale (R-406), Ottawa (Ont.), SCC; Beaudette, J.N., J. Power et L.A. Stewart (2015). La prévalence nationale des troubles mentaux chez les délinquants de sexe masculin sous responsabilité fédérale nouvellement admis (R-357), Ottawa (Ont.), SCC
-
Note 118
-
R-357; R-420.
-
Note 119
-
R-420.
-
Note 120
-
Source : Entrepôt de données du SCC – Incidents : blessures auto-infligées.
-
Note 121
-
Schmitt, M.T., N.R. Branscombe, T. Postmes et A. Garcia (2014). « The consequences of perceived discrimination for psychological well-being : A meta-analytic review », Psychological Bulletin, vol. 140, no 4, p. 921-948.
-
Note 122
-
Par exemple, Commission de vérité et réconciliation (2015). Rapport final : Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir; Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU) de la Chambre des communes (2017). Étude : Les personnes autochtones dans le système correctionnel fédéral; Comité permanent de la condition féminine (FEWO) de la Chambre des communes (2017). Étude : Les femmes autochtones dans les systèmes judiciaires et correctionnels fédéraux; Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) [2020]. Rapport final : Réclamer notre pouvoir et notre place.
-
Note 123
-
Taylor, McKendy et Biro (2023). Comprendre les caractéristiques du profil et des expériences correctionnelles des délinquants autochtones sous responsabilité fédérale : examen des résultats de recherche, Ottawa (Ont.), Service correctionnel du Canada.
-
Note 124
-
L’article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition fait partie du processus de mise en liberté et s’applique aux personnes qui souhaitent purger leur mise en liberté sous condition ou d’office dans une communauté autochtone ou dans une région urbaine avec le soutien et la direction d’une organisation autochtone.
-
Note 125
-
Document d’information : Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (L.C. 2021, ch. 14, paragraphes 1, 2; article 24). https://www.justice.gc.ca/fra/declaration/apropos-about.html.
-
Note 126
-
Les données présentées dans ces annexes constituent un aperçu des données internes du BEC pour la semaine du 1e avril 2025. Les rapports futurs peuvent comporter des différences au fur et à mesure que les cas sont mis à jour.
-
Note 127
-
Le nombre de personnes qui ont communiqué avec le Bureau pour déposer une plainte (c.-à-d. les plaignants).
-
Note 128
-
Dénombrement de fin d’année de la population carcérale ventilée par région pour l’exercice 2024-2025, selon le Système intégré de rapports — Modernisé (SIR-M) du SCC.
-
Note 129
-
Les totaux n’incluent pas les centres correctionnels communautaires (CCC) et les établissements résidentiels communautaires (ERC) ni les libérés conditionnels dans la collectivité. Il y a eu 232 plaintes de 159 personnes-ressources uniques dans la collectivité. De plus, 242 cas ont été retirés parce que les plaignants souhaitaient rester anonymes.
-
Note 130
-
Cela comprend l’unité spéciale de détention (USD).
-
Note 131
-
Les centres correctionnels communautaires et les établissements résidentiels communautaires.
-
Note 132
-
Les totaux ne comprennent pas 242 plaintes de plaignants qui souhaitent demeurer anonymes et un cas dont le type d’établissement est inconnu.
-
Note 133
-
Le BEC peut ouvrir une enquête à la réception d’une plainte déposée par une personne purgeant une peine fédérale ou en son nom, ou de sa propre initiative. Les plaintes sont reçues par téléphone, par lettre et lors d’entrevues avec le personnel d’enquête du BEC dans les établissements correctionnels fédéraux.
-
Note 134
-
La grande majorité de ces demandes sont des demandes de renseignements généraux et des appels administratifs.
-
Note 135
-
Les totaux ne comprennent pas les 242 plaintes de plaignants qui souhaitent demeurer anonymes.
-
Note 136
-
Une résolution interne demande une réponse au plaignant dans le cadre du processus d’analyse préliminaire du BEC.
Les enquêtes comprennent des enquêtes où des mesures sont prises pour déterminer si une enquête est justifiée, et des enquêtes officielles sur des questions plus complexes qui nécessitent une analyse ainsi qu’un dialogue ou un échange d’information avec de multiples sources.
-
Note 137
-
Un dossier peut être rouvert et réglé plus d’une fois, chacun ayant ses propres raisons pour lesquelles il est fermé. C’est la raison pour laquelle le total dans ce tableau est plus élevé que le nombre réel de plaintes indiquées dans le tableau A.
-
Note 138
-
Le paragraphe 19(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) exige que le SCC enquête lorsqu’un détenu meurt ou subit des lésions corporelles graves et qu’il en fasse un rapport au commissaire ou à une personne désignée par le commissaire. Conformément au paragraphe 19(2), le SCC est tenu de fournir au BEC une copie de ce rapport.
-
Note 139
-
Conformément aux nouvelles dispositions (adpotées en 2019) du paragraphe 19.1(1) de la LSCMLC, lorsqu’un professionnel de la santé du SCC avise le SCC qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un décès résulte de causes naturelles, les obligations du SCC se limitent à un examen interne de la « qualité des soins » fournis à la personne incarcérée.
-
Note 140
-
Un examen sommaire de la trousse de recours à la force du SCC est effectué pour les incidents qui font l’objet d’une plainte particulière, lorsqu’il est déterminé par le triage que l’incident doit être examiné, et pour les incidents de niveau 1 et 2 où l’examen interne du SCC a contesté la question de savoir si l’incident de recours à la force était « nécessaire » ou « proportionné ».
Un examen complet effectué pour : les incidents de niveau 3, les incidents jugés « graves » ou survenus dans un « lieu d’intérêt particulier » pour le BEC, les incidents où la force a été utilisée pour intervenir lors d’émeutes ou dans des circonstances soumises à des restrictions temporaires accrues, et les incidents où une équipe d’intervention d’urgence complète a été déployée.
-
Note 141
-
Représente toutes les interactions avec les personnes purgeant une peine fédérale, y compris au téléphone, en ligne et en personne.
-
Note 142
-
Aux fins du présent tableau, les « entrevues » ne comprennent que celles menées en personne et avec des personnes purgeant une peine de ressort fédéral. Les entrevues avec le personnel ne sont pas incluses, c’est pourquoi nous n’avons signalé aucune entrevue pour cetaines installations visitées. Il s’agit de cas où toutes les entrevues ont eu lieu avec le personnel. Entre les exercices financiers 2020-2021 et 2021-2022, le Bureau est passé à un modèle de visite en ligne, qui a guidé la façon dont les enquêteurs ont mené leurs activités pendant la pandémie. Ces visites comprenaient une combinaison de vidéoconférences et d’entrevues téléphoniques. Les lecteurs doivent garder cela à l’esprit lorsqu’ils comparent les données de ce tableau à celles des rapports annuels précédents.
-
Note 143
-
Représente le nombre de jours que le BEC a passés à visiter les installations du SCC. Les établissements comprennent les établissements du SCC, les ERC, les bureaux de libération conditionnelle dans la collectivité et d’autres endroits où des rencontres et des entrevues ont été menées avec des personnes purgeant une peine fédérale.
-
Note 144
-
À l’occasion, le personnel du BEC effectue des visites en équipes de deux personnes ou plus. Le nombre de jours-personnes dans les établissements reflète les efforts cumulatifs du personnel, calculés comme le nombre de jours consacrés à des visites dans les installations du SCC multiplié par le nombre de personnes de l’équipe visiteuse (le total saisit le nombre de jours sur place, par personne).
-
Note 145
-
Comprend le Centre régional de santé mentale.
-
Note 146
-
Comprend le Centre régional de traitement de Bath.
-
Note 147
-
Comprend l’unité d’évaluation et l’unité de détention temporaire de Joyceville
-
Note 148
-
Comprend le Centre régional de traitement de Millhaven, l’Unité d’évaluation et l’Unité de détention temporaire.
-
Note 149
-
Dans 107 cas, les plaignants ont demandé à rester anonymes. L’un de ces cas concernait une affaire provinciale qui ne relevait pas de la compétence du BEC.